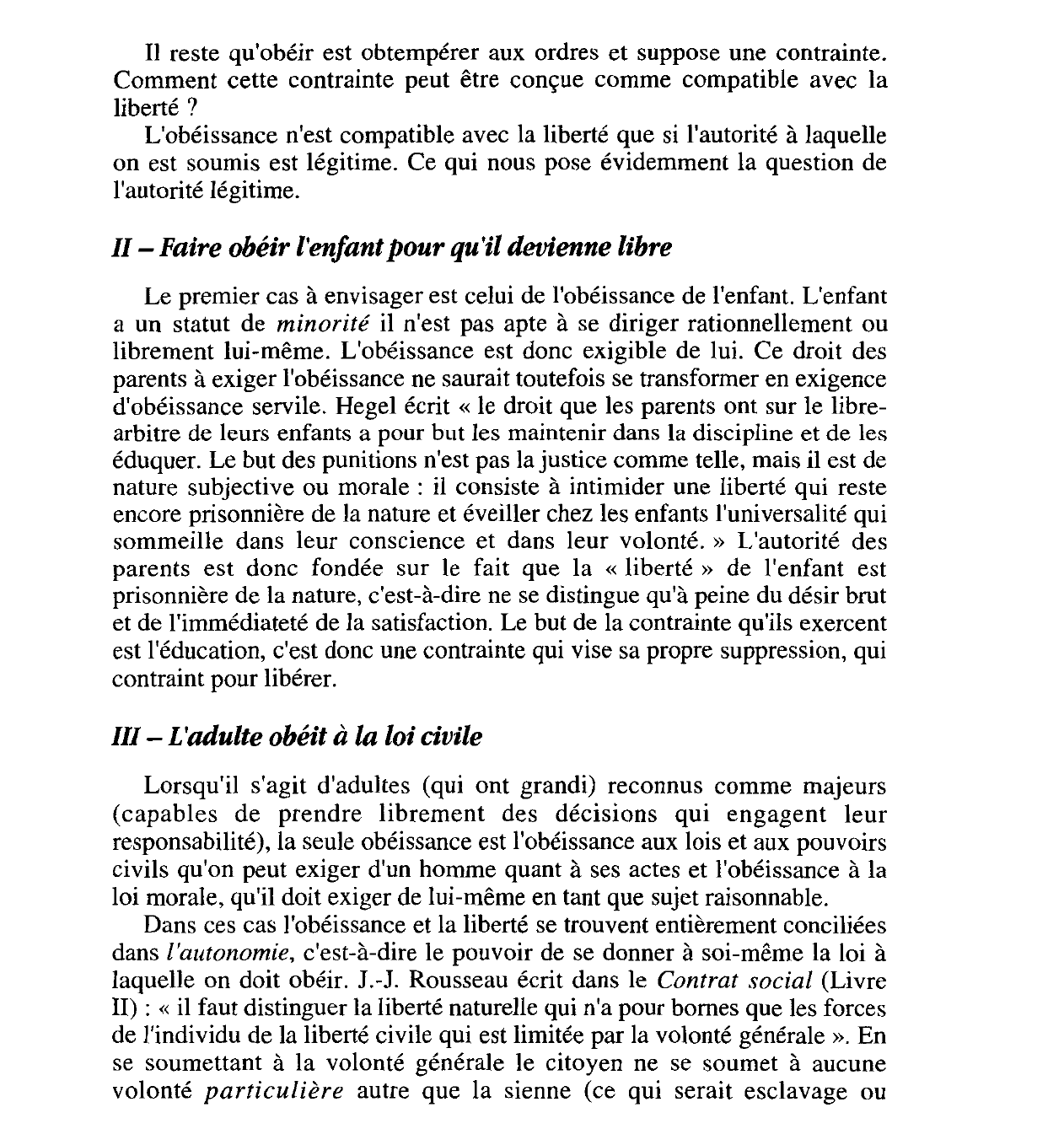Obéir est-ce renoncer à sa liberté ?
Publié le 20/03/2015
Extrait du document
PLAN
Introduction : en obéissant on renonce à agir selon son désir.
On peut toutefois montrer qu'on peut obéir en restant libre.
I — Obéir et servir. Quand peut-on dire qu'on obéit
légitimement ?
II — Faire obéir l'enfant pour qu'il devienne libre.
III — L'adulte obéit à la loi civile.
Conclusion : la loi morale, l'autonomie.
Appendice: le traitement du sujet par un grand philosophe :
Spinoza.
«
58 LA LIBERTÉ
Il reste qu'obéir est obtempérer aux ordres et suppose une contrainte.
Comment cette contrainte peut être conçue comme compatible avec la
liberté? L'obéissance n'est compatible avec la liberté que
si l'autorité à laquelle
on est soumis est légitime.
Ce qui nous pose évidemment la question de
l'autorité légitime.
II -Faire obéir l'enfant pour qu'il devienne libre
Le premier cas à envisager est celui de l'obéissance de l'enfant.
L'enfant
a un statut de
minorité il n'est pas apte à se diriger rationnellement ou
librement lui-même.
L'obéissance est donc exigible de lui.
Ce droit des
parents à exiger l'obéissance ne saurait toutefois se transformer en exigence
d'obéissance servile.
Hegel écrit
« le droit que les parents ont sur le libre
arbitre de leurs enfants a pour but les maintenir dans la discipline et de les
éduquer.
Le but des punitions n'est pas la justice comme telle, mais il est de
nature subjective ou morale : il consiste à intimider une liberté qui reste
encore prisonnière de la nature et éveiller chez les enfants l'universalité qui
sommeille dans leur conscience et dans leur volonté.
» L'autorité des
parents est donc fondée sur le fait que la
« liberté » de l'enfant est
prisonnière de la nature, c'est-à-dire ne
se distingue qu'à peine du désir brut
et de l'immédiateté de la satisfaction.
Le but
de la contrainte qu'ils exercent
est l'éducation, c'est donc une contrainte qui vise sa propre suppression, qui
contraint pour libérer.
III -L'adulte obéit à la loi civile
Lorsqu'il s'agit d'adultes (qui ont grandi) reconnus comme majeurs
(capables de prendre librement des décisions qui engagent leur
responsabilité), la seule obéissance est l'obéissance aux lois et aux pouvoirs
civils qu'on peut exiger d'un homme quant à ses actes et l'obéissance à la
loi morale, qu'il doit exiger de lui-même en tant que sujet raisonnable.
Dans ces cas l'obéissance et la liberté se trouvent entièrement conciliées
dans
l'autonomie, c'est-à-dire le pouvoir de se donner à soi-même la loi à
laquelle on doit obéir.
J.-J.
Rousseau écrit dans le
Contrat social (Livre
Il) :
«il faut distinguer la liberté naturelle qui n'a pour bornes que les forces
de l'individu de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale».
En
se soumettant à
la volonté générale le citoyen ne se soumet à aucune
volonté
particulière autre que la sienne (ce qui serait esclavage ou.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Obéir, renoncer à la liberté ?
- Obéir , est ce renoncer à sa liberté ?
- Obéir est-ce renoncer à sa liberté de penser ?
- Obéir, est-ce renoncer à sa liberté ?
- Obéir, est-ce renoncer à sa liberté ?