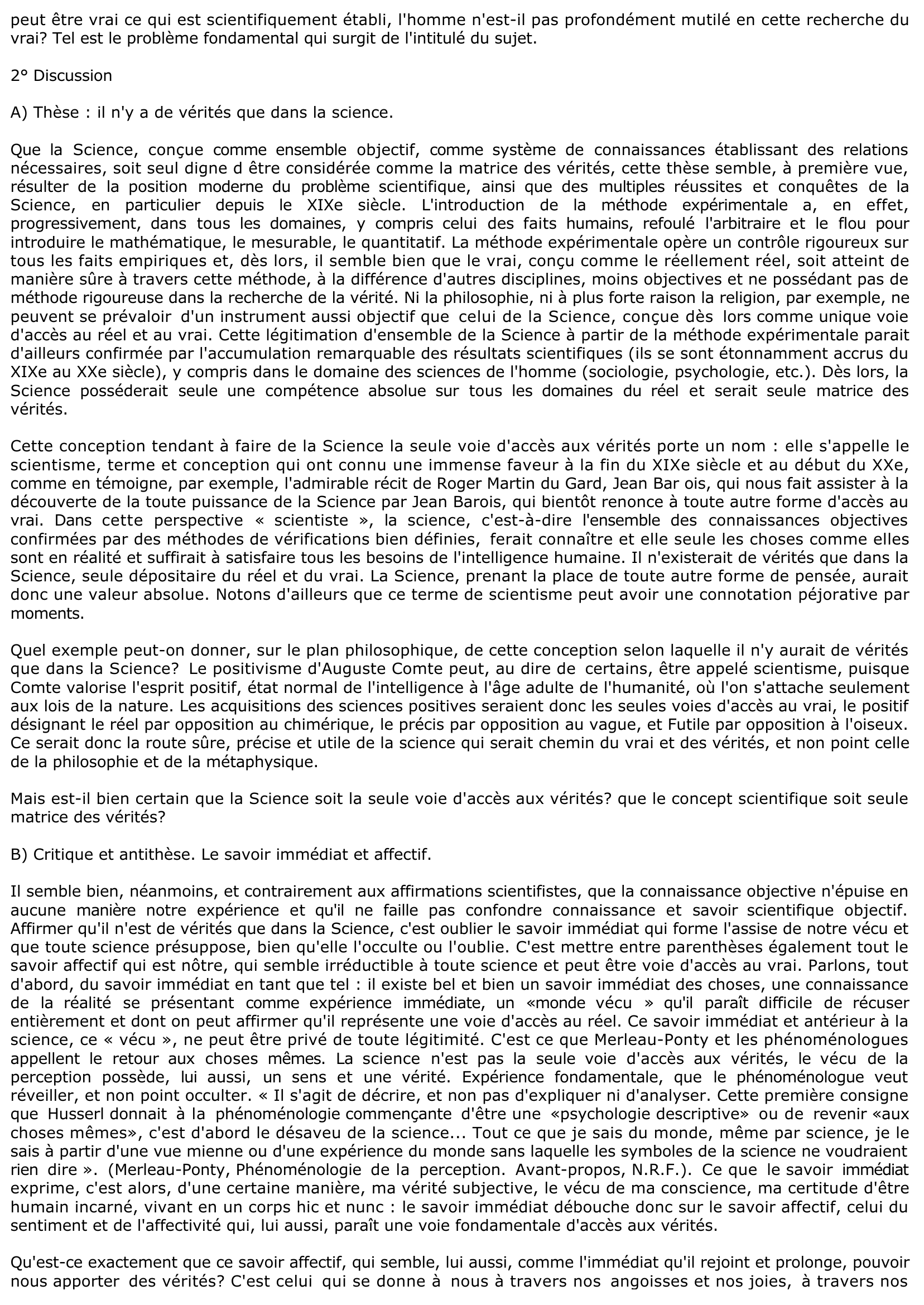N'y a-t-il de vérités que dans la Science ?
Publié le 11/02/2011

Extrait du document
I. ANALYSE DU SUJET. CONSEILS. REMARQUES DE MÉTHODE • Voici un sujet qui doit être très soigneusement et méthodiquement abordé. Ne récitez surtout pas précipitamment vos connaissances alors qu'il exige une réflexion élaborée sur le concept de science en ses différentes significations (Ici le mot de Science est écrit avec une majuscule : tirez-en les conséquences...). • N'oubliez pas la formulation restrictive - « N'y a-t-il que « - qui requiert, évidemment, une réponse adaptée. • Qu'appelle réellement cette question? La Science, qui est l'objectivité même, élimine-t-elle toute la subjectivité humaine, tout accès direct à des vérités essentielles pour l'homme? Tel est le problème soulevé par le sujet. • Répondre oui à la question, c'est s'engager dans la voie du scientisme et du positivisme qui fut tant en faveur à la fin du siècle dernier. Contre lui, un mouvement privilégiant le vécu comme expérience fondamentale du vrai s'est développé. • Cette opposition vous fournit la source du plan de votre discussion qui sera ainsi du type dialectique : - thèse : il n'y a de vérités que dans la science; - antithèse : le savoir immédiat comme vérité; - synthèse : la Science, au sens hégélien du terme, manifeste la totalité du réel et englobe les diverses vérités particulières.
«
peut être vrai ce qui est scientifiquement établi, l'homme n'est-il pas profondément mutilé en cette recherche duvrai? Tel est le problème fondamental qui surgit de l'intitulé du sujet.
2° Discussion
A) Thèse : il n'y a de vérités que dans la science.
Que la Science, conçue comme ensemble objectif, comme système de connaissances établissant des relationsnécessaires, soit seul digne d être considérée comme la matrice des vérités, cette thèse semble, à première vue,résulter de la position moderne du problème scientifique, ainsi que des multiples réussites et conquêtes de laScience, en particulier depuis le XIXe siècle.
L'introduction de la méthode expérimentale a, en effet,progressivement, dans tous les domaines, y compris celui des faits humains, refoulé l'arbitraire et le flou pourintroduire le mathématique, le mesurable, le quantitatif.
La méthode expérimentale opère un contrôle rigoureux surtous les faits empiriques et, dès lors, il semble bien que le vrai, conçu comme le réellement réel, soit atteint demanière sûre à travers cette méthode, à la différence d'autres disciplines, moins objectives et ne possédant pas deméthode rigoureuse dans la recherche de la vérité.
Ni la philosophie, ni à plus forte raison la religion, par exemple, nepeuvent se prévaloir d'un instrument aussi objectif que celui de la Science, conçue dès lors comme unique voied'accès au réel et au vrai.
Cette légitimation d'ensemble de la Science à partir de la méthode expérimentale paraitd'ailleurs confirmée par l'accumulation remarquable des résultats scientifiques (ils se sont étonnamment accrus duXIXe au XXe siècle), y compris dans le domaine des sciences de l'homme (sociologie, psychologie, etc.).
Dès lors, laScience posséderait seule une compétence absolue sur tous les domaines du réel et serait seule matrice desvérités.
Cette conception tendant à faire de la Science la seule voie d'accès aux vérités porte un nom : elle s'appelle lescientisme, terme et conception qui ont connu une immense faveur à la fin du XIXe siècle et au début du XXe,comme en témoigne, par exemple, l'admirable récit de Roger Martin du Gard, Jean Bar ois, qui nous fait assister à ladécouverte de la toute puissance de la Science par Jean Barois, qui bientôt renonce à toute autre forme d'accès auvrai.
Dans cette perspective « scientiste », la science, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances objectivesconfirmées par des méthodes de vérifications bien définies, ferait connaître et elle seule les choses comme ellessont en réalité et suffirait à satisfaire tous les besoins de l'intelligence humaine.
Il n'existerait de vérités que dans laScience, seule dépositaire du réel et du vrai.
La Science, prenant la place de toute autre forme de pensée, auraitdonc une valeur absolue.
Notons d'ailleurs que ce terme de scientisme peut avoir une connotation péjorative parmoments.
Quel exemple peut-on donner, sur le plan philosophique, de cette conception selon laquelle il n'y aurait de véritésque dans la Science? Le positivisme d'Auguste Comte peut, au dire de certains, être appelé scientisme, puisqueComte valorise l'esprit positif, état normal de l'intelligence à l'âge adulte de l'humanité, où l'on s'attache seulementaux lois de la nature.
Les acquisitions des sciences positives seraient donc les seules voies d'accès au vrai, le positifdésignant le réel par opposition au chimérique, le précis par opposition au vague, et Futile par opposition à l'oiseux.Ce serait donc la route sûre, précise et utile de la science qui serait chemin du vrai et des vérités, et non point cellede la philosophie et de la métaphysique.
Mais est-il bien certain que la Science soit la seule voie d'accès aux vérités? que le concept scientifique soit seulematrice des vérités?
B) Critique et antithèse.
Le savoir immédiat et affectif.
Il semble bien, néanmoins, et contrairement aux affirmations scientifistes, que la connaissance objective n'épuise enaucune manière notre expérience et qu'il ne faille pas confondre connaissance et savoir scientifique objectif.Affirmer qu'il n'est de vérités que dans la Science, c'est oublier le savoir immédiat qui forme l'assise de notre vécu etque toute science présuppose, bien qu'elle l'occulte ou l'oublie.
C'est mettre entre parenthèses également tout lesavoir affectif qui est nôtre, qui semble irréductible à toute science et peut être voie d'accès au vrai.
Parlons, toutd'abord, du savoir immédiat en tant que tel : il existe bel et bien un savoir immédiat des choses, une connaissancede la réalité se présentant comme expérience immédiate, un «monde vécu » qu'il paraît difficile de récuserentièrement et dont on peut affirmer qu'il représente une voie d'accès au réel.
Ce savoir immédiat et antérieur à lascience, ce « vécu », ne peut être privé de toute légitimité.
C'est ce que Merleau-Ponty et les phénoménologuesappellent le retour aux choses mêmes.
La science n'est pas la seule voie d'accès aux vérités, le vécu de laperception possède, lui aussi, un sens et une vérité.
Expérience fondamentale, que le phénoménologue veutréveiller, et non point occulter.
« Il s'agit de décrire, et non pas d'expliquer ni d'analyser.
Cette première consigneque Husserl donnait à la phénoménologie commençante d'être une «psychologie descriptive» ou de revenir «auxchoses mêmes», c'est d'abord le désaveu de la science...
Tout ce que je sais du monde, même par science, je lesais à partir d'une vue mienne ou d'une expérience du monde sans laquelle les symboles de la science ne voudraientrien dire ».
(Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception.
Avant-propos, N.R.F.).
Ce que le savoir immédiatexprime, c'est alors, d'une certaine manière, ma vérité subjective, le vécu de ma conscience, ma certitude d'êtrehumain incarné, vivant en un corps hic et nunc : le savoir immédiat débouche donc sur le savoir affectif, celui dusentiment et de l'affectivité qui, lui aussi, paraît une voie fondamentale d'accès aux vérités.
Qu'est-ce exactement que ce savoir affectif, qui semble, lui aussi, comme l'immédiat qu'il rejoint et prolonge, pouvoirnous apporter des vérités? C'est celui qui se donne à nous à travers nos angoisses et nos joies, à travers nos.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Y a-t-il des vérités hors de la science ?
- Y a-t-il des vérités hors science ?
- Les vérités mathématiques dérivent d'un petit nombre de propositions évidentes par une chaîne de raisonnements impeccables. Henri Poincaré, la Science et l'Hypothèse
- Ce qu'on appelle la science se compose-t-il exclusivement de vérités démontrées et définitives ?
- Idées de dissertation: y a t-il des vérités hors de la science?