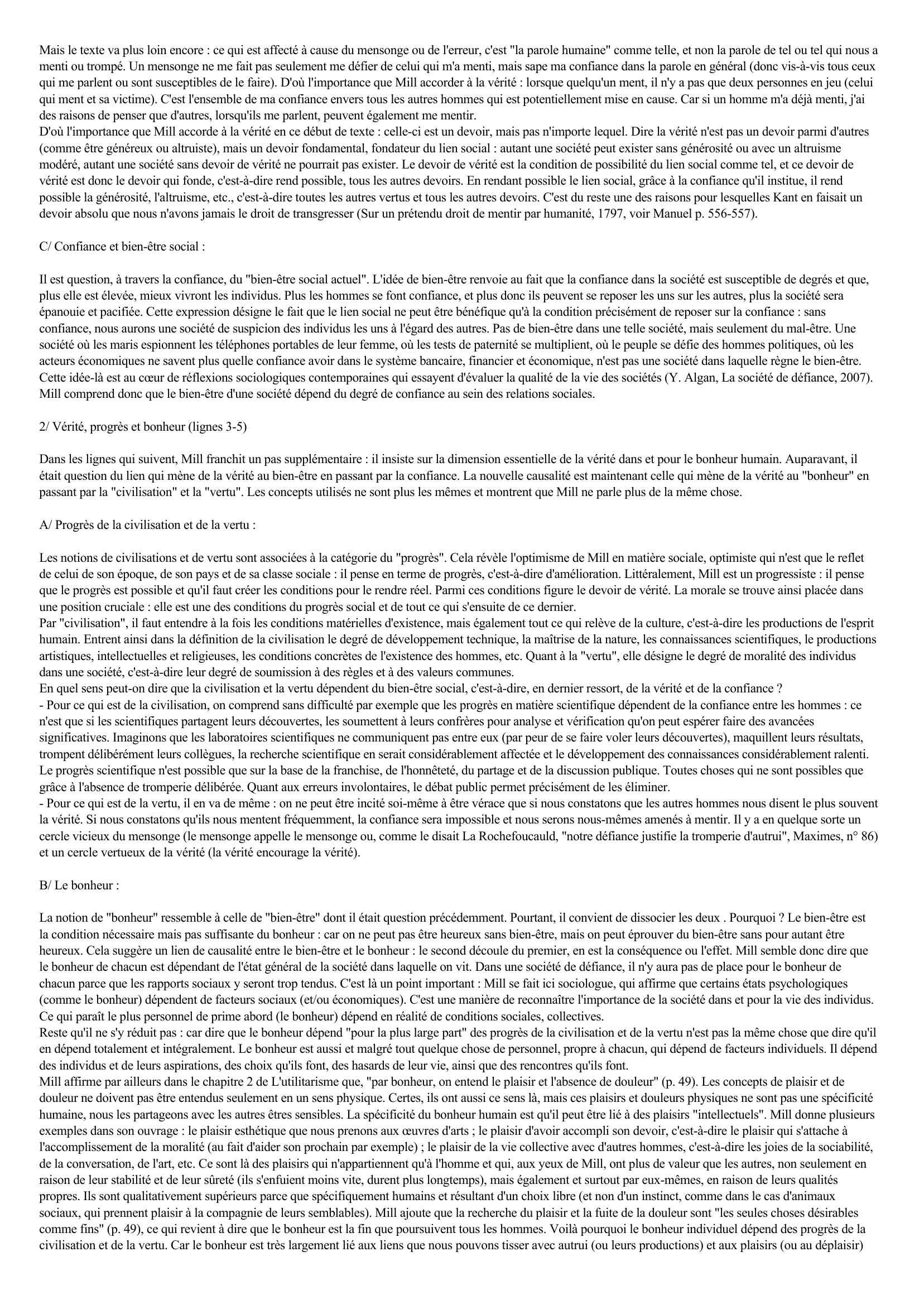Mill, la règle et son usage
Publié le 18/08/2012
Extrait du document
4) Le bonheur est-il quantifiable ? Dernière difficulté, le bonheur qui doit s'ensuivre d'une action est-il quantifiable ? Peut-on dire si, suite à une action, le bonheur de mes proches ou le bonheur général a augmenté ou pas ? Quel est le critère que l'on va utiliser pour déterminer cela ? Les critères ne sont-ils pas inévitablement subjectifs et particuliers ? Je pourrais dire qu'il y a un critère universel si je savais ce que veut la majorité des hommes. Mais précisément, nous l'avons vu avec l'objection précédente, je ne le sais pas. En quelque sorte, le texte présuppose que tous les hommes peuvent avoir une conception commune du bonheur, de telle sorte que ce que je considère comme un bien doit pouvoir l'être par tout homme : ce présupposé est-il fondé ? Un partisan de la démocratie libérale convaincu peut être persuadé que la démocratie libérale est le meilleur des régimes et tout faire pour l'instaurer ou la restaurer. Mais les adversaires de la démocratie pensent qu'un tel régime produit des inégalités socio-économiques et n'est pas efficace pour permettre à tous d'avoir des conditions de vie décentes et qu'il vaut mieux parfois un régime autoritaire qui va mieux redistribuer les richesses. Qu'en est-il ? Vaut-il mieux la liberté (et les inégalités) ou la contrainte (et l'égalité) ?
«
Mais le texte va plus loin encore : ce qui est affecté à cause du mensonge ou de l'erreur, c'est "la parole humaine" comme telle, et non la parole de tel ou tel qui nous amenti ou trompé.
Un mensonge ne me fait pas seulement me défier de celui qui m'a menti, mais sape ma confiance dans la parole en général (donc vis-à-vis tous ceuxqui me parlent ou sont susceptibles de le faire).
D'où l'importance que Mill accorder à la vérité : lorsque quelqu'un ment, il n'y a pas que deux personnes en jeu (celuiqui ment et sa victime).
C'est l'ensemble de ma confiance envers tous les autres hommes qui est potentiellement mise en cause.
Car si un homme m'a déjà menti, j'aides raisons de penser que d'autres, lorsqu'ils me parlent, peuvent également me mentir.D'où l'importance que Mill accorde à la vérité en ce début de texte : celle-ci est un devoir, mais pas n'importe lequel.
Dire la vérité n'est pas un devoir parmi d'autres(comme être généreux ou altruiste), mais un devoir fondamental, fondateur du lien social : autant une société peut exister sans générosité ou avec un altruismemodéré, autant une société sans devoir de vérité ne pourrait pas exister.
Le devoir de vérité est la condition de possibilité du lien social comme tel, et ce devoir devérité est donc le devoir qui fonde, c'est-à-dire rend possible, tous les autres devoirs.
En rendant possible le lien social, grâce à la confiance qu'il institue, il rendpossible la générosité, l'altruisme, etc., c'est-à-dire toutes les autres vertus et tous les autres devoirs.
C'est du reste une des raisons pour lesquelles Kant en faisait undevoir absolu que nous n'avons jamais le droit de transgresser (Sur un prétendu droit de mentir par humanité, 1797, voir Manuel p.
556-557).
C/ Confiance et bien-être social :
Il est question, à travers la confiance, du "bien-être social actuel".
L'idée de bien-être renvoie au fait que la confiance dans la société est susceptible de degrés et que,plus elle est élevée, mieux vivront les individus.
Plus les hommes se font confiance, et plus donc ils peuvent se reposer les uns sur les autres, plus la société seraépanouie et pacifiée.
Cette expression désigne le fait que le lien social ne peut être bénéfique qu'à la condition précisément de reposer sur la confiance : sansconfiance, nous aurons une société de suspicion des individus les uns à l'égard des autres.
Pas de bien-être dans une telle société, mais seulement du mal-être.
Unesociété où les maris espionnent les téléphones portables de leur femme, où les tests de paternité se multiplient, où le peuple se défie des hommes politiques, où lesacteurs économiques ne savent plus quelle confiance avoir dans le système bancaire, financier et économique, n'est pas une société dans laquelle règne le bien-être.Cette idée-là est au cœur de réflexions sociologiques contemporaines qui essayent d'évaluer la qualité de la vie des sociétés (Y.
Algan, La société de défiance, 2007).Mill comprend donc que le bien-être d'une société dépend du degré de confiance au sein des relations sociales.
2/ Vérité, progrès et bonheur (lignes 3-5)
Dans les lignes qui suivent, Mill franchit un pas supplémentaire : il insiste sur la dimension essentielle de la vérité dans et pour le bonheur humain.
Auparavant, ilétait question du lien qui mène de la vérité au bien-être en passant par la confiance.
La nouvelle causalité est maintenant celle qui mène de la vérité au "bonheur" enpassant par la "civilisation" et la "vertu".
Les concepts utilisés ne sont plus les mêmes et montrent que Mill ne parle plus de la même chose.
A/ Progrès de la civilisation et de la vertu :
Les notions de civilisations et de vertu sont associées à la catégorie du "progrès".
Cela révèle l'optimisme de Mill en matière sociale, optimiste qui n'est que le refletde celui de son époque, de son pays et de sa classe sociale : il pense en terme de progrès, c'est-à-dire d'amélioration.
Littéralement, Mill est un progressiste : il penseque le progrès est possible et qu'il faut créer les conditions pour le rendre réel.
Parmi ces conditions figure le devoir de vérité.
La morale se trouve ainsi placée dansune position cruciale : elle est une des conditions du progrès social et de tout ce qui s'ensuite de ce dernier.Par "civilisation", il faut entendre à la fois les conditions matérielles d'existence, mais également tout ce qui relève de la culture, c'est-à-dire les productions de l'esprithumain.
Entrent ainsi dans la définition de la civilisation le degré de développement technique, la maîtrise de la nature, les connaissances scientifiques, le productionsartistiques, intellectuelles et religieuses, les conditions concrètes de l'existence des hommes, etc.
Quant à la "vertu", elle désigne le degré de moralité des individusdans une société, c'est-à-dire leur degré de soumission à des règles et à des valeurs communes.En quel sens peut-on dire que la civilisation et la vertu dépendent du bien-être social, c'est-à-dire, en dernier ressort, de la vérité et de la confiance ?- Pour ce qui est de la civilisation, on comprend sans difficulté par exemple que les progrès en matière scientifique dépendent de la confiance entre les hommes : cen'est que si les scientifiques partagent leurs découvertes, les soumettent à leurs confrères pour analyse et vérification qu'on peut espérer faire des avancéessignificatives.
Imaginons que les laboratoires scientifiques ne communiquent pas entre eux (par peur de se faire voler leurs découvertes), maquillent leurs résultats,trompent délibérément leurs collègues, la recherche scientifique en serait considérablement affectée et le développement des connaissances considérablement ralenti.Le progrès scientifique n'est possible que sur la base de la franchise, de l'honnêteté, du partage et de la discussion publique.
Toutes choses qui ne sont possibles quegrâce à l'absence de tromperie délibérée.
Quant aux erreurs involontaires, le débat public permet précisément de les éliminer.- Pour ce qui est de la vertu, il en va de même : on ne peut être incité soi-même à être vérace que si nous constatons que les autres hommes nous disent le plus souventla vérité.
Si nous constatons qu'ils nous mentent fréquemment, la confiance sera impossible et nous serons nous-mêmes amenés à mentir.
Il y a en quelque sorte uncercle vicieux du mensonge (le mensonge appelle le mensonge ou, comme le disait La Rochefoucauld, "notre défiance justifie la tromperie d'autrui", Maximes, n° 86)et un cercle vertueux de la vérité (la vérité encourage la vérité).
B/ Le bonheur :
La notion de "bonheur" ressemble à celle de "bien-être" dont il était question précédemment.
Pourtant, il convient de dissocier les deux .
Pourquoi ? Le bien-être estla condition nécessaire mais pas suffisante du bonheur : car on ne peut pas être heureux sans bien-être, mais on peut éprouver du bien-être sans pour autant êtreheureux.
Cela suggère un lien de causalité entre le bien-être et le bonheur : le second découle du premier, en est la conséquence ou l'effet.
Mill semble donc dire quele bonheur de chacun est dépendant de l'état général de la société dans laquelle on vit.
Dans une société de défiance, il n'y aura pas de place pour le bonheur dechacun parce que les rapports sociaux y seront trop tendus.
C'est là un point important : Mill se fait ici sociologue, qui affirme que certains états psychologiques(comme le bonheur) dépendent de facteurs sociaux (et/ou économiques).
C'est une manière de reconnaître l'importance de la société dans et pour la vie des individus.Ce qui paraît le plus personnel de prime abord (le bonheur) dépend en réalité de conditions sociales, collectives.Reste qu'il ne s'y réduit pas : car dire que le bonheur dépend "pour la plus large part" des progrès de la civilisation et de la vertu n'est pas la même chose que dire qu'ilen dépend totalement et intégralement.
Le bonheur est aussi et malgré tout quelque chose de personnel, propre à chacun, qui dépend de facteurs individuels.
Il dépenddes individus et de leurs aspirations, des choix qu'ils font, des hasards de leur vie, ainsi que des rencontres qu'ils font.Mill affirme par ailleurs dans le chapitre 2 de L'utilitarisme que, "par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur" (p.
49).
Les concepts de plaisir et dedouleur ne doivent pas être entendus seulement en un sens physique.
Certes, ils ont aussi ce sens là, mais ces plaisirs et douleurs physiques ne sont pas une spécificitéhumaine, nous les partageons avec les autres êtres sensibles.
La spécificité du bonheur humain est qu'il peut être lié à des plaisirs "intellectuels".
Mill donne plusieursexemples dans son ouvrage : le plaisir esthétique que nous prenons aux œuvres d'arts ; le plaisir d'avoir accompli son devoir, c'est-à-dire le plaisir qui s'attache àl'accomplissement de la moralité (au fait d'aider son prochain par exemple) ; le plaisir de la vie collective avec d'autres hommes, c'est-à-dire les joies de la sociabilité,de la conversation, de l'art, etc.
Ce sont là des plaisirs qui n'appartiennent qu'à l'homme et qui, aux yeux de Mill, ont plus de valeur que les autres, non seulement enraison de leur stabilité et de leur sûreté (ils s'enfuient moins vite, durent plus longtemps), mais également et surtout par eux-mêmes, en raison de leurs qualitéspropres.
Ils sont qualitativement supérieurs parce que spécifiquement humains et résultant d'un choix libre (et non d'un instinct, comme dans le cas d'animauxsociaux, qui prennent plaisir à la compagnie de leurs semblables).
Mill ajoute que la recherche du plaisir et la fuite de la douleur sont "les seules choses désirablescomme fins" (p.
49), ce qui revient à dire que le bonheur est la fin que poursuivent tous les hommes.
Voilà pourquoi le bonheur individuel dépend des progrès de lacivilisation et de la vertu.
Car le bonheur est très largement lié aux liens que nous pouvons tisser avec autrui (ou leurs productions) et aux plaisirs (ou au déplaisir).
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Synonymes de ordinaire, adjectif Coutumier -- accoutumé, attendu, connu, consacré, coutumier, d'usage, de pratique courante, de règle, de routine, de tradition, familier, habituel, naturel, normal,quotidien, régulier, rituel, routinier, usuel.
- L'usage est la règle et la loi suprême du langage. ?
- Le Théâtre Classique et la règle de trois unités.
- la liberté selon Mill: tyrannie de la majorité
- L'accomplissement de tous nos désirs s'oppose-t-il à une bonne règle de vie ?