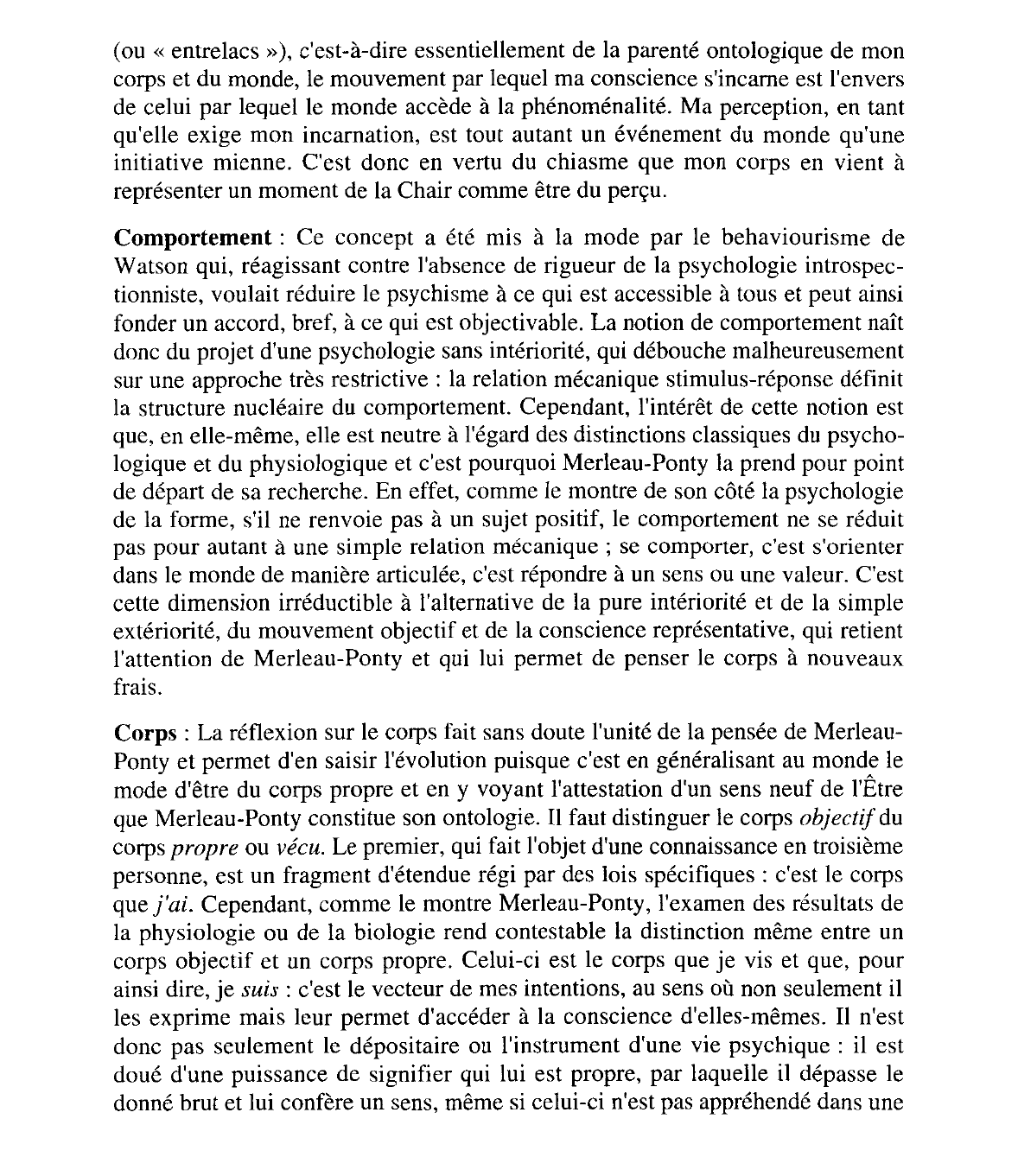Merleau-Ponty: sa philosophie et ses concepts
Publié le 22/03/2015
Extrait du document
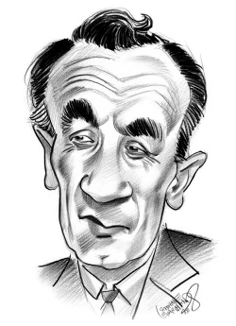
Cependant, la négation que comporte cet invisible ne renvoie en aucun cas à une autre forme de visibilité, en quelque sorte supérieure.
Logos : Après la publication de la Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty s'attache à montrer que l'on peut rendre compte de la spécificité de l'idéalité sans renoncer à son enracinement dans un sol perceptif, ce qui le conduit à une analyse approfondie de l'expression linguistique.
En effet, Merleau-Ponty retrouve, au niveau sensible comme au niveau de la parole, une structure «diacritique« : la chose perçue ou le sens conçu ne sont rien d'autre que des dimensions articulant un jeu de différences.
Il fallait donc un concept spécifique pour désigner cette dimension pour ainsi dire prélinguistique du perçu, c'est-à-dire l'unité des sens perçu et langagier par-delà leurs différences.
Ainsi, il y a une distance ou une profondeur constitutives du monde.
Cependant, en thématisant cette transcendance, Merleau-Ponty ne fait qu'expliciter un trait essentiel du monde, déjà mis en évidence par Husserl, à savoir la structure d'horizon.
Cette neutralisation n'abolit pas le monde, comme le doute cartésien ; elle le découvre comme pôle intentionnel d'une conscience, comme constitué en elle.
Aux yeux de Merleau-Ponty, le retour à l'expérience effective, c'est-à-dire la neutralisation de toutes les formes de naïveté quant au sens d'être du monde, ne saurait déboucher sur la position d'une conscience, qu'il juge également tributaire d'une attitude idéalisante vis-à-vis du monde.
Aussi reprend-il à son compte le projet husserlien, thématisé dans la Krisis, d'un retour au monde de la vie (Lebenswelt), qui le débarrasse du «vêtement d'idées« qu'y dépose cette pratique singulière qu'est l'activité théorique.
Visible : La question de la vision est d'une importance primordiale car elle est, de tous les sens, celui qui m'ouvre à un monde, celui qui détient les clefs de l'extériorité.
Dans le cas des autres sens, même de l'ouïe, le sentant fait toujours l'épreuve de lui-même en même temps que du monde.
Au contraire, le ceci visuel «me donne et me donne seul la présence de ce qui n'est pas moi, de ce qui est simplement et pleinement«.
C'est donc, à travers la vision, la question même du sensible qui est en jeu.
L'étude du toucher, qui tient lieu de «réduction« de la vision, montre l'inscription essentielle du sentant au registre de ce qu'il sent.
Je ne vois quelque chose qu'en vertu de ma parenté ontologique avec l'objet vu, c'est-à-dire de mon appartenance au monde : la visibilité du voyant est constitutive de sa vision.
Il faut en conclure, en vertu du chiasme, qu'il est encore insuffisant d'affirmer que je vois quelque chose là-bas : c'est au contraire la chose qui accède d'elle-même à la vision, qui «se voit là-bas«.
Dire que le voyant est visible, c'est dire que la vision vient cristalliser une visibilité intrinsèque des choses, que l'acte de voir est l'envers d'un mouvement plus profond par lequel la chose accède à la visibilité.
Tel est le sens véritable du sensible, dont le visible est l'emblème.
Il ne faut pas l'entendre comme cela qui, susceptible d'être vu, requerrait un acte de vision pour l'être effectivement ; cette aptitude à être vu fait partie de l'Être et l'acte de vision, loin de fonder la visibilité, en procède.
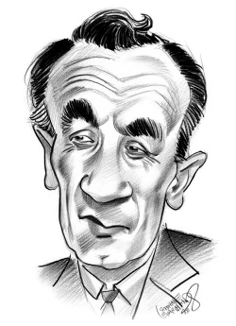
«
Vocabulaire 53
(ou « entrelacs » ), c'est-à-dire essentiellement de la parenté ontologique de mon
corps et du monde, le mouvement par lequel ma conscience s'incarne est l'envers
de celui par lequel le monde accède à la phénoménalité.
Ma perception, en tant
qu'elle exige mon incarnation, est tout autant un événement du monde qu'une
initiative mienne.
C'est donc en vertu du chiasme que mon corps en vient à
représenter un moment de la Chair comme être du perçu.
Comportement : Ce concept a été mis à la mode par le behaviourisme de
Watson qui, réagissant contre l'absence de rigueur de la psychologie introspec
tionniste, voulait réduire le psychisme à ce qui est accessible à tous et peut ainsi
fonder un accord, bref, à ce qui est objectivable.
La notion de comportement naît
donc du projet d'une psychologie sans intériorité, qui débouche malheureusement
sur une approche très restrictive : la relation mécanique stimulus-réponse définit
la structure nucléaire du comportement.
Cependant, l'intérêt de cette notion est
que, en elle-même, elle est neutre à l'égard des distinctions classiques du psycho
logique et du physiologique et c'est pourquoi Merleau-Ponty la prend pour point
de départ de sa recherche.
En effet, comme
le montre de son côté la psychologie
de la forme, s'il ne renvoie pas à un sujet positif, le comportement ne se réduit
pas pour autant
à une simple relation mécanique ; se comporter, c'est s'orienter
dans
le monde de manière articulée, c'est répondre à un sens ou une valeur.
C'est
cette dimension irréductible à l'alternative de la pure intériorité et de la simple
extériorité,
du mouvement objectif et de la conscience représentative, qui retient
l'attention de Merleau-Ponty et qui lui permet de penser le corps à nouveaux
frais.
Corps : La réflexion sur le corps fait sans doute l'unité de la pensée de Merleau
Ponty et permet d'en saisir l'évolution puisque c'est en généralisant au monde le
mode d'être du corps propre et en y voyant l'attestation d'un sens neuf de !'Être
que Merleau-Ponty constitue son ontologie.
Il faut distinguer le corps
objectif du
corps propre ou vécu.
Le premier, qui fait l'objet d'une connaissance en troisième
personne, est un fragment d'étendue régi par des lois spécifiques : c'est le corps
que
j'ai.
Cependant, comme le montre Merleau-Ponty, l'examen des résultats de
la physiologie ou de la biologie rend contestable la distinction même entre un
corps objectif et un corps propre.
Celui-ci est le corps que
je vis et que, pour
ainsi dire,
je suis : c'est le vecteur de mes intentions, au sens où non seulement il
les exprime mais leur permet d'accéder à la conscience d'elles-mêmes.
Il n'est
donc pas seulement le dépositaire ou l'instrument d'une vie psychique : il est
doué d'une puissance de signifier qui lui est propre, par laquelle il dépasse le
donné brut et lui confère un sens, même si celui-ci n'est pas appréhendé dans une.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ÉLOGE DE LA PHILOSOPHIE de Maurice Merleau-Ponty (résumé & analyse)
- ÉLOGE DE LA PHILOSOPHIE, 1953. Maurice Merleau-Ponty
- ÉLOGE DE LA PHILOSOPHIE. Maurice Merleau-Ponty (résumé)
- La philosophie de Merleau-Ponty
- Merleau-Ponty, Le Philosophe et son ombre. Éloge de la philosophie, Gallimard