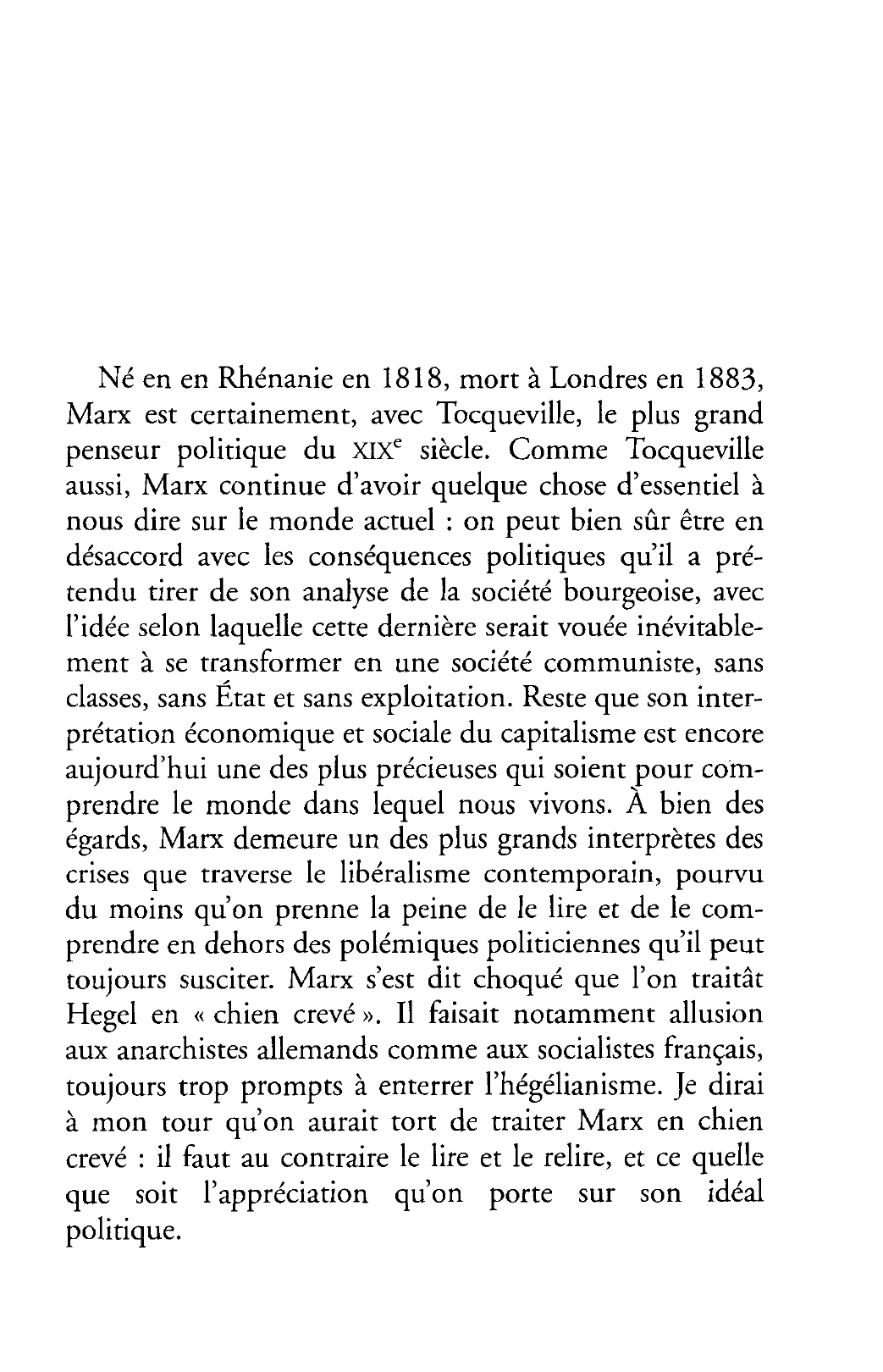Marx et l'hypothèse communiste
Publié le 23/03/2015
Extrait du document
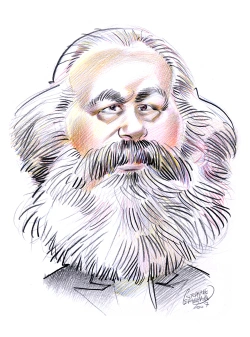
Il est sur ce point très intéressant de comparer Marx et Tocqueville, dont les lectures respectives des Déclarations de 1789 et de 1848 sont diamétralement opposées, notamment quant à la nature de ce qu'on appelle les «droits libertés«, ces droits qui forment l'essentiel de la grande Déclaration : la liberté d'opinion et de circulation, la sûreté (le droit de ne pas être arbitrairement arrêté par la police), le droit de propriété, etc.
Il fallait vraiment que Marx fût aveuglé par sa volonté acharnée de démontrer que les droits de l'homme ne visaient qu'à empêcher le prolétariat de nouer des rapports de forces favorables face aux capitalistes pour ne pas s'apercevoir que ces droits s'avéraient finalement beaucoup plus favorables à la résistance du monde ouvrier qu'au monde bourgeois lui-même.
L'erreur commise par Marx sur le sens des droits libertés contenus dans la Déclaration de 1789 a donc fait débat, non seulement entre marxistes et libéraux, mais aussi, comme nous le verrons dans un instant, entre marxistes et sociaux-démocrates, entre partisans de la révolution prolétarienne et partisans d'un réformisme démocratique.
Son argument est simple : si ce droit à trouver un emploi n'est pas une plaisanterie, si l'État doit vraiment s'engager à fournir du travail aux ouvriers, s'il s'agit réellement d'un «droit opposable«, alors il faut que l'État devienne propriétaire et se fasse lui-même industriel et entrepreneur : c'est le seul moyen pour lui de distribuer des emplois.
Or, dans cette hypothèse, poursuit Tocqueville, nous nous acheminons vers le communisme dont l'inscription du droit au travail dans la Constitution n'est que le préalable.
Pour commencer, explique Jaurès, il faut en finir avec la fameuse et détestable théorie marxiste de la «dictature du prolétariat«, cette dictature qui, une fois la propriété privée abolie, devrait être instaurée pour achever la révolution et extirper les derniers restes de la bourgeoisie, bref, pour pratiquer ce qu'on appellera dans d'autres contextes une «épuration« [9].
Du coup, contrairement à Marx là encore, Jaurès en vient à penser que l'État n'est pas, ou en tout cas pas seulement, un instrument de domination de la classe dominante sur les dominés.
Cet État bourgeois, qui ne représenterait qu'une classe sociale, n'a même jamais existé, relève-t-il.
La vérité, c'est que l'État est un milieu relativement «neutre« dans lequel l'ensemble des luttes de classes se réfracte, les intérêts de la classe ouvrière aussi bien que ceux de la classe bourgeoise.
L'État démocratique, dit Jaurès, est donc un État-arbitre.
Quant au pluralisme politique et aux droits de l'homme, ils constituent eux aussi un milieu neutre dans lequel la classe ouvrière évolue tout autant que la classe bourgeoise.
L'État réfracte en lui l'état de la lutte des classes, mais il est, ou en tout cas il peut devenir, l'instrument de la classe ouvrière au moins autant que celui de la classe bourgeoise.
Et il faut donc s'en emparer, mais par des élections libres et des luttes sociales qui se maintiennent dans le cadre du droit démocratique, par l'argumentation, la conviction, l'élévation du niveau intellectuel et culturel des masses, pas par la violence.
Jaurès est partisan d'un socialisme démocratique, d'un socialisme qui conquiert légalement le pouvoir et qui ira peut-être jusqu'à supprimer la propriété privée, mais qui fera la révolution par les urnes et dans les urnes, dans un cadre républicain donc, non par la violence ni en instaurant une quelconque dictature du prolétariat.
Ce débat sur la nature de l'État démocratique pose bien évidemment une autre question, tout aussi cruciale : celle de ce qu'on a appelé l «autonomie du politique«.
Est-il vrai, comme le pense Marx, que le politique n'est qu'une «superstructure« de la sphère économique, une espèce de reflet de la situation matérielle d'un pays, un théâtre de marionnettes de part en part déterminées par l'économie «en dernière instance«?
C'est là déjà ce que Trotski (1879-1940) commence à contester.
Peu avant sa mort, Trotski faisait en effet valoir, non sans profondeur, que si la dictature du prolétariat devait perdurer indéfiniment en Union soviétique --- en prenant la forme de la dictature d'une bureaucratie stalinienne ---, cela signifierait que la théorie marxiste de l'État est fausse.
En effet, on se souvient que, d'après cette théorie, l'État ne ferait que servir les intérêts de la classe dominante, elle-même adossée à la propriété privée.
Or, poursuit Trotski en substance, si un État oppresseur continue d'exister (sous la forme de la bureaucratie stalinienne), alors même que la propriété privée a été abolie et la lutte des classes supprimée, du moins selon le discours officiel porté par Lénine et Staline, c'est forcément qu'il y a bien une autonomie du politique par rapport à l'économie.
Deux anciens trotskistes ayant rompu définitivement avec leurs amours de jeunesse, Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, qui créèrent dans le Paris des années 1950 le groupe Socialisme ou Barbarie, vont poursuivre et approfondir la critique trotskiste du stalinisme.
Ils vont notamment la prolonger par une analyse philosophique beaucoup plus fine de la nature exacte de la bureaucratie totalitaire.
Accuser Marx d'être stalinien n'a évidemment guère de sens : c'est un anachronisme d'autant plus contestable qu'à titre personnel Marx aurait probablement été hostile à Staline.
Reste que, selon Lefort et Cas-toriadis, dont les analyses sont au départ très proches sur ce point, les germes du totalitarisme sont bien présents dans la pensée de Marx.
Et ce pour deux raisons que je voudrais vous indiquer brièvement.
Il est logique que ce soit au contraire le «guide génial«, incarnation même de la vérité scientifique, ou à tout le moins le Comité central, qui prenne la direction des opérations.
La façon dont la critique antitotalitaire de gauche portée, en France, par Castoria-dis et Lefort, a fait ressortir les potentialités totalitaires du marxisme me paraît non seulement profonde mais, hélas, juste.
La vérité, c'est que le monde bourgeois ne peut paradoxalement se maintenir qu'en s'en prenant en permanence à tout ce qui est de l'ordre de la tradition, cette liquidation perpétuelle des autorités et des valeurs traditionnelles étant une condition préalable indispensable à l'innovation, elle-même ayant pris l'allure d'une contrainte absolue, d'un cahier des charges indiscutable dans cette logique de concurrence généralisée qu'on appelle la mondialisation libérale.
Considéré par les autorités politiques françaises comme un dangereux révolutionnaire, Marx est chassé de Paris.
Il se réfugie à Bruxelles et rejoint, avec Engels, la Ligue des communistes.
Ils sont alors chargés de rédiger le programme de cette organisation, travail qui donnera naissance à un petit texte appelé à une incomparable célébrité : Le Manifeste du Parti communiste, publié en 1848.
Mais Marx doit quitter à nouveau la Belgique.
Il revient à Paris, en février 1848, lorsque éclate la révolution, puis retourne en Allemagne.
Accusé d'organiser des activités subversives, il est derechef expulsé, revient à Paris, puis quitte à nouveau la France pour s'installer définitivement à Londres, en 1849.
L'exil permanent dans lequel vit la famille Marx est évidemment pénible.
Faute d'un métier stable, les Marx vivent dans une extrême misère et seul le soutien financier d'Engels leur permet de survivre.
À Londres, Marx se consacre tout entier à la rédaction de son oeuvre, tout en poursuivant ses activités militantes.
Il poursuit ses recherches en économie politique, correspond avec les militants révolutionnaires de divers pays et rédige des brochures politiques.
En 1859, il participe au journal germanophone Das Volk jusqu'à la création du premier parti ouvrier allemand, puis, en 1864, il rédige le manifeste de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs (la fameuse «première internationale«).
Après l'écrasement de la Commune de Paris, en 1871, il publie un livre sur les événements, La Guerre civile en France, ouvrage qui témoigne de son souci constant d'allier la réflexion théorique à la critique du temps présent.
Ce n'est pas pour rien qu'il a finalement préféré faire carrière dans la presse et dans les livres plutôt qu'à l'Université.
Curieusement, c'est le premier ouvrage publié de son vivant à recevoir un véritable écho «médiatique«.
Marx devient, sinon célèbre, du moins une référence incontournable du mouvement ouvrier.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de lecture: le Manifeste du parti communiste de Marx et Engels
- LE « MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE » DE KARL MARX ET FRIEDRICH ENGELS
- MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE, Karl Marx, 1818-1883, et Friedrich Engels, 1820-1895
- MANIFESTE DU PARTI COMMUNISTE de Karl Marx - résumé
- Marx et Engels, Manifeste du Parti communiste, trad. É. Bottigelli, GF-Flammarion, p. 76.