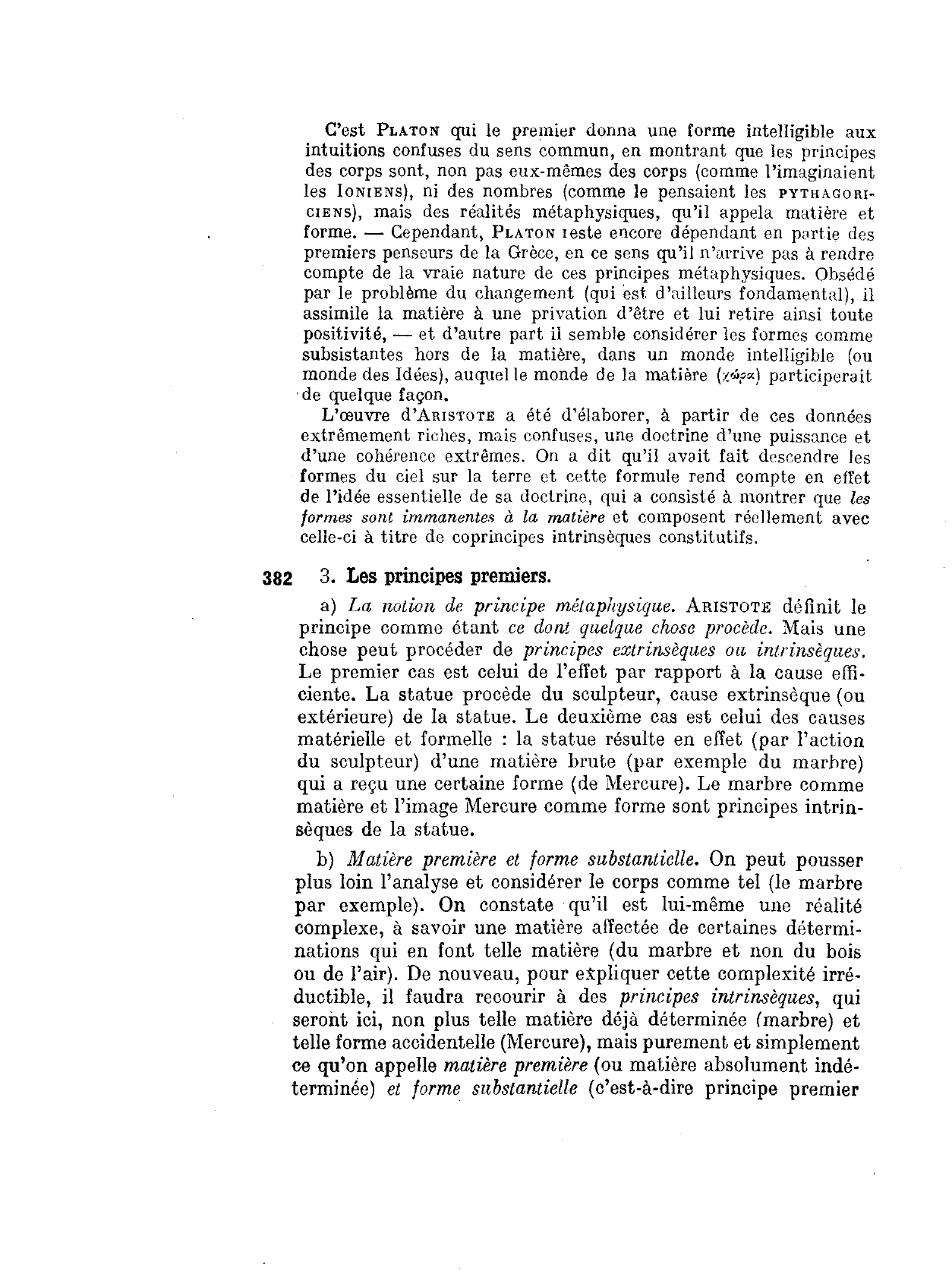L'hylémorphisme
Publié le 13/06/2012
Extrait du document
Ainsi découvrons-nous la racine du devenir ou, si l'on veut, sa forme la plus fondamentale : la temporalité. Si nous cherchons ce qu'elle impliqué, nous dirons que le devenir temporel exclut que l'être soumis au devenir soit simple, puisque ce qui est simple est nécessairement et constamment tout ce qu'il est, - ou bien n'est pas. Un être en devenir est donc composé. - Quelle est, maintenant, la nature de ce composé ? Ce n'est évidemment pas un composé accidentel, c'est-à-dire formé de deux êtres complets, liés du dehors, car c'est le même être qui est et qui devient. Il s'agit donc d'une composition métaphysique, c'est-à-dire résultant de l'union de deux principes d'être, formant par leur union un seul être, complexe, mais un.
«
C'est PLATON qui le premier donna une forme intelligible aux
intuitions confuses du sens commun, en montrant que les principes des corps sont, non pas eux-mêmes des corps (comme l'imaginaient
les IoNIENs), ni des nombres (comme le pensaient les PYTHAGORI CIENs), mais des réalités métaphysiques, qu'il appela matière et forme.- Cependant, PLATON reste encore dépendant en partie des
premiers penseurs de la Grèce, en ce sens qu'il n'arrive pas à rendre
compte de la vraie nature de ces principes métaphysiques.
Obsédé
par le problème du changement (qui est d'ailleurs fondamental), il
assimile la matière à une privation d'être et lui retire ainsi toute
positivité, -et d'autre part il semble considérer les formes comme
subsistantes hors de la matière, dans un monde intelligible (ou monde des Idées), auquel le monde de la matière (xo\po:) participerait ·de quelque façon.
L'œuvre d'ARISTOTE a été d'élaborer, à partir de ces données
extrêmement riches, mais confuses, une doctrine d'une puissance et
d'une cohérence extrêmes.
On a dit qu'il av~Jit fait descendre les
formes du ciel sur la terre et cette formule rend compte en effet
de l'idée essentielle de sa doctrine, qui a consisté à montrer que les
formes sont immanentes à la matière et composent réellement avec
celle-ci à titre de coprincipes intrinsèques constitutifs.
382 3.
Les principes premiers.
a) La notion de principe métaphysique.
ARISTOTE définit le
principe comme
étant ce dont quelque chose procède.
Mais une
chose peut procéder de principes extrinsèques ou intrinsèques.
Le premier cas est celui de l'effet par rapport à la cause effi·
ciente.
La statue procède du sculpteur, cause extrinsèque (ou
extérieure) de
la statue.
Le deuxième cas est celui des causes
matérielle
et formelle : la statue résulte en effet (par l'action
du sculpteur) d'une matière brute (par exemple du marbre)
qui a reçu une certaine forme (de Mercure).
Le marbre comme
matière
et l'image Mercure comme forme sont principes intrin
sèques de la statue.
b) Matière première et forme substantielle.
On peut pousser
plus loin l'analyse
et considérer le corps comme tel (le marbre
par exemple).
On constate qu'il est lui-même une réalité
complexe, à savoir une matière affectée de certaines détermi
nations qui
en font telle matière (du marbre et non du bois
ou de l'air).
De nouveau, pour expliquer cette complexité irré
ductible, il
faudra recourir à des principes intrinsèques, qui
seront ici, non plus telle matière déjà déterminée (marbre) et
telle forme accidentelle (Mercure), mais purement et simplement
ce
qu'on appelle matière première (ou matière absolument indé
terminée)
et forme substantielle (c'est-à-dire principe premier.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Hylémorphisme (analyse et critique) - A partir de la Métaphysique d'Aristote)
- Définition: HYLÉMORPHISME.