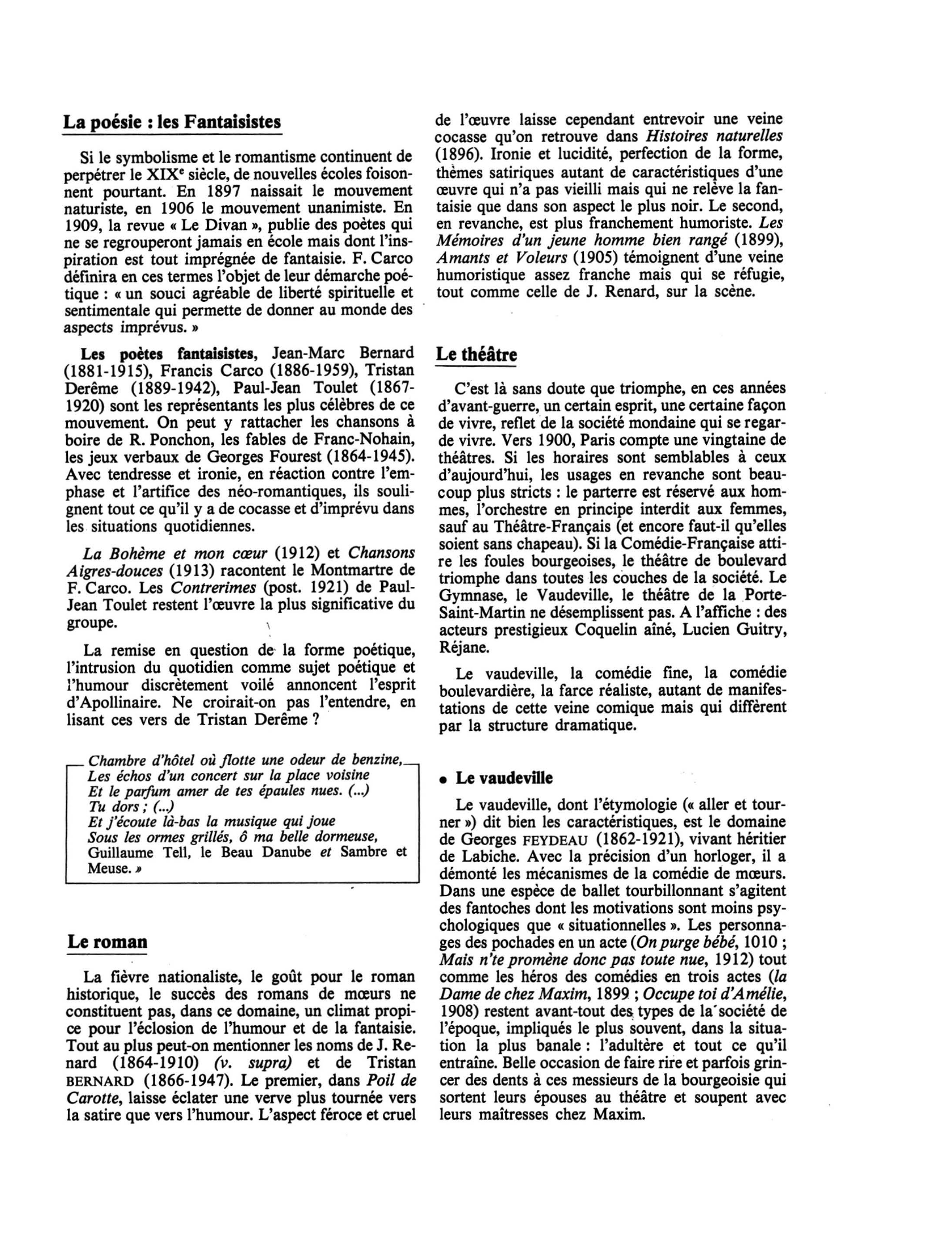L'HUMOUR AVANT 1914 EN LITTÉRATURE
Publié le 21/11/2011
Extrait du document
La poésie :les Fantaisistes
Si le symbolisme et le romantisme continuent de perpétrer le XIXe siècle, de nouvelles écoles foisonnent pourtant. En 1897 naissait le mouvement naturiste, en 1906 le mouvement unanimiste. En 1909, la revue« Le Divan«, publie des poètes qui ne se regrouperont jamais en école mais dont l'inspiration est tout imprégnée de fantaisie. F. Carco définira en ces termes l'objet de leur démarche poétique : « un souci agréable de liberté spirituelle et sentimentale qui permette de donner au monde des aspects imprévus. «
«
La poésie :les Fantaisistes
Si le symbolisme et le romantisme continuent de perpétrer le XIX• siècle, de nouvelles écoles foison
nent pourtant.
En 1897 naissait le mouvement
naturiste, en 1906 le mouvement unanimiste.
En 1909, la revue« Le Divan», publie des poètes qui ne se regrouperont jamais en école mais dont l'ins
piration est tout imprégnée de fantaisie.
F.
Carco
définira en ces termes l'objet de leur démarche poé
tique :
« un souci agréable de liberté spirituelle et
sentimentale qui permette de donner au monde des aspects imprévus.
»
Les poètes fantaisistes, Jean-Marc Bernard (1881-1915), Francis Carco (1886-1959), Tristan
Derême (1889-1942), Paul-Jean Toulet (1867- 1920) sont les représentants les plus célèbres de ce mouvement.
On peut y rattacher les chansons à
boire de R.
Ponchon, les fables de Franc-Nohain,
les jeux verbaux de Georges Fourest (1864-1945).
Avec tendresse et ironie, en réaction contre l'em
phase et l'artifice des néo-romantiques, ils souli
gnent tout
ce qu'il y a de cocasse et d'imprévu dans les situations quotidiennes.
La Bohème et mon cœur
(1912) et Chansons
Aigres-douces (1913) racontent le Montmartre de F.
Carco.
Les Contrerimes (post.
1921) de Paul
Jean Toulet restent l'œuvre la plus significative du groupe.
La remise en question
de· la forme poétique,
l'intrusion du quotidien comme sujet poétique et
l'humour discrètement voilé annoncent l'esprit
d'Apollinaire.
Ne croirait-on pas l'entendre, en
lisant ces vers de Tristan Derême
?
Chambre d'hôtel où flotte une odeur de benzine,
Les échos d'un concert sur la place voisine
Et le parfum amer de tes épaules nues.
( ...
) Tu dors; ( ..
J Et j'écoute là-bas la musique qui joue
Sous les ormes grillés, ô ma belle dormeuse,
Guillaume Tell, le Beau Danube et Sambre et Meuse ...
Le roman
La fièvre nationaliste, le goût pour le roman
historique, le succès des romans de mœurs ne constituent pas, dans ce domaine, un climat propice pour l'éclosion de l'humour et de la fantaisie.
Tout au plus peut-on mentionner les noms de J.
Re nard (1864-1910) (v.
supra) et de Tristan BERNARD (1866-1947).
Le premier, dans Poil de Carotte, laisse éclater une verve plus tournée vers
la satire que vers l'humour.
L'aspect féroce et cruel
de l'œuvre laisse cependant entrevoir une veine
cocasse qu'on retrouve dans Histoires naturelles
(1896).
Ironie et lucidité, perfection de la forme,
thèmes satiriques autant
de caractéristiques d'une
œuvre qui n'a pas vieilli mais qui ne relève la fan
taisie que dans son aspect le plus noir.
Le second, en revanche, est plus franchement humoriste.
Les
Mémoires d'un jeune homme bien rangé (1899), Amants et Voleurs (1905) témoignent d'une veine
humoristique assez franche mais qui se réfugie,
tout comme celle de J.
Renard, sur la scène.
Le théâtre
C'est là sans doute que triomphe, en ces années
d'avant-guerre, un certain esprit, une certaine façon
de vivre, reflet de la société mondaine qui se regar de vivre.
Vers 1900, Paris compte une vingtaine de
théâtres.
Si les horaires sont semblables à ceux
d'aujourd'hui, les usages en revanche sont beau
coup plus stricts :
le parterre est réservé aux hom mes, l'orchestre en principe interdit aux femmes,
sauf au Théâtre-Français (et encore faut-il qu'elles
soient sans chapeau).
Si la Comédie-Française atti
re les foules bourgeoises, le théâtre de boulevard
triomphe dans toutes les couches de la ~ociété.
Le
Gymnase, le Vaudeville, le théâtre de la .Porte
Saint-Martin ne désemplissent pas.
A l'affiche :des acteurs prestigieux Coquelin aîné, Lucien Guitry,
Réjane.
Le vaudeville, la comédie fme, la comédie
boulevardière, la farce réaliste, autant de manifes
tations
de cette veine comique mais qui diffèrent
par la structure dramatique.
• Le vaudeville
Le vaudeville, dont l'étymologie («aller et tour
ner ») dit bien les caractéristiques, est le domaine de Georges FEYDEAU (1862-1921), vivant héritier de Labiche.
Avec la précision d'un horloger, il a
démonté les mécanismes de la comédie de mœurs.
Dans une espèce de ballet tourbillonnant s'agitent
des fantoches dont les motivations sont moins psy
chologiques que « situationnelles ».
Les personna ges des pochades en un acte (On purge bébé, 10 10 ;
Mais n'te promène donc pas toute nue, 1912) tout
comme les héros des comédies en trois actes (la
Dame de chez Maxim, 1899 ; Occupe toi d'Amélie, 1908) restent avant-tout de~ types de la" société de
l'époque, impliqués le plus souvent, dans la situa
tion la plus banale : l'adultère et tout ce qu'il
entraîne.
Belle occasion de faire rire et parfois grin
cer des dents à ces messieurs de la bourgeoisie qui
sortent leurs épouses au théâtre et soupent avec
leurs maîtresses chez Maxim..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bioy Casares Adolfo , né en 1914 à Buenos Aires, auteur argentin de littérature fantastique.
- Les prix Nobel de littérature de 1901 à 1914 (littérature)
- LA SCIENCE FICTION EN FRANCE DEPUIS 1914 (HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE)
- LITTÉRATURE DU XX (20)e SIÈCLE Tournants avant 1914 (histoire littéraire)
- LA POÉSIE ANGLAISE de 1880 à 1914 - Littérature