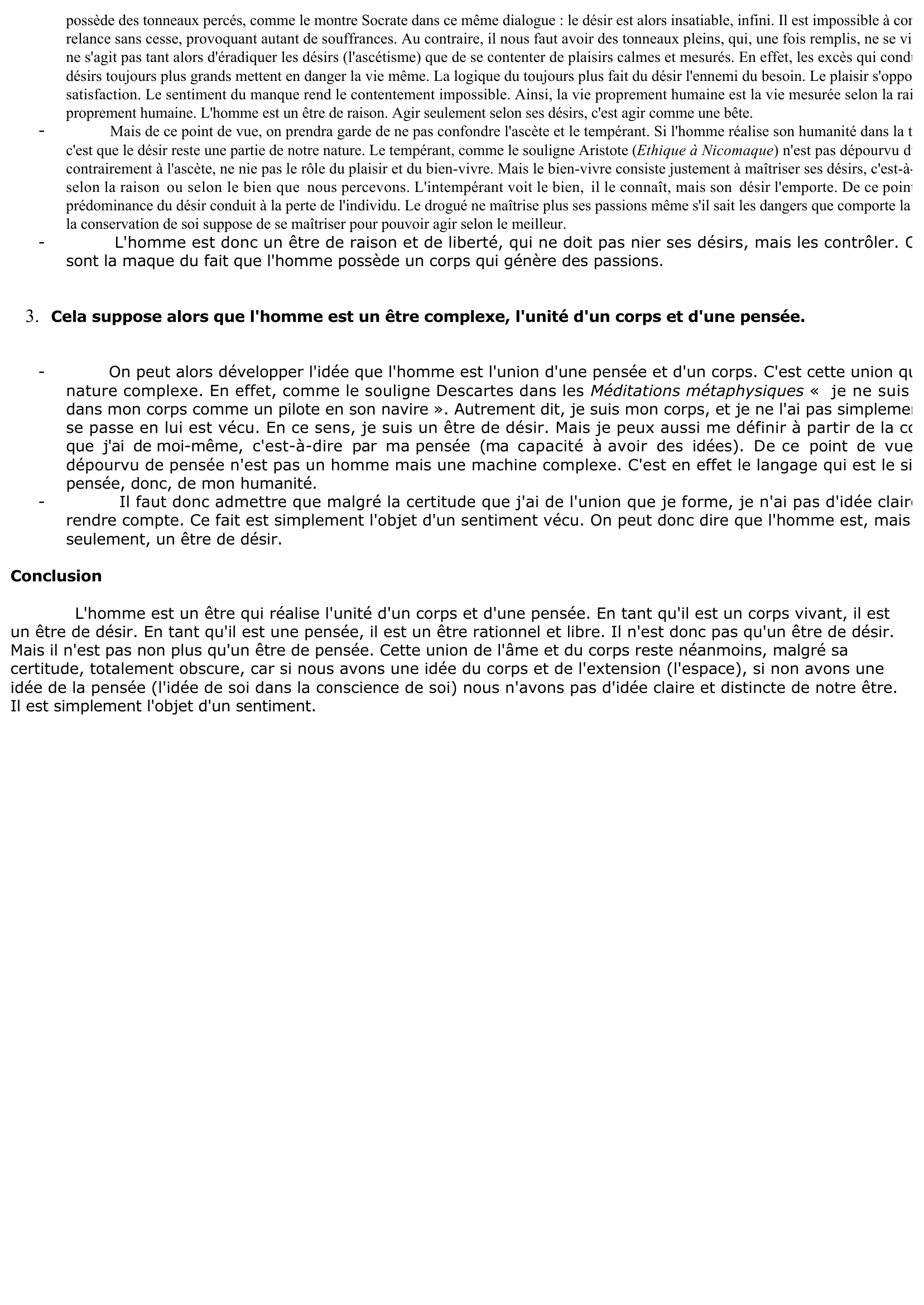L'homme est-il être de désirs?
Publié le 16/08/2005
Extrait du document
L’homme est tout d’abord un être vivant, et toute vie se caractérise par un certain type de mouvement, qui, contrairement au mouvement non vivant, tient sa force de l'intérieur de l'agent, et non de l'extérieur. Ainsi, la notion de cellule renvoie par exemple à l'idée d'une distinction entre l'extérieur de la cellule, et son intérieur. Le mouvement mécanique, par opposition au mouvement vivant, n'est pas spontané mais provoqué. De ce point de vue, il semble que cette force que constitue le l’être humain vivant doive s'appréhender à travers le concept de désir, tendance spontanée orientée vers une fin. Dès lors, il paraît difficile d'accorder qu'un homme puisse être tel sans désir. L’homme serait donc un être de désir. Mais d'un autre côté, le désir peut aller contre une autre spécificité de l’homme : sa rationalité. En effet, l’homme est aussi l’être libre qui peut limiter ses désirs et agir selon son devoir. Une vie humaine suppose de sacrifier certaines impulsions morbides. Si l’homme n’était qu’être de désir, il serait alors proprement inhumain. Le problème est donc de savoir quelle place le désir doit tenir dans la nature et la réalité humaine : faut-il dire que l’homme est un être de désirs, au motif que sans désir l’être humain perd sa vitalité ? Ou bien faut-il admettre que le désir est la source de l’inhumanité de l’homme, ce qui s’oppose à sa liberté et à sa rationalité ?
«
possède des tonneaux percés, comme le montre Socrate dans ce même dialogue : le désir est alors insatiable, infini.
Il est impossible à contenter, il serelance sans cesse, provoquant autant de souffrances.
Au contraire, il nous faut avoir des tonneaux pleins, qui, une fois remplis, ne se vident plus.
Ilne s'agit pas tant alors d'éradiquer les désirs (l'ascétisme) que de se contenter de plaisirs calmes et mesurés.
En effet, les excès qui conduisent à desdésirs toujours plus grands mettent en danger la vie même.
La logique du toujours plus fait du désir l'ennemi du besoin.
Le plaisir s'oppose alors à lasatisfaction.
Le sentiment du manque rend le contentement impossible.
Ainsi, la vie proprement humaine est la vie mesurée selon la raison, facultéproprement humaine.
L'homme est un être de raison.
Agir seulement selon ses désirs, c'est agir comme une bête. - Mais de ce point de vue, on prendra garde de ne pas confondre l'ascète et le tempérant.
Si l'homme réalise son humanité dans la tempérance, c'est que le désir reste une partie de notre nature.
Le tempérant, comme le souligne Aristote ( Ethique à Nicomaque ) n'est pas dépourvu du désirs, et, contrairement à l'ascète, ne nie pas le rôle du plaisir et du bien-vivre.
Mais le bien-vivre consiste justement à maîtriser ses désirs, c'est-à-dire à vivreselon la raison ou selon le bien que nous percevons.
L'intempérant voit le bien, il le connaît, mais son désir l'emporte.
De ce point de vue, laprédominance du désir conduit à la perte de l'individu.
Le drogué ne maîtrise plus ses passions même s'il sait les dangers que comporte la drogue.
Or,la conservation de soi suppose de se maîtriser pour pouvoir agir selon le meilleur. - L'homme est donc un être de raison et de liberté, qui ne doit pas nier ses désirs, mais les contrôler.
Ces désirs sont la maque du fait que l'homme possède un corps qui génère des passions. Cela suppose alors que l'homme est un être complexe, l'unité d'un corps et d'une pensée. 3.
- On peut alors développer l'idée que l'homme est l'union d'une pensée et d'un corps.
C'est cette union qui rend sa nature complexe.
En effet, comme le souligne Descartes dans les Méditations métaphysiques « je ne suis pas logé dans mon corps comme un pilote en son navire ».
Autrement dit, je suis mon corps, et je ne l'ai pas simplement.
Ce quise passe en lui est vécu.
En ce sens, je suis un être de désir.
Mais je peux aussi me définir à partir de la conscienceque j'ai de moi-même, c'est-à-dire par ma pensée (ma capacité à avoir des idées).
De ce point de vue, un êtredépourvu de pensée n'est pas un homme mais une machine complexe.
C'est en effet le langage qui est le signe de lapensée, donc, de mon humanité. - Il faut donc admettre que malgré la certitude que j'ai de l'union que je forme, je n'ai pas d'idée claire pour en rendre compte.
Ce fait est simplement l'objet d'un sentiment vécu.
On peut donc dire que l'homme est, mais n'est passeulement, un être de désir. Conclusion L'homme est un être qui réalise l'unité d'un corps et d'une pensée.
En tant qu'il est un corps vivant, il estun être de désir.
En tant qu'il est une pensée, il est un être rationnel et libre.
Il n'est donc pas qu'un être de désir.Mais il n'est pas non plus qu'un être de pensée.
Cette union de l'âme et du corps reste néanmoins, malgré sacertitude, totalement obscure, car si nous avons une idée du corps et de l'extension (l'espace), si non avons uneidée de la pensée (l'idée de soi dans la conscience de soi) nous n'avons pas d'idée claire et distincte de notre être.Il est simplement l'objet d'un sentiment..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Est-il vertueux d’accomplir tous ces désirs ? Sous quelles conditions la satisfaction de tous ses désirs peut-elle amener l’homme à suivre une vie heureuse et morale ?
- L'homme doit-il se laisser aller à ses désirs et passions ?
- « Expliquez et discutez ce texe de Coménius : « Nous désirons que ce ne soient pas seulement quelques hommes qui puissent être instruits encyclo-pédiquement mais, tous les hommes. Et qu'ils soient instruits, non seulement de ce qu'on peut savoir, mals aussi de ce qu'il faut faire et expliquer par la parole. Nous désirons qu'ils se distinguent le plus possible des animaux, justement par les dons qui les différen¬cient d'eux, c'est-à-dire par la raison, la parole et la liberté d'agir...
- Faut- il alors vraiment renoncer au désir ou bien l'homme ne peut vivre sans et doit apprendre à contrôler ses désirs ?
- L'homme est-il esclave de ses désirs ?