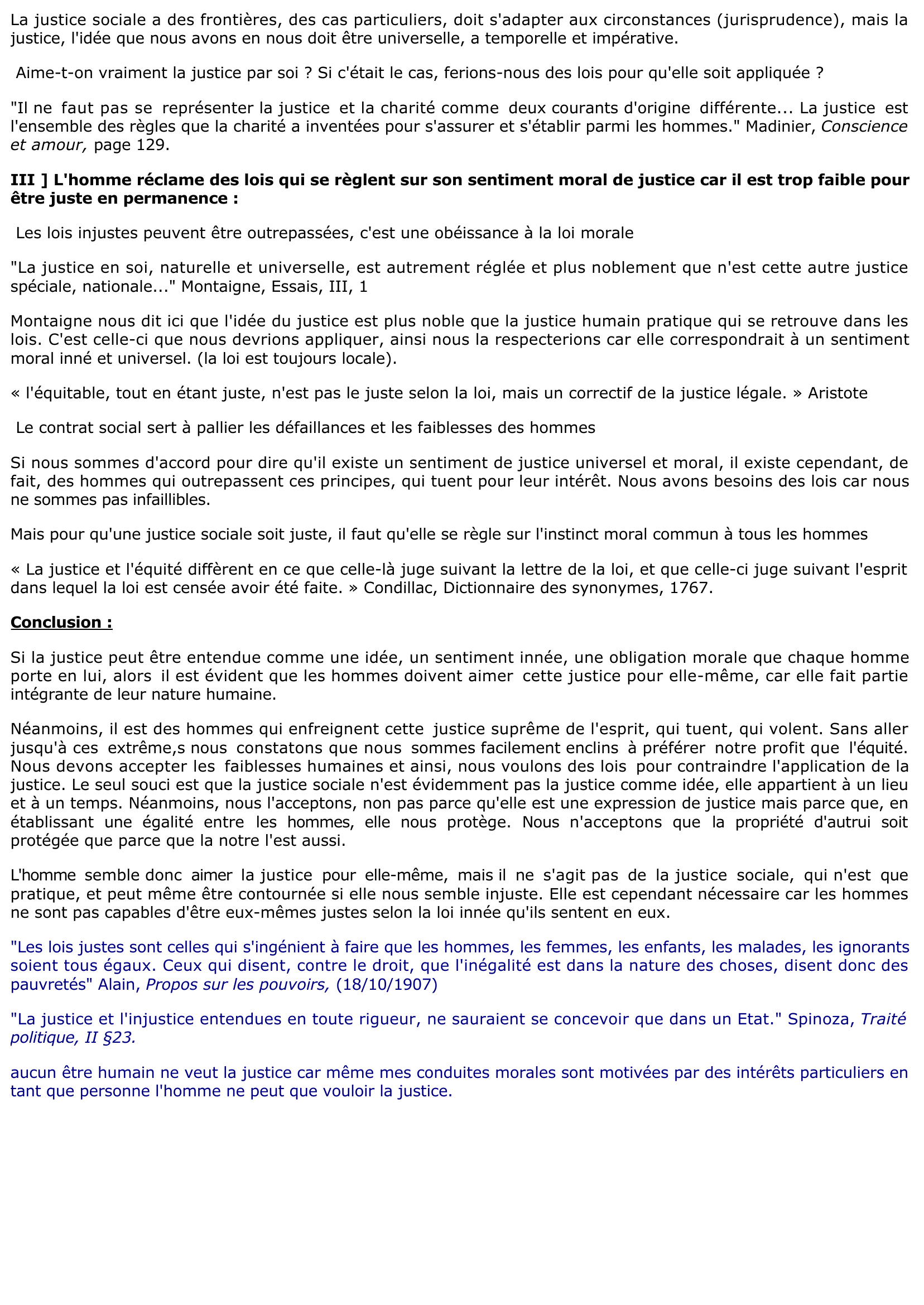l'homme aime-t-il la justice pour elle-même ?
Publié le 21/11/2005
Extrait du document

HTML clipboard
Le sujet pose comme thèse que l'homme aime la justice. En effet, comment pourrait-il en être autrement ? La justice est un principe qui fonde l'égalité entre tous, or il est moral de considérer son prochain comme soi-même. Ce pendant, ne serait-il pas hypocrite d'affirmer que c'est pour cette raison que l'homme aime la justice ? N'est-ce pas plutôt parce que la justice le protège lui-même ? En effet, l'homme est égoïste et son propre sort l'intéresse bien davantage que celui de son prochain. Néanmoins, la justice reste universelle, et s'applique à tous, et on demeure outré lorsque sont bafoués des principes élémentaires de justice. A ce titre, nous pouvons nous demander si nous aimons la justice pour elle-même, en tant qu'idée, concept, ou bien si ce que nous aimons, ce sont ses applications pratiques.
Enfin, il faudra faire attention à distinguer la justice comme concept de la justice que nous connaissons dans la réel, et qui s'exprime dans la loi.

«
La justice sociale a des frontières, des cas particuliers, doit s'adapter aux circonstances (jurisprudence), mais lajustice, l'idée que nous avons en nous doit être universelle, a temporelle et impérative.
Aime-t-on vraiment la justice par soi ? Si c'était le cas, ferions-nous des lois pour qu'elle soit appliquée ?
"Il ne faut pas se représenter la justice et la charité comme deux courants d'origine différente...
La justice estl'ensemble des règles que la charité a inventées pour s'assurer et s'établir parmi les hommes." Madinier, Conscience et amour, page 129.
III ] L'homme réclame des lois qui se règlent sur son sentiment moral de justice car il est trop faible pourêtre juste en permanence :
Les lois injustes peuvent être outrepassées, c'est une obéissance à la loi morale
"La justice en soi, naturelle et universelle, est autrement réglée et plus noblement que n'est cette autre justicespéciale, nationale..." Montaigne, Essais, III, 1
Montaigne nous dit ici que l'idée du justice est plus noble que la justice humain pratique qui se retrouve dans leslois.
C'est celle-ci que nous devrions appliquer, ainsi nous la respecterions car elle correspondrait à un sentimentmoral inné et universel.
(la loi est toujours locale).
« l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale.
» Aristote
Le contrat social sert à pallier les défaillances et les faiblesses des hommes
Si nous sommes d'accord pour dire qu'il existe un sentiment de justice universel et moral, il existe cependant, defait, des hommes qui outrepassent ces principes, qui tuent pour leur intérêt.
Nous avons besoins des lois car nousne sommes pas infaillibles.
Mais pour qu'une justice sociale soit juste, il faut qu'elle se règle sur l'instinct moral commun à tous les hommes
« La justice et l'équité diffèrent en ce que celle-là juge suivant la lettre de la loi, et que celle-ci juge suivant l'espritdans lequel la loi est censée avoir été faite.
» Condillac, Dictionnaire des synonymes, 1767.
Conclusion :
Si la justice peut être entendue comme une idée, un sentiment innée, une obligation morale que chaque hommeporte en lui, alors il est évident que les hommes doivent aimer cette justice pour elle-même, car elle fait partieintégrante de leur nature humaine.
Néanmoins, il est des hommes qui enfreignent cette justice suprême de l'esprit, qui tuent, qui volent.
Sans allerjusqu'à ces extrême,s nous constatons que nous sommes facilement enclins à préférer notre profit que l'équité.Nous devons accepter les faiblesses humaines et ainsi, nous voulons des lois pour contraindre l'application de lajustice.
Le seul souci est que la justice sociale n'est évidemment pas la justice comme idée, elle appartient à un lieuet à un temps.
Néanmoins, nous l'acceptons, non pas parce qu'elle est une expression de justice mais parce que, enétablissant une égalité entre les hommes, elle nous protège.
Nous n'acceptons que la propriété d'autrui soitprotégée que parce que la notre l'est aussi.
L'homme semble donc aimer la justice pour elle-même, mais il ne s'agit pas de la justice sociale, qui n'est quepratique, et peut même être contournée si elle nous semble injuste.
Elle est cependant nécessaire car les hommesne sont pas capables d'être eux-mêmes justes selon la loi innée qu'ils sentent en eux.
"Les lois justes sont celles qui s'ingénient à faire que les hommes, les femmes, les enfants, les malades, les ignorantssoient tous égaux.
Ceux qui disent, contre le droit, que l'inégalité est dans la nature des choses, disent donc despauvretés" Alain, Propos sur les pouvoirs, (18/10/1907)
"La justice et l'injustice entendues en toute rigueur, ne sauraient se concevoir que dans un Etat." Spinoza, Traité politique, II §23.
aucun être humain ne veut la justice car même mes conduites morales sont motivées par des intérêts particuliers entant que personne l'homme ne peut que vouloir la justice..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le principe fondamental de toute morale […] est que l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre ; qu'il n'y a point de perversité originelle dans le coeur humain, et que les premiers mouvement de la nature sont toujours droits […]. Dans cet état [de nature] l'homme ne connaît que lui ; il ne voit opposé ni conforme à celui de personne ; il ne hait ni n'aime rien ; borné au seul instinct physique, [l'homme] est nul, il est bête : c'est ce que j'ai fait voir dans
- Discuter cette pensée de Rousseau : « J’aime mieux être un homme à paradoxes qu’un homme à préjugés. « (Émile.)
- Discutez ce jugement : « L'homme fait la beauté de ce qu'il aime »
- Peut-on parler d'une exigence de justice dans les rapports économiques sans parler de justice dans les rapports économiques 7 Ou en d'autres termes : à quel niveau doit-on penser les rapports de la justice à l'économie : celui du fait ou celui du droit ? Quel statut faut-il donc y accorder à l'homme ?
- ROUHER, Eugène (1814-1888) Homme politique, il est nommé deux fois ministre de la Justice de 1849 à 1852.