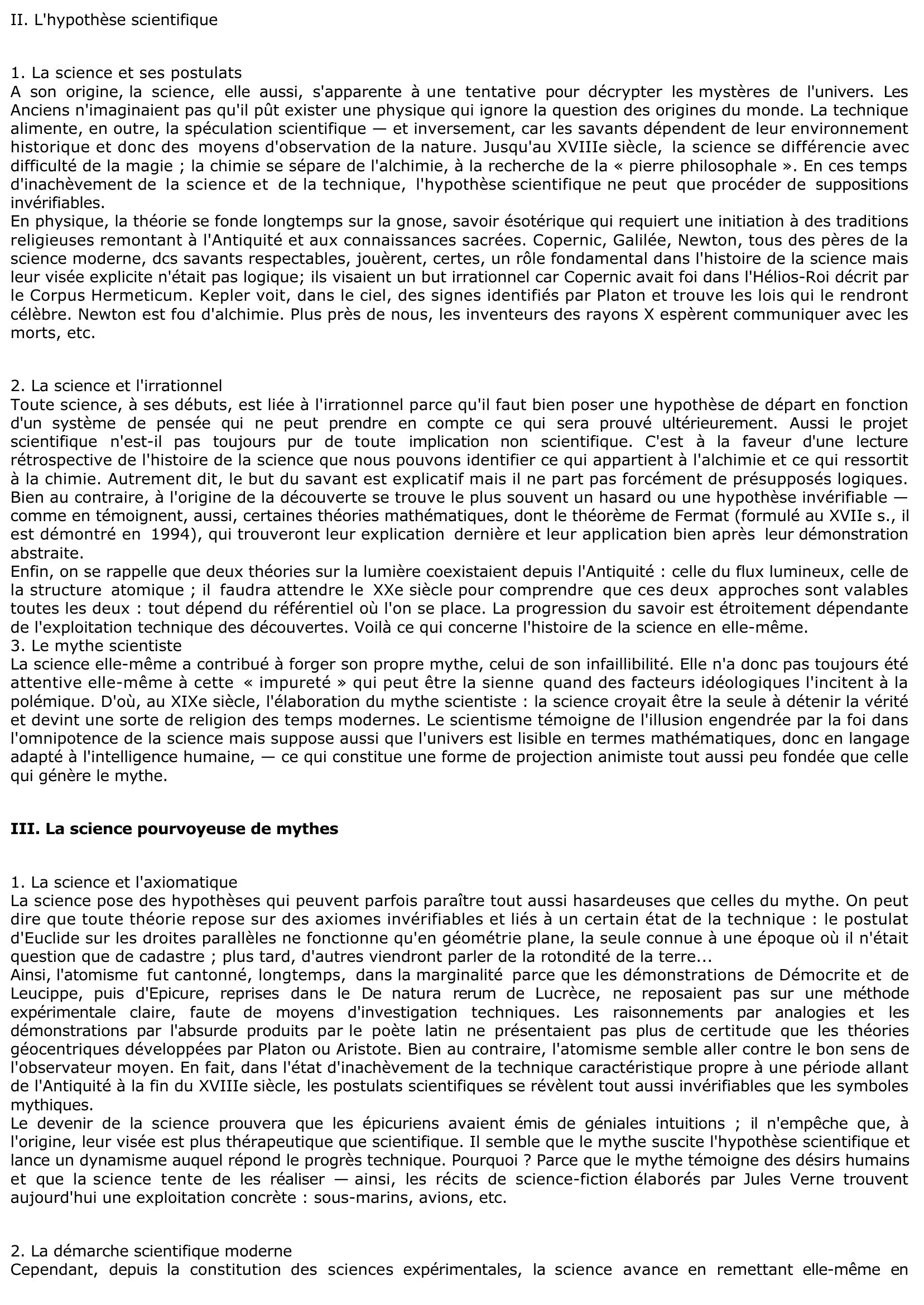"L'histoire de la science est inséparable des mythes qui l'accompagnent et semblent la contredire" (Jean-Paul Dollé)
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
II.
L'hypothèse scientifique
1.
La science et ses postulatsA son origine, la science, elle aussi, s'apparente à une tentative pour décrypter les mystères de l'univers.
LesAnciens n'imaginaient pas qu'il pût exister une physique qui ignore la question des origines du monde.
La techniquealimente, en outre, la spéculation scientifique — et inversement, car les savants dépendent de leur environnementhistorique et donc des moyens d'observation de la nature.
Jusqu'au XVIIIe siècle, la science se différencie avecdifficulté de la magie ; la chimie se sépare de l'alchimie, à la recherche de la « pierre philosophale ».
En ces tempsd'inachèvement de la science et de la technique, l'hypothèse scientifique ne peut que procéder de suppositionsinvérifiables.En physique, la théorie se fonde longtemps sur la gnose, savoir ésotérique qui requiert une initiation à des traditionsreligieuses remontant à l'Antiquité et aux connaissances sacrées.
Copernic, Galilée, Newton, tous des pères de lascience moderne, dcs savants respectables, jouèrent, certes, un rôle fondamental dans l'histoire de la science maisleur visée explicite n'était pas logique; ils visaient un but irrationnel car Copernic avait foi dans l'Hélios-Roi décrit parle Corpus Hermeticum.
Kepler voit, dans le ciel, des signes identifiés par Platon et trouve les lois qui le rendrontcélèbre.
Newton est fou d'alchimie.
Plus près de nous, les inventeurs des rayons X espèrent communiquer avec lesmorts, etc.
2.
La science et l'irrationnelToute science, à ses débuts, est liée à l'irrationnel parce qu'il faut bien poser une hypothèse de départ en fonctiond'un système de pensée qui ne peut prendre en compte ce qui sera prouvé ultérieurement.
Aussi le projetscientifique n'est-il pas toujours pur de toute implication non scientifique.
C'est à la faveur d'une lecturerétrospective de l'histoire de la science que nous pouvons identifier ce qui appartient à l'alchimie et ce qui ressortità la chimie.
Autrement dit, le but du savant est explicatif mais il ne part pas forcément de présupposés logiques.Bien au contraire, à l'origine de la découverte se trouve le plus souvent un hasard ou une hypothèse invérifiable —comme en témoignent, aussi, certaines théories mathématiques, dont le théorème de Fermat (formulé au XVIIe s., ilest démontré en 1994), qui trouveront leur explication dernière et leur application bien après leur démonstrationabstraite.Enfin, on se rappelle que deux théories sur la lumière coexistaient depuis l'Antiquité : celle du flux lumineux, celle dela structure atomique ; il faudra attendre le XXe siècle pour comprendre que ces deux approches sont valablestoutes les deux : tout dépend du référentiel où l'on se place.
La progression du savoir est étroitement dépendantede l'exploitation technique des découvertes.
Voilà ce qui concerne l'histoire de la science en elle-même.3.
Le mythe scientisteLa science elle-même a contribué à forger son propre mythe, celui de son infaillibilité.
Elle n'a donc pas toujours étéattentive elle-même à cette « impureté » qui peut être la sienne quand des facteurs idéologiques l'incitent à lapolémique.
D'où, au XIXe siècle, l'élaboration du mythe scientiste : la science croyait être la seule à détenir la véritéet devint une sorte de religion des temps modernes.
Le scientisme témoigne de l'illusion engendrée par la foi dansl'omnipotence de la science mais suppose aussi que l'univers est lisible en termes mathématiques, donc en langageadapté à l'intelligence humaine, — ce qui constitue une forme de projection animiste tout aussi peu fondée que cellequi génère le mythe.
III.
La science pourvoyeuse de mythes
1.
La science et l'axiomatiqueLa science pose des hypothèses qui peuvent parfois paraître tout aussi hasardeuses que celles du mythe.
On peutdire que toute théorie repose sur des axiomes invérifiables et liés à un certain état de la technique : le postulatd'Euclide sur les droites parallèles ne fonctionne qu'en géométrie plane, la seule connue à une époque où il n'étaitquestion que de cadastre ; plus tard, d'autres viendront parler de la rotondité de la terre...Ainsi, l'atomisme fut cantonné, longtemps, dans la marginalité parce que les démonstrations de Démocrite et deLeucippe, puis d'Epicure, reprises dans le De natura rerum de Lucrèce, ne reposaient pas sur une méthodeexpérimentale claire, faute de moyens d'investigation techniques.
Les raisonnements par analogies et lesdémonstrations par l'absurde produits par le poète latin ne présentaient pas plus de certitude que les théoriesgéocentriques développées par Platon ou Aristote.
Bien au contraire, l'atomisme semble aller contre le bon sens del'observateur moyen.
En fait, dans l'état d'inachèvement de la technique caractéristique propre à une période allantde l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, les postulats scientifiques se révèlent tout aussi invérifiables que les symbolesmythiques.Le devenir de la science prouvera que les épicuriens avaient émis de géniales intuitions ; il n'empêche que, àl'origine, leur visée est plus thérapeutique que scientifique.
Il semble que le mythe suscite l'hypothèse scientifique etlance un dynamisme auquel répond le progrès technique.
Pourquoi ? Parce que le mythe témoigne des désirs humainset que la science tente de les réaliser — ainsi, les récits de science-fiction élaborés par Jules Verne trouventaujourd'hui une exploitation concrète : sous-marins, avions, etc.
2.
La démarche scientifique moderneCependant, depuis la constitution des sciences expérimentales, la science avance en remettant elle-même en.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Jules Dumont d'Urville par Jean-Paul Faivre Professeur agrégé d'histoire.
- Jean Corvisart par Paul Delaunay Membre du Comité international d'histoire des sciences, Le Mans Jean-Nicolas Corvisart des Marets naquit le 15 février 1755 à Dricourt.
- L'histoire de l'Eglise de Vatican II à Jean-Paul II
- l'Histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Variété, Discours de l'histoire Valéry, Paul. Commentez cette citation.
- « La frontière qui sépare l'histoire et la science n'est pas celle du contingent et du nécessaire, mais celle du tout et du nécessaire. » Paul Veyne, «L'histoire conceptualisante», in Faire de l'histoire, 1974. Commentez cette citation.