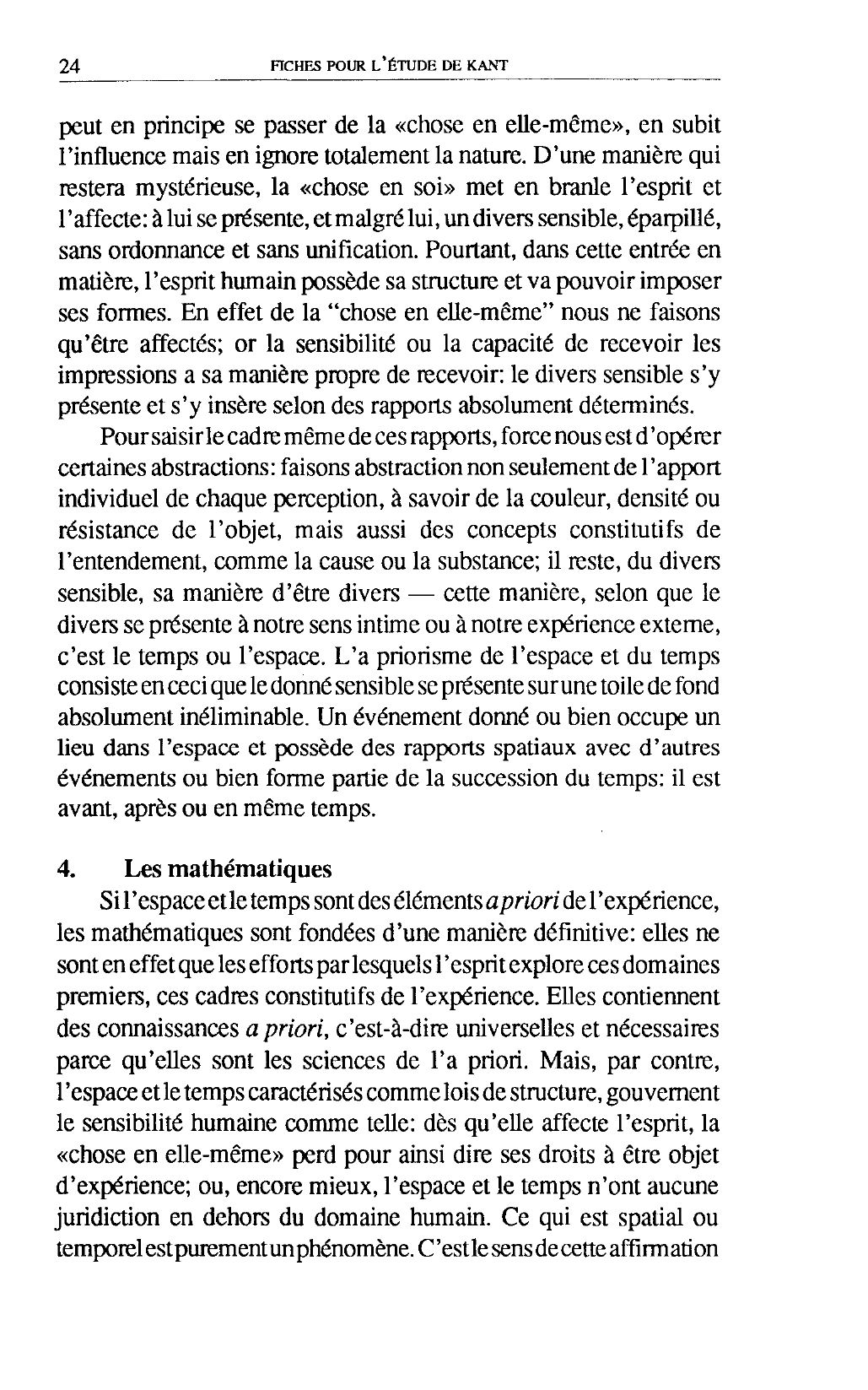Les positions spéculatives de Kant
Publié le 04/07/2015
Extrait du document

Les positions spéculatives de Kant
Deux réalités s'imposent de très bonne heure à l'esprit de Kant: la science physique et mathématique, d'une part; la réalité du devoir, comme fondement de la vie morale d'autre part. L'effort philosophique de Kant va consister à reprendre, à repenser d'une manière à la fois originale et systématique ces deux certitudes premières. Comment interpréter ces deux valeurs de telle manière qu'en les acceptant, on évite à la fois et le danger du scepticisme destructeur et la confusion du sentimentalisme et de l'empirisme? Comment sauvegarder les droits de l'expérience scientifique et morale en soumettant l'esprit à l'examen le plus sévère qui soit? La philosophie de Kant est par conséquent une recherche des fondements de la connaissance scientifique et de la pensée morale prises comme certitudes; en somme une philosophie de la réflexion, non de la description, ni de la découverte.
Que l'on suive la Critique ou les Prolégomènes, les résultats et l'esprit de la recherche Kantienne sont les mêmes: analyser la connaissance sensible actuelle et la connaissance conceptuelle en leurs éléments permanents, en leurs éléments de structure; au-delà de l'expérience et à sa base, chercher ce qui lui est logiquement antérieur et lui donner sa valeur; dans les sciences mathématiques et physiques et dans la métaphysique, déterminer, mettre au clair les principes constitutifs ou régulateurs; et en plaçant ces principes à leurs niveaux propres, signaler la marche de l'esprit, ses procédés, sa conduite.

«
24 FICHES POUR L'ÉTUDE DE KANT
peut en principe se passer de la «chose en elle-même», en subit
1 'influence
mais en ignore totalement la nature.
D'une manière qui
restera mystérieuse, la «chose en soi» met en branle l'esprit et
1 'affecte: à
lui se présente, et malgré lui, un divers sensible, éparpillé,
sans ordonnance et sans unification.
Pourtant, dans cette entrée en
matière, l'esprit humain possède
sa structure et va pouvoir imposer
ses formes.
En effet de la "chose en elle-même" nous ne faisons
qu'être affectés; or la sensibilité ou la capacité de recevoir les
impressions a sa manière propre de recevoir: le divers sensible s'y
présente et s'y
insère selon des rapports absolument déterminés.
Pour saisir le cadre même de ces rapports, force nous est d'opérer
certaines abstractions:
faisons abstraction non seulement de 1 'apport
individuel
de chaque perception, à savoir de la couleur, densité ou
résistance de l'objet, mais aussi des concepts constitutifs de
l'entendement, comme la cause ou la substance; il reste, du divers
sensible,
sa manière d'être divers - cette manière, selon que le
divers se présente à notre sens intime ou à notre expérience externe,
c'est
le temps ou l'espace.
L'apriorisme de l'espace et du temps
consiste en ceci que le donné sensible se présente sur une toile de fond
absolument inéliminable.
Un événement donné ou bien occupe un
lieu dans l'espace et possède des rapports spatiaux avec d'autres
événements
ou bien forme partie de la succession du temps: il est
avant, après ou en même temps.
4.
Les mathématiques
Si l'espace et le temps sont des éléments a priori de l'expérience,
les mathématiques
sont fondées d'une manière définitive: elles ne
sont en effet que les efforts par lesquels 1 'esprit explore ces domaines
premiers,
ces cadres constitutifs de 1 'expérience.
Elles contiennent
des connaissances a priori, c'est-à-dire universelles et nécessaires
parce qu'elles sont
les sciences de l'a priori.
Mais, par contre,
1 'espace et
le temps caractérisés comme lois de structure, gouvernent
le sensibilité humaine comme telle: dès qu'elle affecte l'esprit, la
«chose en elle-même» perd pour ainsi dire ses droits à être objet
d'expérience;
ou, encore mieux, l'espace et le temps n'ont aucune
juridiction
en dehors du domaine humain.
Ce qui est spatial ou
temporelestpurementunphénomène.C'estlesensdecetteafiirmation.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les positions pratiques de Kant
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?