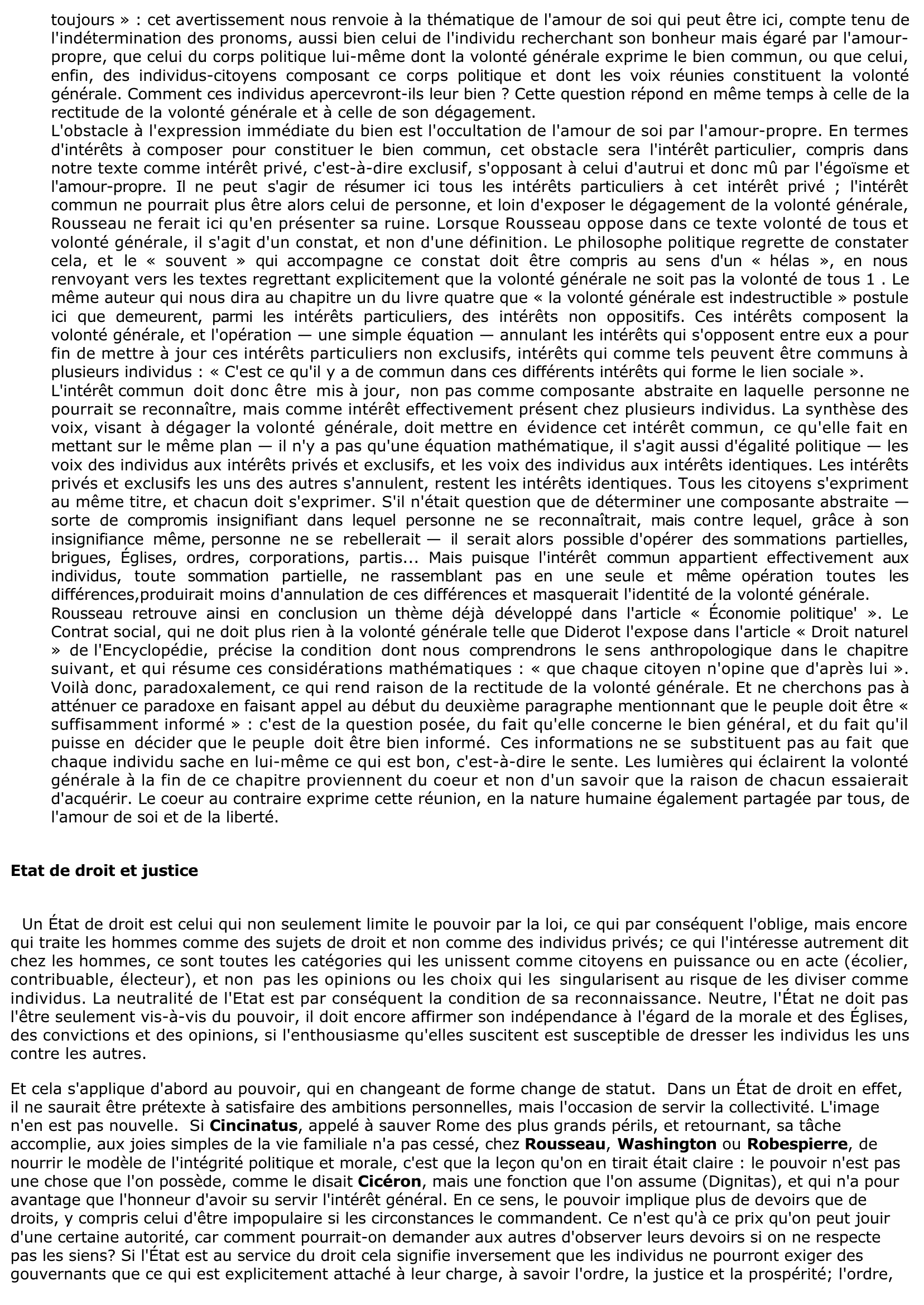Les lois sont-elles forcément justes ?
Publié le 12/03/2004
Extrait du document
Or, quand il s'agit de juger l'intérieur des hommes, et surtout celui des princes, comme on ne peut avoir recours aux tribunaux, il ne faut s'attacher qu'aux résultats : le point est de se maintenir dans son autorité ; les moyens, quels qu'ils soient, paraîtront toujours honorables, et seront loués de chacun. MACHIAVEL Les politiques le savent très bien. C'est la raison pour laquelle, au moment des élections, ils n'hésitent pas à faire des promesses qui ne seront jamais tenues. Dans une démocratie représentative, dès lors que le gouvernement est constitué et que les députés sont élus, les lois les plus injustes peuvent être votées en total respect de la constitution. Légalité ne veut pas dire justice, ni légitimité La légalité désigne le respect des lois instituées, c'est-à-dire des lois dites «positives«, qui peuvent varier en fonction des époques. Par exemple, le statut des juifs, adopté par Vichy en 1941 (qui leur interdisait notamment l'accès à la fonction publique), a été immédiatement abrogé à la Libération. La légitimité, en revanche, est d'ordre moral : il était parfaitement légal de dénoncer son voisin juif sous l'Occupation, et aussi parfaitement injuste, c'est-à-dire illégitime. La différence entre légalité et légitimité soulève en réalité la question de la justice. La justice désigne d'abord l'ensemble des institutions chargées de faire appliquer la loi, et c'est en ce sens que l'on parle de décision de justice, de palais de justice, etc. Mais elle désigne également un sentiment moral, que chacun doit éprouver, et qui peut être à l'origine de révoltes ou d'infractions à la justice dans son premier sens.
Dire que les lois sont forcément justes est une absurdité. Il n'y a pas en effet de justice en dehors des lois. La justice n'est en effet pas naturelle, mais bien l'objet d'une convention humaine.
MAIS...
L'ambiguïté des lois réside dans le fait que le droit, issu d'un rapport de forces, doit en même temps assurer le bonheur de tous les citoyens. Sans "lois des lois" (Bacon), rien ne distingue le loi de la force.
«
toujours » : cet avertissement nous renvoie à la thématique de l'amour de soi qui peut être ici, compte tenu del'indétermination des pronoms, aussi bien celui de l'individu recherchant son bonheur mais égaré par l'amour-propre, que celui du corps politique lui-même dont la volonté générale exprime le bien commun, ou que celui,enfin, des individus-citoyens composant ce corps politique et dont les voix réunies constituent la volontégénérale.
Comment ces individus apercevront-ils leur bien ? Cette question répond en même temps à celle de larectitude de la volonté générale et à celle de son dégagement.L'obstacle à l'expression immédiate du bien est l'occultation de l'amour de soi par l'amour-propre.
En termesd'intérêts à composer pour constituer le bien commun, cet obstacle sera l'intérêt particulier, compris dansnotre texte comme intérêt privé, c'est-à-dire exclusif, s'opposant à celui d'autrui et donc mû par l'égoïsme etl'amour-propre.
Il ne peut s'agir de résumer ici tous les intérêts particuliers à cet intérêt privé ; l'intérêtcommun ne pourrait plus être alors celui de personne, et loin d'exposer le dégagement de la volonté générale,Rousseau ne ferait ici qu'en présenter sa ruine.
Lorsque Rousseau oppose dans ce texte volonté de tous etvolonté générale, il s'agit d'un constat, et non d'une définition.
Le philosophe politique regrette de constatercela, et le « souvent » qui accompagne ce constat doit être compris au sens d'un « hélas », en nousrenvoyant vers les textes regrettant explicitement que la volonté générale ne soit pas la volonté de tous 1 .
Lemême auteur qui nous dira au chapitre un du livre quatre que « la volonté générale est indestructible » postuleici que demeurent, parmi les intérêts particuliers, des intérêts non oppositifs.
Ces intérêts composent lavolonté générale, et l'opération — une simple équation — annulant les intérêts qui s'opposent entre eux a pourfin de mettre à jour ces intérêts particuliers non exclusifs, intérêts qui comme tels peuvent être communs àplusieurs individus : « C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien sociale ».L'intérêt commun doit donc être mis à jour, non pas comme composante abstraite en laquelle personne nepourrait se reconnaître, mais comme intérêt effectivement présent chez plusieurs individus.
La synthèse desvoix, visant à dégager la volonté générale, doit mettre en évidence cet intérêt commun, ce qu'elle fait enmettant sur le même plan — il n'y a pas qu'une équation mathématique, il s'agit aussi d'égalité politique — lesvoix des individus aux intérêts privés et exclusifs, et les voix des individus aux intérêts identiques.
Les intérêtsprivés et exclusifs les uns des autres s'annulent, restent les intérêts identiques.
Tous les citoyens s'exprimentau même titre, et chacun doit s'exprimer.
S'il n'était question que de déterminer une composante abstraite —sorte de compromis insignifiant dans lequel personne ne se reconnaîtrait, mais contre lequel, grâce à soninsignifiance même, personne ne se rebellerait — il serait alors possible d'opérer des sommations partielles,brigues, Églises, ordres, corporations, partis...
Mais puisque l'intérêt commun appartient effectivement auxindividus, toute sommation partielle, ne rassemblant pas en une seule et même opération toutes lesdifférences,produirait moins d'annulation de ces différences et masquerait l'identité de la volonté générale.Rousseau retrouve ainsi en conclusion un thème déjà développé dans l'article « Économie politique' ».
LeContrat social, qui ne doit plus rien à la volonté générale telle que Diderot l'expose dans l'article « Droit naturel» de l'Encyclopédie, précise la condition dont nous comprendrons le sens anthropologique dans le chapitresuivant, et qui résume ces considérations mathématiques : « que chaque citoyen n'opine que d'après lui ».Voilà donc, paradoxalement, ce qui rend raison de la rectitude de la volonté générale.
Et ne cherchons pas àatténuer ce paradoxe en faisant appel au début du deuxième paragraphe mentionnant que le peuple doit être «suffisamment informé » : c'est de la question posée, du fait qu'elle concerne le bien général, et du fait qu'ilpuisse en décider que le peuple doit être bien informé.
Ces informations ne se substituent pas au fait quechaque individu sache en lui-même ce qui est bon, c'est-à-dire le sente.
Les lumières qui éclairent la volontégénérale à la fin de ce chapitre proviennent du coeur et non d'un savoir que la raison de chacun essaieraitd'acquérir.
Le coeur au contraire exprime cette réunion, en la nature humaine également partagée par tous, del'amour de soi et de la liberté.
Etat de droit et justice
Un État de droit est celui qui non seulement limite le pouvoir par la loi, ce qui par conséquent l'oblige, mais encorequi traite les hommes comme des sujets de droit et non comme des individus privés; ce qui l'intéresse autrement ditchez les hommes, ce sont toutes les catégories qui les unissent comme citoyens en puissance ou en acte (écolier,contribuable, électeur), et non pas les opinions ou les choix qui les singularisent au risque de les diviser commeindividus.
La neutralité de l'Etat est par conséquent la condition de sa reconnaissance.
Neutre, l'État ne doit pasl'être seulement vis-à-vis du pouvoir, il doit encore affirmer son indépendance à l'égard de la morale et des Églises,des convictions et des opinions, si l'enthousiasme qu'elles suscitent est susceptible de dresser les individus les unscontre les autres.
Et cela s'applique d'abord au pouvoir, qui en changeant de forme change de statut.
Dans un État de droit en effet,il ne saurait être prétexte à satisfaire des ambitions personnelles, mais l'occasion de servir la collectivité.
L'imagen'en est pas nouvelle.
Si Cincinatus , appelé à sauver Rome des plus grands périls, et retournant, sa tâche accomplie, aux joies simples de la vie familiale n'a pas cessé, chez Rousseau , Washington ou Robespierre , de nourrir le modèle de l'intégrité politique et morale, c'est que la leçon qu'on en tirait était claire : le pouvoir n'est pasune chose que l'on possède, comme le disait Cicéron , mais une fonction que l'on assume (Dignitas), et qui n'a pour avantage que l'honneur d'avoir su servir l'intérêt général.
En ce sens, le pouvoir implique plus de devoirs que dedroits, y compris celui d'être impopulaire si les circonstances le commandent.
Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut jouird'une certaine autorité, car comment pourrait-on demander aux autres d'observer leurs devoirs si on ne respectepas les siens? Si l'État est au service du droit cela signifie inversement que les individus ne pourront exiger desgouvernants que ce qui est explicitement attaché à leur charge, à savoir l'ordre, la justice et la prospérité; l'ordre,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Sommes-nous des hommes justes si l’on respecte les lois de tous les régimes qui existent sur Terre ? »
- En vertu de quoi les lois sont-elles justes ?
- A quelles conditions peut-on garantir des lois justes ?
- Suffit-il que les lois soient justes pour la justice règne ?
- Les lois ont-elles à être justes ?