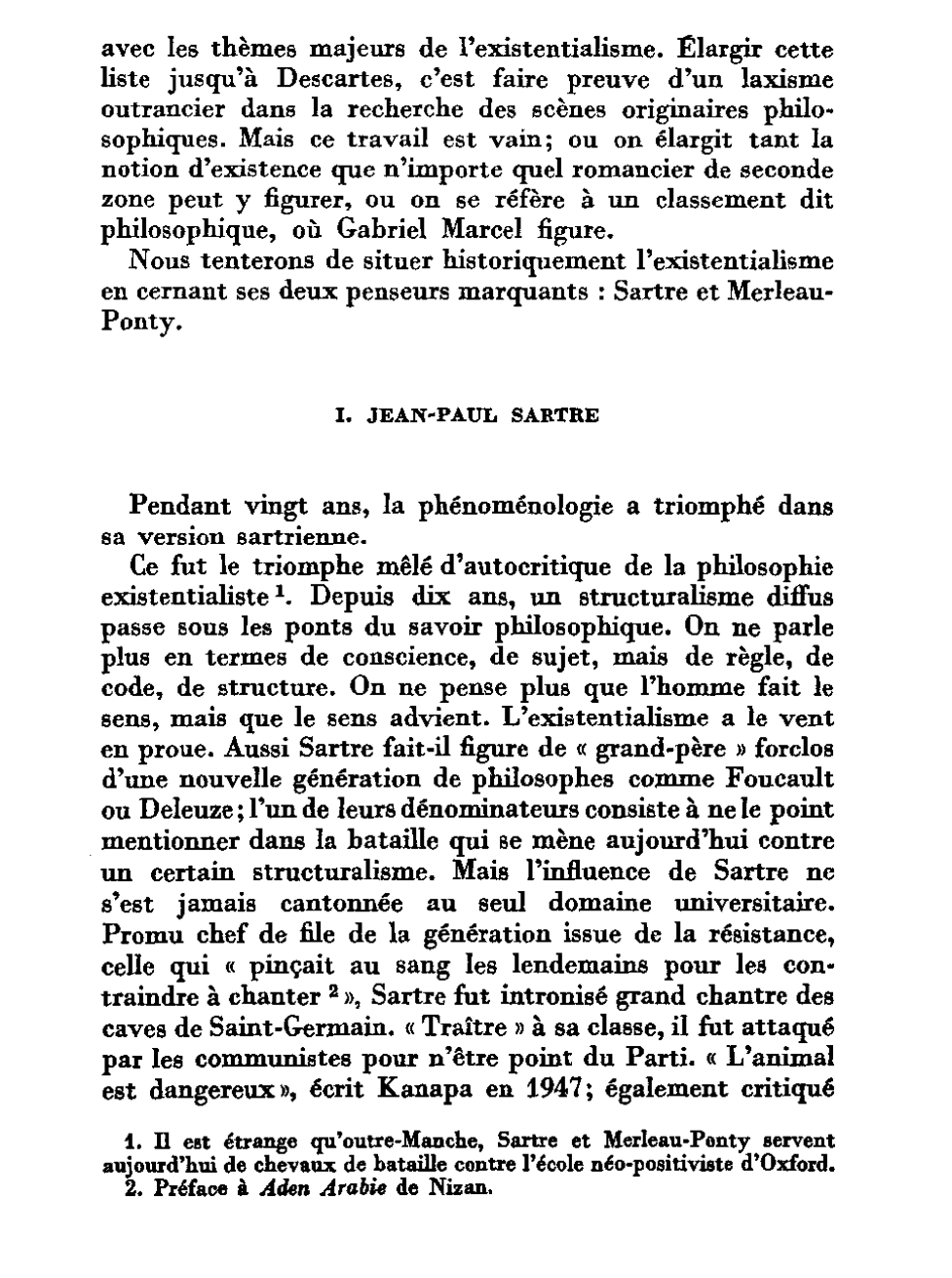LES EXISTENTIALISMES
Publié le 10/02/2015
Extrait du document
«
LES EXJSTEV71ALISMES 217
avec les thèmes majeurs de l'existentialisme.
f:Iargir cette
liste jusqu'à Descartes, c'est faire preuve d'un laxisme
outrancier dans la recherche des scènes originaires philo ..
sophiques.
Mais ce travail est vain; ou on élargit tant la
notion d'existence que n'importe quel romancier de seconde
zone peut y figurer, ou on se réfère à un classement dit
philosophique, où Gabriel Marcel figure.
Nous tenterons de situer historiquement l'existentialisme
en cernant ses deux penseurs marquants : Sartre et Merleau
Ponty.
I.
JEAN-PAUL SARTRE
Pendant vingt ans, la phénoménologie a triomphé dans
sa version sartrienne.
Ce fut le triomphe mêlé d'autocritique de la philosophie
existentialiste 1 • Depuis dix ans, un structuralisme diffus
passe sous les
ponts du savoir philosophique.
On ne parle
plus en termes de conscience, de sujet, mais de règle, de
code, de structure.
On ne pense plus que l'homme fait le
sens, mais que le sens advient.
L'existentialisme a le vent
en proue.
Aussi Sartre fait-il figure de « grand-père » forclos
d'une nouvelle génération de philosophes comme Foucault
ou Deleuze; l'un de leurs dénominateurs consiste à ne le point
mentionner dans la bataille qui se mène aujourd'hui contre
un certain structuralisme.
Mais l'influence de Sartre ne
s'est jamais cantonnée au seul domaine universitaire.
Promu chef de file de la génération issue de la résistance,
celle qui
« pinçait au sang les lendemains pour les con
traindre à chanter 2 », Sartre fut intronisé grand chantre des
caves de Saint-Germain.
« Traître » à sa classe, il fut attaqué
par les communistes pour n'être point du Parti.
« L'animal
est dangereux», écrit Kanapa en 194 7; également critiqué
1.
Il eat étrange qu'outre-Manche, Sartre et Merleau-Ponty servent aujourd'hui de chevaux de bataille contre l'école néo-positiviste d'Oxford.
2.
Préface à Aden Arabie de Nizan..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- INTRODUCTION AUX EXISTENTIALISMES, 1946. Emmanuel Mounier - résumé de l'oeuvre
- Les existentialismes
- Les existentialismes