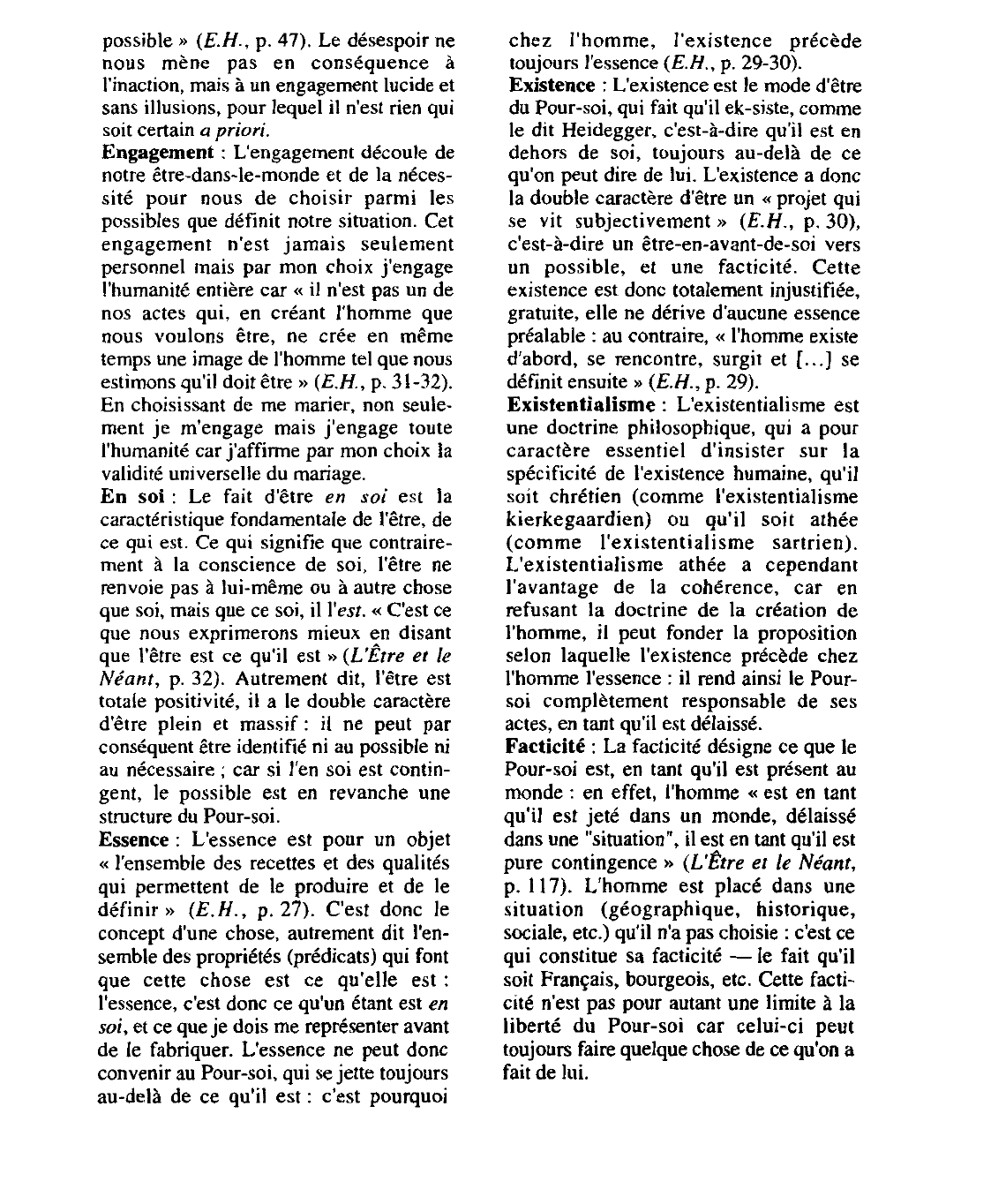Les concepts de la philosophie de Sartre
Publié le 22/03/2015
Extrait du document

Athéisme : Que Dieu n'existe pas, c'est là le principe de l'existentialisme, parce que l'athéisme est la seule doctrine qui rende possible la proposition selon laquelle chez l'homme, l'existence précède l'essence et son corollaire moral (pour l'homme, tout est possible).
Cet athéisme n'est pas spéculatif, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à démontrer que Dieu n'existe pas, mais il est pratique, autrement dit il fait comme si Dieu n'existait pas, ce qui oblige l'homme à choisir seul ses valeurs.
Cogito (préréflexif) : Le «Je pense donc je suis« de Descartes (énoncé dans la Seconde Méditation métaphysique) est d'après Sartre le principe dont toute philosophie doit partir car il s'agit de «la vérité absolue de la conscience s'atteignant elle-même« (E.H., p. 57).
non thétique sans laquelle je ne pourrais pas avoir conscience de moi.
Contingence : La contingence est l'absence de nécessité, c'est-à-dire le fait qu'une chose puisse ne pas être.
La contingence est donc le caractère propre de notre existence, qui n'est rendue nécessaire par aucune essence préalable, elle est «la contingence même de l'apparition de l'homme sur terre« (E.H., p. 71), ce que cherche à masquer la théologie par sa théorie de la création.
Délaissement : Par délaissement, Sartre entend la condition du Pour-soi, abandonné dans ce monde et devant assumer totalement la responsabilité de ses actes.
Engagement : L'engagement découle de notre être-dans-le-monde et de la nécessité pour nous de choisir parmi les possibles que définit notre situation.
En soi : Le fait d'être en soi est la caractéristique fondamentale de l'être, de ce qui est.
Ce qui signifie que contrairement à la conscience de soi, l'être ne renvoie pas à lui-même ou à autre chose que soi, mais que ce soi, il l'est. «C'est ce que nous exprimerons mieux en disant que l'être est ce qu'il est« (L'Être et le Néant, p. 32).
Autrement dit, l'être est totale positivité, il a le double caractère d'être plein et massif : il ne peut par conséquent être identifié ni au possible ni au nécessaire ; car si l'en soi est contingent, le possible est en revanche une structure du Pour-soi.
Existence : L'existence est le mode d'être du Pour-soi, qui fait qu'il ek-siste, comme le dit Heidegger, c'est-à-dire qu'il est en dehors de soi, toujours au-delà de ce qu'on peut dire de lui.
L'existence a donc la double caractère d'être un «projet qui se vit subjectivement« (E.H., p. 30), c'est-à-dire un être-en-avant-de-soi vers un possible, et une facticité.
L'existentialisme athée a cependant l'avantage de la cohérence, car en refusant la doctrine de la création de l'homme, il peut fonder la proposition selon laquelle l'existence précède chez l'homme l'essence : il rend ainsi le Pour-soi complètement responsable de ses actes, en tant qu'il est délaissé.
L'humanisme existentialiste est donc celui qui évite de définir une nature humaine, à qui il faudrait attribuer une valeur, mais qui le définit par l'existence et par la transcendance.

«
Vocabulaire
possible» (E.H., p.
47).
Le désespoir ne
nous mène pas en conséquence à l'inaction, mais à un engagement lucide et
sans illusions, pour lequel il n'est rien qui
soit certain a priori.
Engagement : L'engagement découle de
notre être-dans-le-monde et de la néces
sité pour nous de choisir parmi les possibles que définit notre situation.
Cet engagement n'est jamais seulement personnel mais par mon choix j'engage
l'humanité entière car « il n'est pas un de
nos actes qui, en créant l'homme que
nous voulons être, ne crée en même
temps une image de l'homme tel que nous
estimons
qu'il doit être» (E.H., p.
31-32).
En choisissant de me marier, non seule
ment
je m'engage mais j'engage toute
l'humanité car j'affirme par mon choix la validité universelle du mariage.
En soi : Le fait d'être en soi est la caractéristique fondamentale de l'être, de
ce qui est.
Ce qui signifie que
contraire
ment
à la conscience de soi, l'être ne
renvoie pas à lui-même ou à autre chose
que soi, mais que ce soi,
il lest.
« C'est ce que nous exprimerons mieux en disant
que l'être est ce qu 'i 1 est » ( L 'Être et le Néant, p.
32).
Autrement dit, l'être est
totale positivité, il a le double caractère
d'être plein et massif: il ne peut par conséquent être identifié ni au possible ni au nécessaire ; car si l'en soi est contin
gent, le possible est en revanche une
structure du Pour-soi.
Essence : L'essence est pour un objet
« l'ensemble des recettes et des qualités
qui permettent de le produire et de le définir» (E.H., p.
27).
C'est donc le
concept d'une chose, autrement dit l'en
semble des propriétés (prédicats) qui font
que cette chose
est ce qu'elle est : l'essence, c'est donc ce qu'un étant est en
soi, et ce que je dois me représenter avant
de le fabriquer.
L'essence ne peut donc
convenir au Pour-soi, qui se jette toujours
au-delà de ce qu'il est : c'est pourquoi
61
chez l'homme, l'existence précède toujours l'essence (E.H., p.
29-30).
Existence : L'existence est le mode d'être
du Pour-soi, qui fait qu'il ek-siste, comme le dit Heidegger, c'est-à-dire qu'il est en
dehors de soi, toujours au-delà de ce
qu'on peut dire de
lui.
L'existence a donc
la double caractère d'être un « projet qui
se vit subjectivement» (E.H., p.
30), c'est-à-dire un être-en-avant-de-soi vers
un possible, et une facticité.
Cette existence est donc totalement injustifiée,
gratuite, elle ne dérive d'aucune essence
préalable : au contraire, « l'homme existe
d'abord, se rencontre, surgit et [ ...
] se
définit ensuite » (E.H., p.
29).
Existentialisme : L'existentialisme est
une doctrine philosophique, qui a pour
caractère essentiel d'insister sur la spécificité de l'existence humaine, qu'il
soit chrétien (comme l'existentialisme
kierkegaardien) ou qu'il soit athée (comme l'existentialisme sartrien).
L'existentialisme athée a cependant l'avantage de la cohérence, car en
refusant la doctrine de la création de l'homme, il peut fonder la proposition
selon laquelle l'existence précède chez l'homme l'essence : il rend ainsi le Pour
soi complètement responsable de ses
actes, en tant qu'il est délaissé.
Facticité : La facticité désigne ce que le
Pour-soi est, en tant qu'il est présent au
monde : en effet, l'homme « est en tant
qu'il est jeté dans un monde, délaissé
dans une "situation", il est en tant qu'il est
pure contingence» (L'Être et le Néant, p.
117).
L'homme est placé dans une situation (géographique, historique,
sociale, etc.) qu'il n'a pas choisie : c'est ce
qui constitue sa facticité -le fait qu'il
soit Français, bourgeois, etc.
Cette facti
cité n'est pas pour autant une limite à la
liberté du Pour-soi
car celui-ci peut
toujours faire quelque chose de ce qu'on a
fait de lui..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les concepts de la philosophie de Montesquieu
- Merleau-Ponty: sa philosophie et ses concepts
- Les concepts de la philosophie de Rousseau
- concepts de la philosophie de Spinoza
- Jean-Paul Sartre - Philosophie.