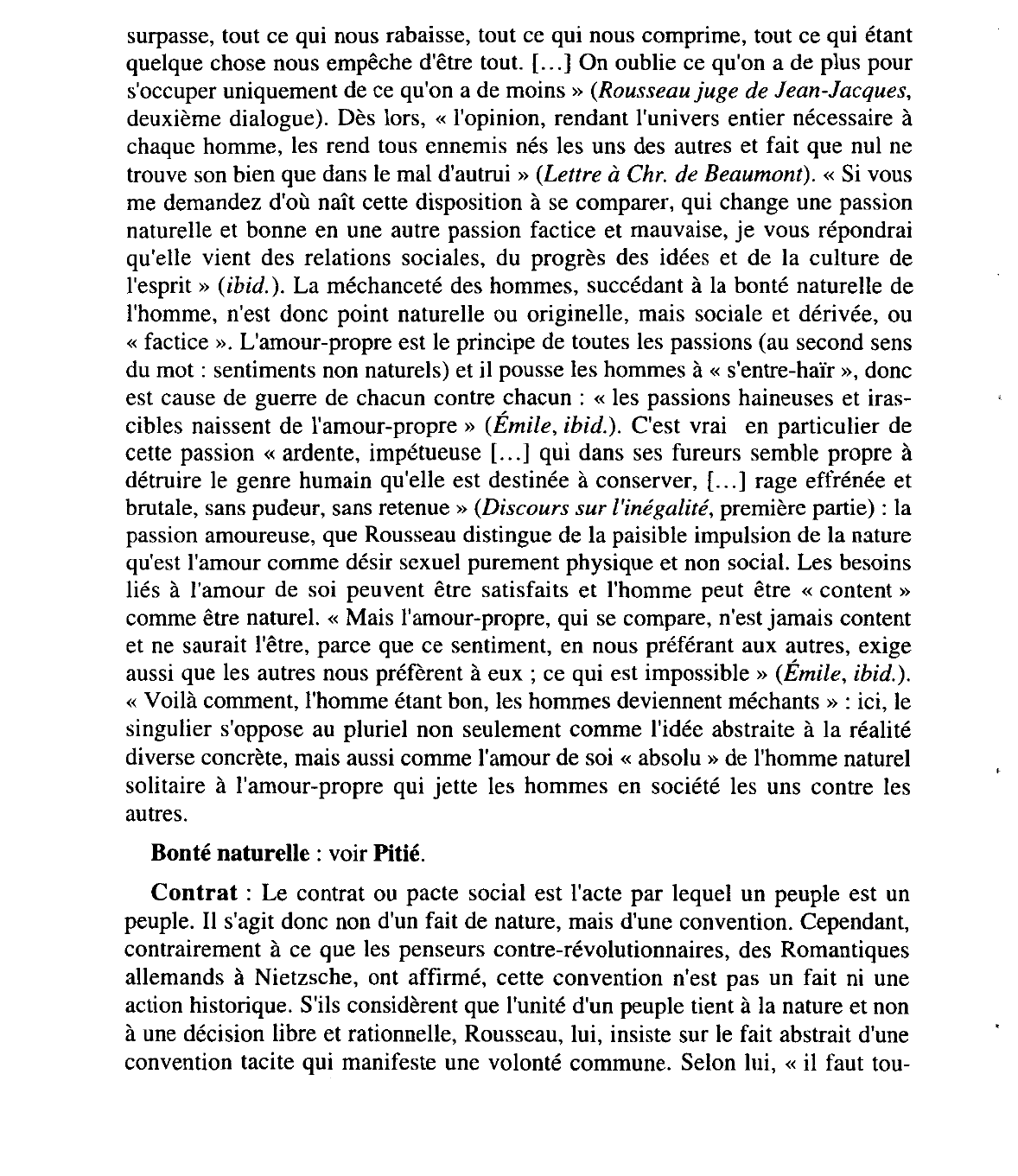Les concepts de la philosophie de Rousseau
Publié le 22/03/2015
Extrait du document

Volonté générale : Cette notion, comme beaucoup d'autres chez Rousseau, a donné lieu à des malentendus.
Elle est le fondement de la souveraineté de l'État et de l'autorité politique légitime.
On la confond généralement avec l'opinion publique, avec les passions de la masse ou avec les idées répandues dans ce qu'on appelle démagogi-quement «le peuple«, dont on consulte les emportements et dont on suit les foucades et les mouvements d'humeur (par des sondages, par exemple) plutôt qu'on ne sollicite son avis et un jugement sensé.
Platon appelait «gros animal« (République, VI, 493 a sq.) ce que de nos jours on nomme le «peuple« quand on veut assurer son pouvoir en flattant les passions collectives, d'ailleurs moins spontanées que suscitées par des moyens de pression comme les médias, la publicité ou la propagande.
La volonté générale est au contraire la volonté particulière de chacun, en tant qu'elle peut être celle de tous : elle vise donc l'intérêt de chacun en décidant de l'intérêt de tous.
Comme la loi qui la formule, son objet est général et sa formulation abstraite.
Elle ne statue donc pas sur des objets particuliers, mais sur tel ou tel point qui peut intéresser tous les membres du peuple sans exception.
Dans ces conditions, la volonté générale, comme sa formulation qui est la loi, fait envisager les individus sous un double point de vue : sujets obéissant à la loi et législateurs auteurs de la loi et porteurs de la souveraineté.
«L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté« (Contrat social, I, 8), et la volonté générale «produit un corps moral et collectif«.
Il demeure enfin que «chaque individu peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen«.
Mais «quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifiera autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre ; car telle est la condition qui donnant chaque citoyen à la patrie le garantit de toute dépendance personnelle, condition [...] qui seule rend légitimes les engagements civils, lesquels sans cela seraient absurdes, tyranniques et sujets aux plus énormes abus« (Contrat social, I, 7).
Le paradoxe magnifiquement énoncé par Rousseau est que la liberté n'est possible que par l'obéissance à la volonté générale.

«
58 Rousseau
surpasse, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous comprime, tout ce qui étant
quelque chose nous empêche d'être tout.
[
...
] On oublie ce qu'on a de plus pour
s'occuper uniquement de ce qu'on a de moins
» (Rousseau juge de Jean-Jacques,
deuxième dialogue).
Dès lors, «l'opinion, rendant l'univers entier nécessaire à
chaque homme, les rend tous ennemis nés les uns des autres et fait que nul ne
trouve son bien que dans le mal
d'autrui» (Lettre à Chr.
de Beaumont).« Si vous
me demandez d'où naît cette disposition à se comparer, qui change une passion
naturelle et bonne en une autre passion factice et mauvaise,
je vous répondrai
qu'elle vient des relations sociales, du progrès des idées et de la culture de
l'esprit» (ibid.).
La méchanceté des hommes, succédant à la bonté naturelle de
l'homme, n'est donc point naturelle ou originelle, mais sociale et dérivée, ou
« factice ».
L'amour-propre est le principe de toutes les passions (au second sens
du
mot: sentiments non naturels) et il pousse les hommes à« s'entre-haïr», donc
est cause de guerre de chacun contre chacun :
« les passions haineuses et iras
cibles naissent de l'amour-propre
» (Émile, ibid.).
C'est vrai en particulier de
cette passion
«ardente, impétueuse [ ...
] qui dans ses fureurs semble propre à
détruire le genre humain qu'elle est destinée à conserver, [
...
] rage effrénée et
brutale, sans pudeur, sans
retenue» (Discours sur l'inégalité, première partie) : la
passion amoureuse, que Rousseau distingue de la paisible impulsion de la nature
qu'est l'amour comme désir sexuel purement physique et non social.
Les besoins
liés à l'amour de soi peuvent être satisfaits et l'homme peut être
« content
»
comme être naturel.
« Mais l'amour-propre, qui se compare, n'est jamais content
et ne saurait l'être, parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige
aussi que les autres nous préfèrent à eux ; ce qui est impossible
» (Émile, ibid.).
« Voilà comment, l'homme étant bon, les hommes deviennent méchants » : ici, le
singulier s'oppose au pluriel non seulement comme l'idée abstraite à la réalité
diverse concrète, mais aussi comme l'amour de soi
« absolu » de l'homme naturel
solitaire à l'amour-propre qui jette les hommes en société les uns contre les
autres.
Bonté naturelle : voir Pitié.
Contrat :
Le contrat ou pacte social est l'acte par lequel un peuple est un
peuple.
Il s'agit donc non d'un fait de nature, mais d'une convention.
Cependant,
contrairement à ce que les penseurs contre-révolutionnaires, des Romantiques
allemands à Nietzsche, ont affirmé, cette convention n'est pas un fait ni une
action historique.
S'ils considèrent que l'unité d'un peuple tient à la nature et non
à une décision libre et rationnelle, Rousseau, lui, insiste sur le fait abstrait d'une
convention tacite qui manifeste une volonté commune.
Selon lui, « il faut tou-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les concepts de la philosophie de Sartre
- Les concepts de la philosophie de Montesquieu
- Concepts de la pensée de Rousseau
- Merleau-Ponty: sa philosophie et ses concepts
- concepts de la philosophie de Spinoza