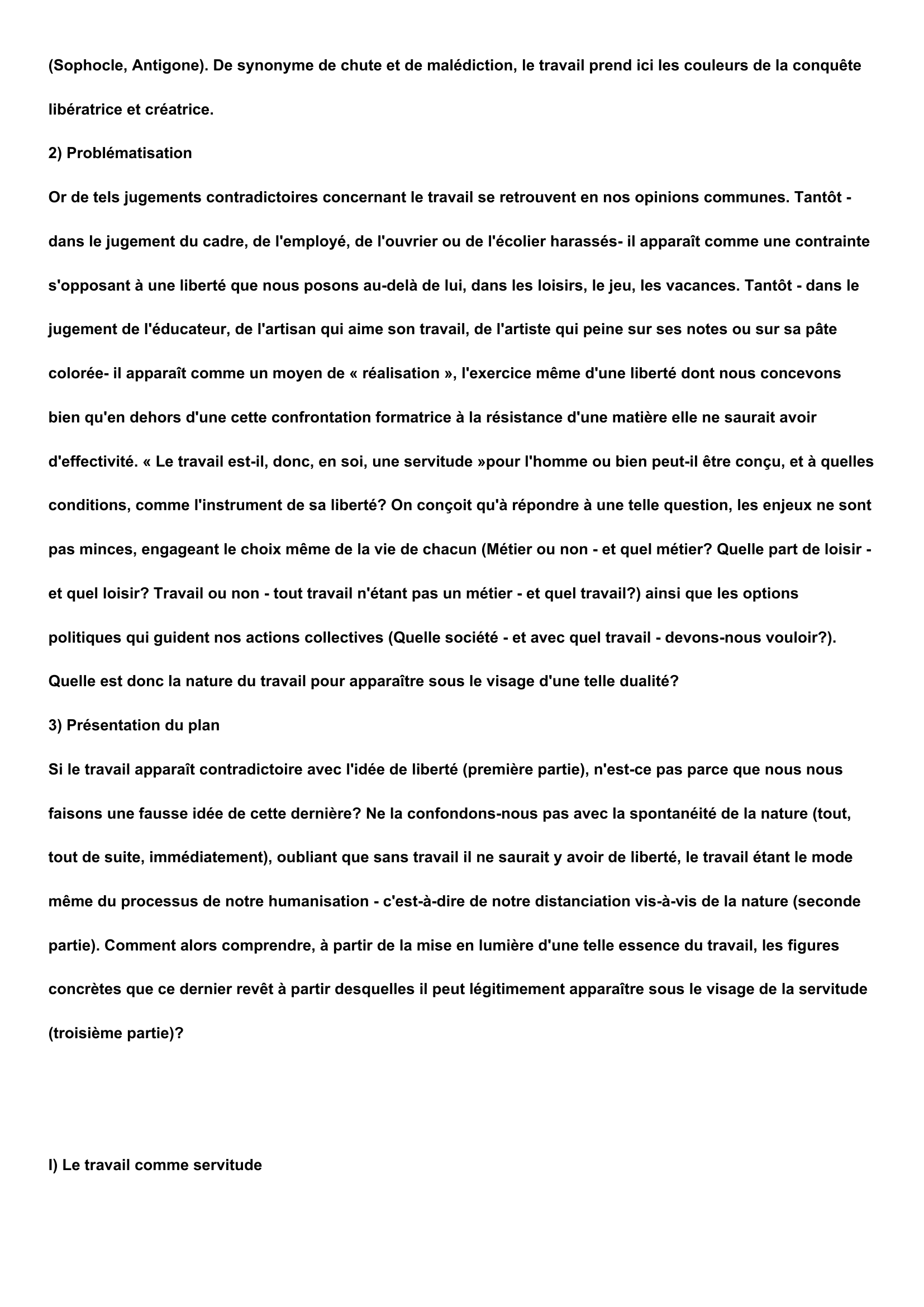Introduction 1) Mise en situation «Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front !«. Ainsi, dans la Genèse, Dieu annonce t’il à Adam sa nouvelle destinée hors du paradis. Le paradis : terre d’abondance où, dans l’innocence, tous les besoins sont comblés avant même de pouvoir s’exprimer. Le paradis : image de la parfaite cohérence, de l’adéquation totale du désir et du monde. Parce qu’il a goûté à l’arbre de la connaissance qui le sépare à jamais de l’animalité, de cette heureuse adéquation de soi à la nature – parce que maintenant l’homme se connaît, qu’il n’est plus un avec la nature et sa propre nature - parce que l’homme a perdu l’innocence de l’animal, Dieu le punit. Et cette punition, qui scelle la naissance mythique de l’humain, s’exprime par la condamnation de l’homme au travail : contrairement à l’animal qui jouit immédiatement des fruits de la nature, toi, homme, «tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ! «. Ainsi le travail apparaît-il comme une malédiction inhérente à la nature de l’homme. Nous, hommes, serions, en vertu de notre essence, condamnés au travail – à la dure nécessité de produire et de reproduire par nous-mêmes nos conditions d’existence. Aussi comprenons-nous la sourde plainte qui du fond des âges monte et espère en une fin des temps, temps de la séparation, temps de l’effort et de la souffrance, temps de la servitude, temps du travail. Mais une telle sortie du règne de la nature, n’est-elle que chute et perte? Le travail qui fait la peine de l’homme ne fait-il pas aussi sa fierté? Ne s’enorgueillit-il pas de cette différence qui le distingue de toutes les créatures de la Terre, de ce caractère propre qui semble le condamner à une vie conquérante? « Nombreuses sont les merveilles, s’écrie ainsi Sophocle, mais de toutes, la plus grande merveille, c'est l'homme. À travers la mer blanchissante, poussé par le vent du sud, il s'avance et passe sous les vagues gonflées qui mugissent autour de lui. La divinité supérieure à toutes les autres, la Terre immortelle et inépuisable, il la fatigue avec les charrues qui, d'année en année vont et reviennent, quand il la retourne avec des bêtes de race chevaline « (Sophocle, Antigone). De synonyme de chute et de malédiction, le travail prend ici les couleurs de la conquête libératrice et créatrice. 2) Problématisation Or de tels jugements contradictoires concernant le travail se retrouvent en nos opinions communes. Tantôt – dans le jugement du cadre, de l’employé, de l’ouvrier ou de l’écolier harassés- il apparaît comme une contrainte s’opposant à une liberté que nous posons au-delà de lui, dans les loisirs, le jeu, les vacances. Tantôt – dans le jugement de l’éducateur, de l’artisan qui aime son travail, de l’artiste qui peine sur ses notes ou sur sa pâte colorée- il apparaît comme un moyen de « réalisation «, l’exercice même d’une liberté dont nous concevons bien qu’en dehors d’une cette confrontation formatrice à la résistance d’une matière elle ne saurait avoir d’effectivité. « Le travail est-il, donc, en soi, une servitude «pour l’homme ou bien peut-il être conçu, et à quelles conditions, comme l’instrument de sa liberté? On conçoit qu’à répondre à une telle question, les enjeux ne sont pas minces, engageant le choix même de la vie de chacun (Métier ou non - et quel métier? Quelle part de loisir - et quel loisir? Travail ou non – tout travail n’étant pas un métier – et quel travail?) ainsi que les options politiques qui guident nos actions collectives (Quelle société - et avec quel travail – devons-nous vouloir?). Quelle est donc la nature du travail pour apparaître sous le visage d’une telle dualité? 3) Présentation du plan Si le travail apparaît contradictoire avec l’idée de liberté (première partie), n’est-ce pas parce que nous nous faisons une fausse idée de cette dernière? Ne la confondons-nous pas avec la spontanéité de la nature (tout, tout de suite, immédiatement), oubliant que sans travail il ne saurait y avoir de liberté, le travail étant le mode même du processus de notre humanisation - c'est-à-dire de notre distanciation vis-à-vis de la nature (seconde partie). Comment alors comprendre, à partir de la mise en lumière d’une telle essence du travail, les figures concrètes que ce dernier revêt à partir desquelles il peut légitimement apparaître sous le visage de la servitude (troisième partie)? I) Le travail comme servitude Un état de servitude est un état de soumission forcée à une force extérieure. Ainsi l’esclave est-il soumis par la force du maître, étant forcé de travailler pour ce dernier, sous le risque de perdre sa vie. A quoi s’oppose l’état de celui qui n’est nullement contraint. Un tel état définit, en un premier sens, la liberté négativement – ne pas être contraint. Positivement, la liberté apparaît, à son tour, selon l’acception commune, comme «faire ce que je veux «. On conçoit ainsi que toute contrainte, tout ce qui s’impose à moi sans que je l’ai voulu et choisi soit un obstacle à ma liberté. Or le travail n’est-il pas un tel obstacle? 1) La liberté comme spontanéité et le travail comme contrainte Si être libre c’est, en un premier sens, « faire ce que je veux «, la liberté est à comprendre comme l’immédiate réalisation de mes désirs. C’est ainsi que la représentation d’un soleil, de cocotiers, de femmes à foison (ou d’hommes, peu importe) et d’une belle voiture peuvent m’apparaître comme les images mêmes de la liberté – ainsi qu’ils se présentent dans les téléfilms et les publicités. Là, comme en mes rêves la nuit, nulle étrangeté, nulle résistance d’une quelconque extériorité vis-à-vis de l’ordre de mes désirs ne viendrait s’immiscer. Nos désirs s’épancheraient de façon spontanée, se réalisant dans le moment même de leur apparition. Une telle conception de la liberté – dont on retrouve l’image dans l’idée de paradis (voir introduction) - est celle d’une spontanéité naturelle de mon être (qui se déploie de soi-même, immédiatement et sans contrôle) qui dans l’adéquation totale du monde à ses désirs, jouit de sa propre unité. L’idéal d’une telle liberté c’est «tout, tout de suite, immédiatement« - soit l’absorption de la réalité du monde dans l’identité de mon désir. Nous comprenons ainsi que tout délai entre le désir et sa réalisation va être saisi comme un obstacle à cette liberté. Or tel est le dur obstacle de la réalité qu’elle pose à distance de moi les objets du désir. Cette voiture, ce voyage, ces femmes à foison… je les imagine, certes, je peux les espérer, mais ils ne sont pas là. Pour acquérir tout cela, il va me falloir travailler – c'est-à-dire opposer un délai à mon désir et un effort à mon corps contraire à ma volonté immédiate spontanée (je préférais autre chose, précisément l’objet de mon désir). Mais pourquoi travailler? Certes, dans le cadre d’un emploi, pour obtenir l’argent qui va me permettre d’acheter puis consommer les produits achetés. Mais une telle consommation suppose la production de tels produits qui, eux, ne poussent pas spontanément dans la nature : la voiture, le bateau ou l’avion qui vont me permettre de faire le voyage, l’épilation des corps qui va me faire aimer ces beautés, l’élagage des cocotiers… tout cela il va falloir le produire. Or telle apparaît la fonction première du travail – en dehors de toute considération d’emploi (c'est-à-dire de rémunération) – d’être un agent transformateur de la nature en vue de sa conformation aux désirs humains. Si le travail peut ainsi apparaître sous la figure de la servitude c’est qu’il n’est pas une fin en soi – je ne travaille pas pour travailler - mais un moyen nécessaire dont la fin est la consommation c'est-à-dire l’absorption et la réduction de l’objet à l’ordre de mon désir (cette voiture c’est ma voiture, ces femmes ce sont mes femmes… c'est-à-dire les objets de ma jouissance). Le travail est ainsi ce qui me sépare de la jouissance immédiate. S’il me sépare d’une telle jouissance c’est encore parce qu’il m’impose fatigue et effort, contraignant mon corps à des actions s’opposant à l’immédiateté de mon désir (je désirerais faire autre chose, précisément : jouir de mes biens). A la difficulté et à l’effort demandés par le travail, m’imposant la médiation de la fatigue et du temps, s’oppose ainsi comme son envers, le jeu, grâce auquel, sans effort, je peux savourer par l’imagination un monde non résistant – qui n’a pas cette résistance qui caractérise la réalité - immédiatement adéquat à l’ordre de mes désirs (jeux vidéos, jeu de rôle…). Enfin, si le travail m’apparaît contraignant c’est que je suis, par lui, obligé de rentrer dans des relations sociales que je ne désire pas. Si, en effet, je ne peux par moi-même fabriquer le bateau, la voiture, épiler toutes ces femmes, élaguer les cocotiers… il me faudra acquérir de telles valeurs d’usage par l’échange. De là la division sociale du travail c'est-à-dire la spécialisation de chacun dans un métier particulier. L’échange avec l’autre suppose, en effet, que j’ai quelque chose à lui échanger pour obtenir les produits que je désire. Or il faut que le produit que je lui offre soit, lui aussi, conforme à ses désirs, c'est-à-dire qu’il ait une valeur d’usage. Mais produire des valeurs d’usage suppose que je me forme, que j’apprenne un métier, tout processus qui, là encore, prend du temps et m’éloigne de la réalisation immédiate de mes désirs. Nous comprenons ainsi que le travail puisse apparaître comme une servitude. Il est la marque de l’opposition entre mes désirs et la réalité, la liberté et la nécessité. Dans ce cadre la véritable liberté est au-delà du travail, dans ce rapport d’immédiation égoïste du désir et de son objet qu’est la consommation. Si l’on travaille c’est donc pour consommer. Le travail est une médiation nécessaire et douloureuse pour jouir de ma liberté comme immédiation (rapport immédiat à moi-même et à la nature). 2) La liberté comme spontanéité est illusoire, elle n’a de positivité que comme distance vis-à-vis de la nature Mais une telle liberté comme spontanéité immédiate assimilant (lier à la fonction assimilatrice de la cellule, qui réduit l’autre à soi, ce qui est autre – telle molécule – à un élément dans le métabolisme de la cellule) son objet, peut-elle véritablement être conçue comme le type même de la liberté? Le modèle d’une telle spontanéité déchaînée engloutissant toute chose en la réduisant à ses propres fonctions n’est-il pas le bébé dans le ventre de sa mère? Alors, en effet, rien ne semble couper le désir de sa réalisation immédiate, l’enfant étant comme branché sur la source même de plaisir. Aussi, pouvons-nous imaginer l’image d’une telle liberté – ainsi que dans le film Matrix - en un homme lui aussi branché sur des électrodes dont on crée, prévient et réalise le moindre des désirs. Qu’est-ce qui dans une telle fiction rendrait illusoire la liberté – comme elle rend illusoire celle de l’enfant? Essentiellement le fait que de la source de ces désirs, nul n’a ici la maîtrise. L’individu cohére avec eux – ne fait qu’un avec eux – sans qu’il puisse à aucun moment s’en détacher, se mettre à distance d’eux, pour les connaître, les juger et les choisir. A proprement parler, personne n’est derrière ces désirs, comme leur sujet, celui qui les maîtrise et les choisit. Or n’est-ce pas, en effet, en une telle distanciation, que nous jugeons du progrès d’un homme dans la maîtrise de soi – par quoi il n’est plus déterminé par son désir, mais se décide librement en jugeant ce dernier? A celui qui est pris dans son désir de vengeance ou de meurtre, qui ne fait qu’un avec lui, s’oppose celui, qui, malgré la force de son désir, arrête le mouvement implacable de son geste et tente de se mettre à distance de lui, pour le juger et refuser son emprise. Alors seulement nous pouvons parler d’une véritable liberté : l’homme ne fait plus un avec son désir, il fait deux : il en a pris conscience et peut s’en libérer. Dans le premier cas, en effet, le désir n’était certes pas contraint de l’extérieur, il faisait corps avec nous. Mais ce désir, nul ne l’avait choisi librement : le désir nous prend, survient (c’est une passion, s’opposant à une action – nous sommes passifs vis-à-vis de lui et non l’acteur de ce désir), il est spontané, c'est-à-dire qu’il naît et se manifeste de lui-même en nous. Or une telle force avec laquelle nous cohérons, n’est-elle pas l’analogue de la soumission à une force extérieure? Le propre de la nature n’est-il pas, en effet, d’agir spontanément, sans distance, ni pensée tout ainsi qu’elle le fait chez l’animal qui est pris dans ses propres désirs et mouvements? – le chat, par exemple, jamais ne s’arrête et ne se demande s’il a raison de chasser la souris. Mais une telle liberté, parce qu’elle est sans sujet qui par derrière elle pourrait choisir et décider, est une illusion. C’est ce que peut nous fait comprendre Spinoza : « pour rendre cela clair et intelligible, concevons une chose très simple : une pierre par exemple reçoit d’une cause extérieure qui la pousse, une certaine quantité de mouvement et, l’impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu’elle est nécessaire, mais parce qu’elle doit être définie par l’impulsion d’une cause extérieure. Et ce qui est vrai de la pierre, il faut l’entendre de toute chose singulière (…) parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d’une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous voulez bien, que la pierre tandis qu’elle continue à se mouvoir, pense et sache qu’elle fait effort, autant qu’elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu’elle a conscience de son effort seulement et qu’elle n’est en aucune façon indifférente, croira qu’elle est très libre et qu’elle ne persévère sans son mouvement que parce qu’elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent « (Spinoza, Lettre 58 à Schuller). Parce que mes désirs se manifestent en moi comme identiques à moi, cohérant avec la force qui meut mon corps, j’ai l’impression d’être libre de les vouloir – nulle force extérieure n’y est perceptible. Mais ...