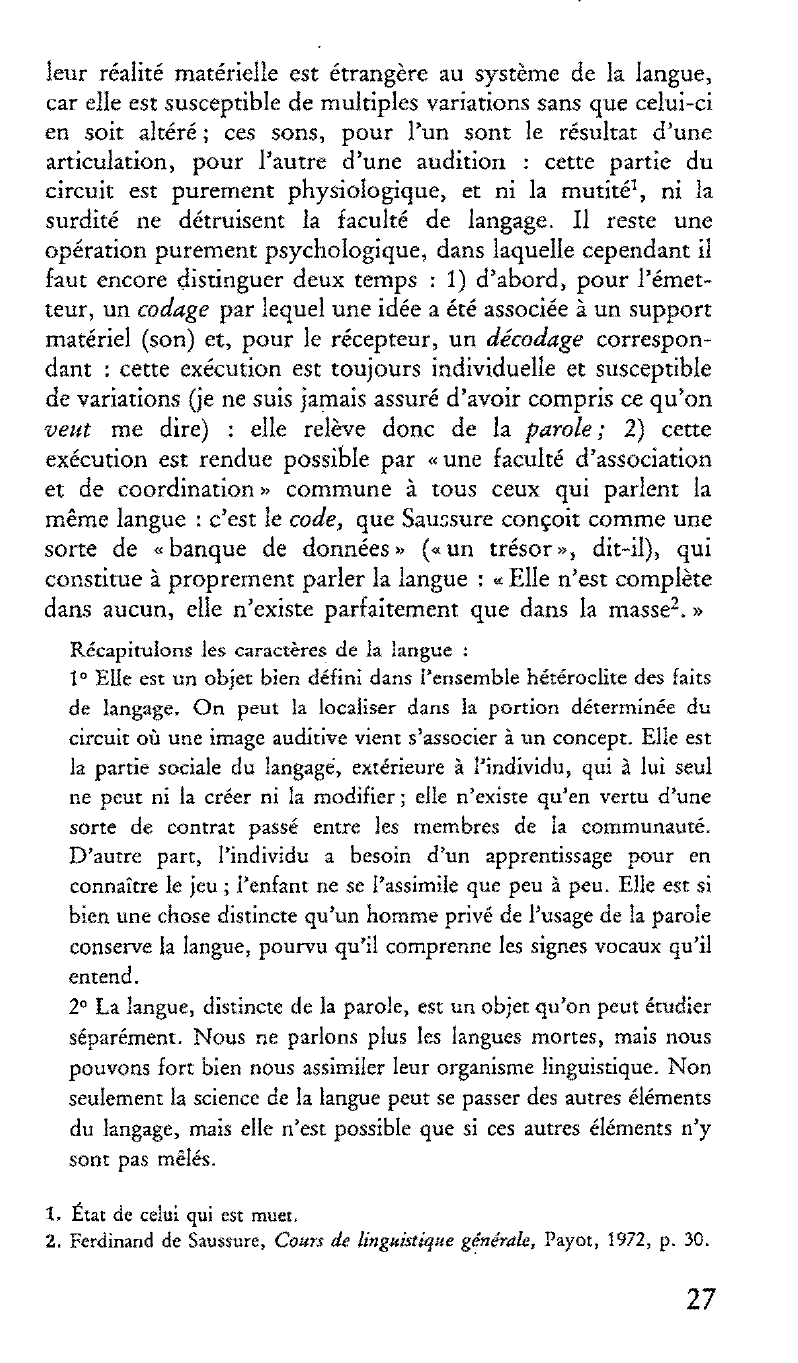Le langage et la pensée
Publié le 25/01/2020
Extrait du document

3° Tandis que le langage est hétérogène, la langue ainsi délimitée est de nature homogène : c’est un système de signes où il n’y a d’essentiel que l’union du sens et de l’image acoustique, et où les deux parties du signe sont également psychiques.
4° La langue n’est pas moins que la parole un objet concret, et c’est un grand avantage pour l’étude. Les signes linguistiques, pour être essentiellement psychiques, ne sont pas des abstractions ; les associations ratifiées par le consentement collectif, et dont l’ensemble constitue la langue, sont des réalités qui ont leur siège dans le cerveau. Ferdinand de Saussure, opus cité, pp. 31-32.
Ce couple langue/parole rappelle, bien sûr, la distinction de la compétence et de la performance que nous avons déjà examinée ; mais il s’en distingue profondément' d’une manière qu’il est important de préciser : en excluant de la langue toute exécution (qu’il réserve à la parole), Saussure exclut précisément la compétence, qui est un modèle* de création ; son propos n’est pas de montrer comment une phrase peut être produite, mais dans quoi (dans quel matériau) elle se produit. Il vise ainsi à décrire, à rendre intelligibles* les mécanismes fondamentaux du symbolisme humain. '
LE SIGNE ET LE SYSTÈME
Nous avons déjà défini le symbole linguistique par le fait qu’il sert à désigner des objets avec lesquels il n’offre aucune ressemblance dans la réalité ; mais c’est précisément cette faculté que Saussure veut expliquer : la langue, telle qu’il l’a définie, ne permet plus de prendre en considération le rapport entre les éléments du langage et les données de l’expérience* auxquelles ils renvoient (le référent). Par contre, la langue est constituée d’éléments eux aussi doubles, les signes. « Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. » Le signe est ainsi la mise en rapport de la modalité purement psychologique des choses (le concept) et de la modalité purement psychologique des sons (« l’image acoustique »), la chose elle-même en étant définitivement exclue. Saussure décide d’appeler signifiant et signifié les deux termes de ce rapport, mais il se heurte à une difficulté qui marque les limites de son projet : le fait que ces signes
(oppositions) et les combinaisons où il est susceptible d’être repéré comme identique (enchaînements) : «Le mécanisme linguistique roule tout entier sur des identités et des différences, celles-ci n’étant que la contrepartie de celles-là... » Saussure appelle valeur ce modelage du signe par toute l’économie du système, notion illustrée dans une célèbre comparaison entre la langue et le jeu d’échecs : hors de l’échiquier, une pièce n’est qu’un objet quelconque ; au cours de la partie, elle a une signification définie à la fois par les règles du jeu (principes fondamentaux de la langue) et sa situation par rapport à toutes les autres pièces, si bien que n’importe quel coup joué sur l’échiquier en modifie la valeur. La langue est donc un système de relations sans éléments préalables : c’est «une forme et non une substance». Sous le nom de signe, Saussure parvient donc à décrire le fonctionnement du symbolisme humain comme la réalisation d’un objet tout à fait particulier, puisqu’il est purement « relationnel» (signifiant/signifié) et «différentiel» (signe/système). Il ne faut donc pas confondre les signes et les mots, même si l’analyse impose d’utiliser ceux-ci comme « spécimens équivalents des termes réels1 ».
LE PARALLÉLISME LOGICO-GRAMMATICAL
Les difficultés auxquelles se heurte Saussure dans l’analyse de la pensée-son expliquent les deux illusions* les plus communément répandues sur le langage.. Pour les uns, se manifestant comme un phénomène* concret, il n’est que l’instrument d’une pensée qui se développe hors de lui et l’utilise ; pour les autres, son caractère organisé doit être l’image du fonctionnement logique* de l’esprit* humain. La tradition logique et grammaticale issue d’Aristote prend tour à tour ces deux aspects.
• Les catégories
Dans le Traité des catégories, Aristote tente de classer toutes les propriétés que, par la pensée, on peut attribuer à un objet : si je parle d’un individu quelconque rencontré au lycée, quelles questions peut-on me faire sur son compte, et quel type de réponses serais-je amené à donner? Quel est-il

«
leur réalité matérielle est étrangère au système de la langue,
car elle est susceptible de multiples variations sans que celui-ci
en soit altéré; ces sons, pour l'un sont le résultat d'une
articulation, pour l'autre d'une audition : cette partie du
circuit est purement physiologique, et ni la mutité 1, ni la
surdité ne détruisent la faculté de langage.
Il reste une
opération purement psychologique, dans laquelle cependant il
faut encore distinguer deux temps : 1) d'abord, pour l'émet
teur, un codage par lequel une idée a été associée à un support
matériel (son) et, pour le récepteur, un décodage correspon
dant : cette exécution est toujours individuelle et susceptible
de variations (je ne suis jamais assuré d'avoir compris ce qu'on
veut me dire) : elle relève donc de la parole; 2) cette
exécution est rendue possible par «une faculté d'association
et de coordination ,, commune à tous ceux qui parlent la
même langue : c'est le code, que Sau~sure conçoit comme une
sorte de "banque de données,, («un trésor'» dit-il), qui
constitue à proprement parler la langue : "Elle n'est complète
dans aucun, elle n'existe parfaitement que dans la masse 2• »
Récapitulons les caractères de la langue :
1° Elle est un objet bien défini dans l'ensemble hétéroclite des faits
de langage.
On peut la localiser dans la portion déterminée du
circuit où une image auditive vient s'associer à un concept.
Elle est
la partie sociale du langagé, extérieure à l'individu, qui à lui seul
ne peut ni la créer ni la modifier; elle n'existe qu'en vertu d'une
sorte de contrat passé entre les membres de la communauté.
D'autre part, l'individu a besoin d'un apprentissage pour en
connaître le jeu; l'enfant ne se l'assimile que peu à peu.
Elle est si
bien une chose distincte qu'un homme privé de l'usage de la parole
conserve la langue, pourvu qu'il comprenne les signes vocaux qu'il
entend.
2° La langue, distincte de la parole, est un objet qu'on peut étudier
séparément.
Nous ne parlons plus les langues mortes, mais nous
pouvons fort bien nous assimiler leur organisme linguistique.
Non
seulement la science de la langue peut se passer des autres éléments
du langage, mais elle n'est possible que si ces autres éléments n'y
sont pas mêlés.
1.
État de celui qui est muet.
2.
Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1972, p.
30.
27.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LANGAGE ET LA PENSÉE (LE), Language and . Noam Chomsky - résumé de l'oeuvre
- LANGAGE ET LA PENSÉE CHEZ L’ENFANT (Le). (résumé)
- Notre pensée pour s'élaborer et s'exprimer, passe-t-elle nécessairement par le langage?
- Notre pensée pour s'élaborer et s'exprimer, passe-t-elle nécessairement par le langage ?
- Notre pensée, pour s’exprimer, passe-t-elle nécessairement par le langage ?