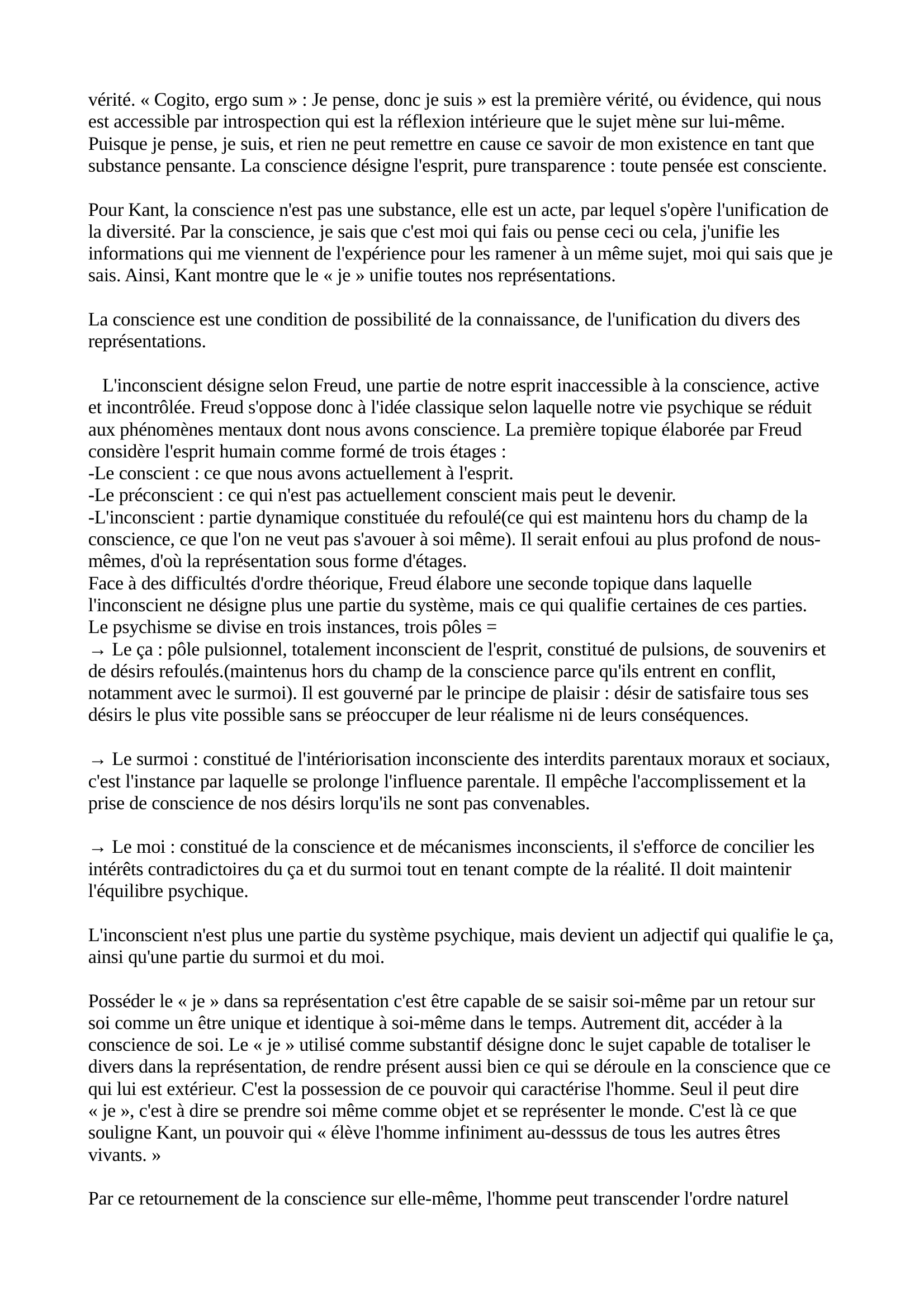Le "je" sans le moi
Publié le 05/04/2015
Extrait du document
«
vérité.
« Cogito, ergo sum » : Je pense, donc je suis » est la première vérité, ou évidence, qui nous
est accessible par introspection qui est la réflexion intérieure que le sujet mène sur lui-même.
Puisque je pense, je suis, et rien ne peut remettre en cause ce savoir de mon existence en tant que
substance pensante.
La conscience désigne l'esprit, pure transparence : toute pensée est consciente.
Pour Kant, la conscience n'est pas une substance, elle est un acte, par lequel s'opère l'unification de
la diversité.
Par la conscience, je sais que c'est moi qui fais ou pense ceci ou cela, j'unifie les
informations qui me viennent de l'expérience pour les ramener à un même sujet, moi qui sais que je
sais.
Ainsi, Kant montre que le « je » unifie toutes nos représentations.
La conscience est une condition de possibilité de la connaissance, de l'unification du divers des
représentations.
L'inconscient désigne selon Freud, une partie de notre esprit inaccessible à la conscience, active
et incontrôlée.
Freud s'oppose donc à l'idée classique selon laquelle notre vie psychique se réduit
aux phénomènes mentaux dont nous avons conscience.
La première topique élaborée par Freud
considère l'esprit humain comme formé de trois étages :
-Le conscient : ce que nous avons actuellement à l'esprit.
-Le préconscient : ce qui n'est pas actuellement conscient mais peut le devenir.
-L'inconscient : partie dynamique constituée du refoulé(ce qui est maintenu hors du champ de la
conscience, ce que l'on ne veut pas s'avouer à soi même).
Il serait enfoui au plus profond de nous-
mêmes, d'où la représentation sous forme d'étages.
Face à des difficultés d'ordre théorique, Freud élabore une seconde topique dans laquelle
l'inconscient ne désigne plus une partie du système, mais ce qui qualifie certaines de ces parties.
Le psychisme se divise en trois instances, trois pôles =
→ Le ça : pôle pulsionnel, totalement inconscient de l'esprit, constitué de pulsions, de souvenirs et
de désirs refoulés.(maintenus hors du champ de la conscience parce qu'ils entrent en conflit,
notamment avec le surmoi).
Il est gouverné par le principe de plaisir : désir de satisfaire tous ses
désirs le plus vite possible sans se préoccuper de leur réalisme ni de leurs conséquences.
→ Le surmoi : constitué de l'intériorisation inconsciente des interdits parentaux moraux et sociaux,
c'est l'instance par laquelle se prolonge l'influence parentale.
Il empêche l'accomplissement et la
prise de conscience de nos désirs lorqu'ils ne sont pas convenables.
→ Le moi : constitué de la conscience et de mécanismes inconscients, il s'efforce de concilier les
intérêts contradictoires du ça et du surmoi tout en tenant compte de la réalité.
Il doit maintenir
l'équilibre psychique.
L'inconscient n'est plus une partie du système psychique, mais devient un adjectif qui qualifie le ça,
ainsi qu'une partie du surmoi et du moi.
Posséder le « je » dans sa représentation c'est être capable de se saisir soi-même par un retour sur
soi comme un être unique et identique à soi-même dans le temps.
Autrement dit, accéder à la
conscience de soi.
Le « je » utilisé comme substantif désigne donc le sujet capable de totaliser le
divers dans la représentation, de rendre présent aussi bien ce qui se déroule en la conscience que ce
qui lui est extérieur.
C'est la possession de ce pouvoir qui caractérise l'homme.
Seul il peut dire
« je », c'est à dire se prendre soi même comme objet et se représenter le monde.
C'est là ce que
souligne Kant, un pouvoir qui « élève l'homme infiniment au-desssus de tous les autres êtres
vivants.
»
Par ce retournement de la conscience sur elle-même, l'homme peut transcender l'ordre naturel.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓