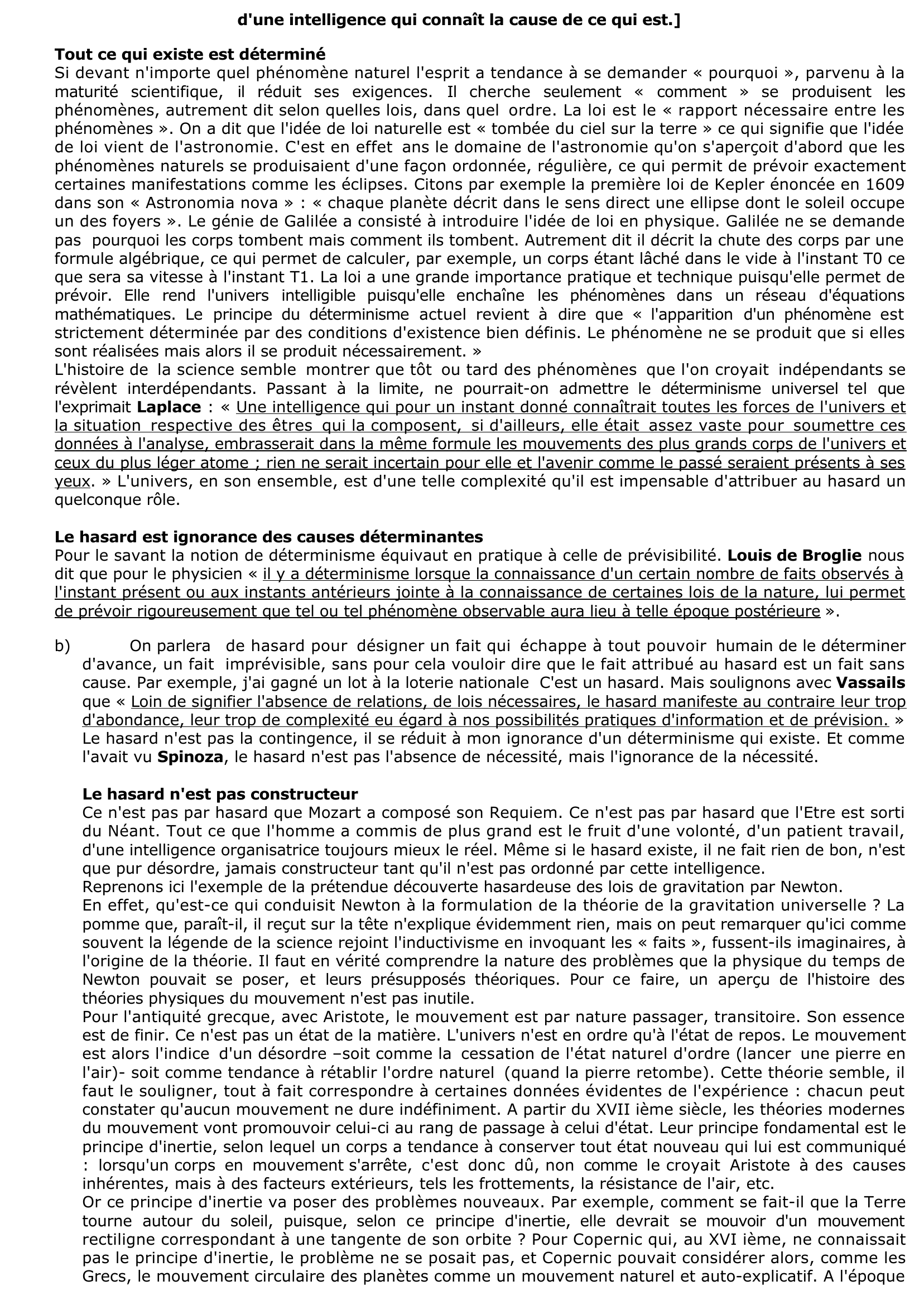Le hasard peut-il bien faire les choses ?
Publié le 01/03/2004
Extrait du document
«
d'une intelligence qui connaît la cause de ce qui est.]
Tout ce qui existe est déterminéSi devant n'importe quel phénomène naturel l'esprit a tendance à se demander « pourquoi », parvenu à lamaturité scientifique, il réduit ses exigences.
Il cherche seulement « comment » se produisent lesphénomènes, autrement dit selon quelles lois, dans quel ordre.
La loi est le « rapport nécessaire entre lesphénomènes ».
On a dit que l'idée de loi naturelle est « tombée du ciel sur la terre » ce qui signifie que l'idéede loi vient de l'astronomie.
C'est en effet ans le domaine de l'astronomie qu'on s'aperçoit d'abord que lesphénomènes naturels se produisaient d'une façon ordonnée, régulière, ce qui permit de prévoir exactementcertaines manifestations comme les éclipses.
Citons par exemple la première loi de Kepler énoncée en 1609dans son « Astronomia nova » : « chaque planète décrit dans le sens direct une ellipse dont le soleil occupeun des foyers ».
Le génie de Galilée a consisté à introduire l'idée de loi en physique.
Galilée ne se demandepas pourquoi les corps tombent mais comment ils tombent.
Autrement dit il décrit la chute des corps par uneformule algébrique, ce qui permet de calculer, par exemple, un corps étant lâché dans le vide à l'instant T0 ceque sera sa vitesse à l'instant T1.
La loi a une grande importance pratique et technique puisqu'elle permet deprévoir.
Elle rend l'univers intelligible puisqu'elle enchaîne les phénomènes dans un réseau d'équationsmathématiques.
Le principe du déterminisme actuel revient à dire que « l'apparition d'un phénomène eststrictement déterminée par des conditions d'existence bien définis.
Le phénomène ne se produit que si ellessont réalisées mais alors il se produit nécessairement.
»L'histoire de la science semble montrer que tôt ou tard des phénomènes que l'on croyait indépendants serévèlent interdépendants.
Passant à la limite, ne pourrait-on admettre le déterminisme universel tel quel'exprimait Laplace : « Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces de l'univers et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs, elle était assez vaste pour soumettre cesdonnées à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers etceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle et l'avenir comme le passé seraient présents à sesyeux .
» L'univers, en son ensemble, est d'une telle complexité qu'il est impensable d'attribuer au hasard un quelconque rôle.
Le hasard est ignorance des causes déterminantesPour le savant la notion de déterminisme équivaut en pratique à celle de prévisibilité.
Louis de Broglie nous dit que pour le physicien « il y a déterminisme lorsque la connaissance d'un certain nombre de faits observés à l'instant présent ou aux instants antérieurs jointe à la connaissance de certaines lois de la nature, lui permetde prévoir rigoureusement que tel ou tel phénomène observable aura lieu à telle époque postérieure ».
b) On parlera de hasard pour désigner un fait qui échappe à tout pouvoir humain de le déterminer d'avance, un fait imprévisible, sans pour cela vouloir dire que le fait attribué au hasard est un fait sanscause.
Par exemple, j'ai gagné un lot à la loterie nationale C'est un hasard.
Mais soulignons avec Vassails que « Loin de signifier l'absence de relations, de lois nécessaires, le hasard manifeste au contraire leur trop d'abondance, leur trop de complexité eu égard à nos possibilités pratiques d'information et de prévision. » Le hasard n'est pas la contingence, il se réduit à mon ignorance d'un déterminisme qui existe.
Et commel'avait vu Spinoza , le hasard n'est pas l'absence de nécessité, mais l'ignorance de la nécessité.
Le hasard n'est pas constructeurCe n'est pas par hasard que Mozart a composé son Requiem.
Ce n'est pas par hasard que l'Etre est sortidu Néant.
Tout ce que l'homme a commis de plus grand est le fruit d'une volonté, d'un patient travail,d'une intelligence organisatrice toujours mieux le réel.
Même si le hasard existe, il ne fait rien de bon, n'estque pur désordre, jamais constructeur tant qu'il n'est pas ordonné par cette intelligence.Reprenons ici l'exemple de la prétendue découverte hasardeuse des lois de gravitation par Newton.En effet, qu'est-ce qui conduisit Newton à la formulation de la théorie de la gravitation universelle ? Lapomme que, paraît-il, il reçut sur la tête n'explique évidemment rien, mais on peut remarquer qu'ici commesouvent la légende de la science rejoint l'inductivisme en invoquant les « faits », fussent-ils imaginaires, àl'origine de la théorie.
Il faut en vérité comprendre la nature des problèmes que la physique du temps deNewton pouvait se poser, et leurs présupposés théoriques.
Pour ce faire, un aperçu de l'histoire desthéories physiques du mouvement n'est pas inutile.Pour l'antiquité grecque, avec Aristote, le mouvement est par nature passager, transitoire.
Son essenceest de finir.
Ce n'est pas un état de la matière.
L'univers n'est en ordre qu'à l'état de repos.
Le mouvementest alors l'indice d'un désordre –soit comme la cessation de l'état naturel d'ordre (lancer une pierre enl'air)- soit comme tendance à rétablir l'ordre naturel (quand la pierre retombe).
Cette théorie semble, ilfaut le souligner, tout à fait correspondre à certaines données évidentes de l'expérience : chacun peutconstater qu'aucun mouvement ne dure indéfiniment.
A partir du XVII ième siècle, les théories modernesdu mouvement vont promouvoir celui-ci au rang de passage à celui d'état.
Leur principe fondamental est leprincipe d'inertie, selon lequel un corps a tendance à conserver tout état nouveau qui lui est communiqué: lorsqu'un corps en mouvement s'arrête, c'est donc dû, non comme le croyait Aristote à des causesinhérentes, mais à des facteurs extérieurs, tels les frottements, la résistance de l'air, etc.Or ce principe d'inertie va poser des problèmes nouveaux.
Par exemple, comment se fait-il que la Terretourne autour du soleil, puisque, selon ce principe d'inertie, elle devrait se mouvoir d'un mouvementrectiligne correspondant à une tangente de son orbite ? Pour Copernic qui, au XVI ième, ne connaissaitpas le principe d'inertie, le problème ne se posait pas, et Copernic pouvait considérer alors, comme lesGrecs, le mouvement circulaire des planètes comme un mouvement naturel et auto-explicatif.
A l'époque.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor Hugo écrit : «La nature procède par contrastes. C'est par les oppositions qu'elle fait saillir les objets. C'est par leurs contraires qu'elle fait sentir les choses, le jour par la nuit, le chaud par le froid, etc.; toute clarté fait ombre. De là le relief, le contour, la proportion, le rapport, la réalité. La création, la vie, le destin, ne sont pour l'homme qu'un immense clair-obscur. Le poète, ce philosophe du concret et ce peintre de l'abstrait, le poète, ce penseur suprême,
- « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » SENEQUE
- « Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore; voilà les conditions essentielles pour être un peuple. » (Renan.)
- « Expliquez et discutez ce texe de Coménius : « Nous désirons que ce ne soient pas seulement quelques hommes qui puissent être instruits encyclo-pédiquement mais, tous les hommes. Et qu'ils soient instruits, non seulement de ce qu'on peut savoir, mals aussi de ce qu'il faut faire et expliquer par la parole. Nous désirons qu'ils se distinguent le plus possible des animaux, justement par les dons qui les différen¬cient d'eux, c'est-à-dire par la raison, la parole et la liberté d'agir...
- Il est extrêmement utile de faire souvent réflexion sur les manières presque infinies dont les hommes sont liés aux objets sensibles ; et un des meilleurs moyens pour se rendre assez savant dans ces choses, c'est de s'étudier et de s'observer soi-même.