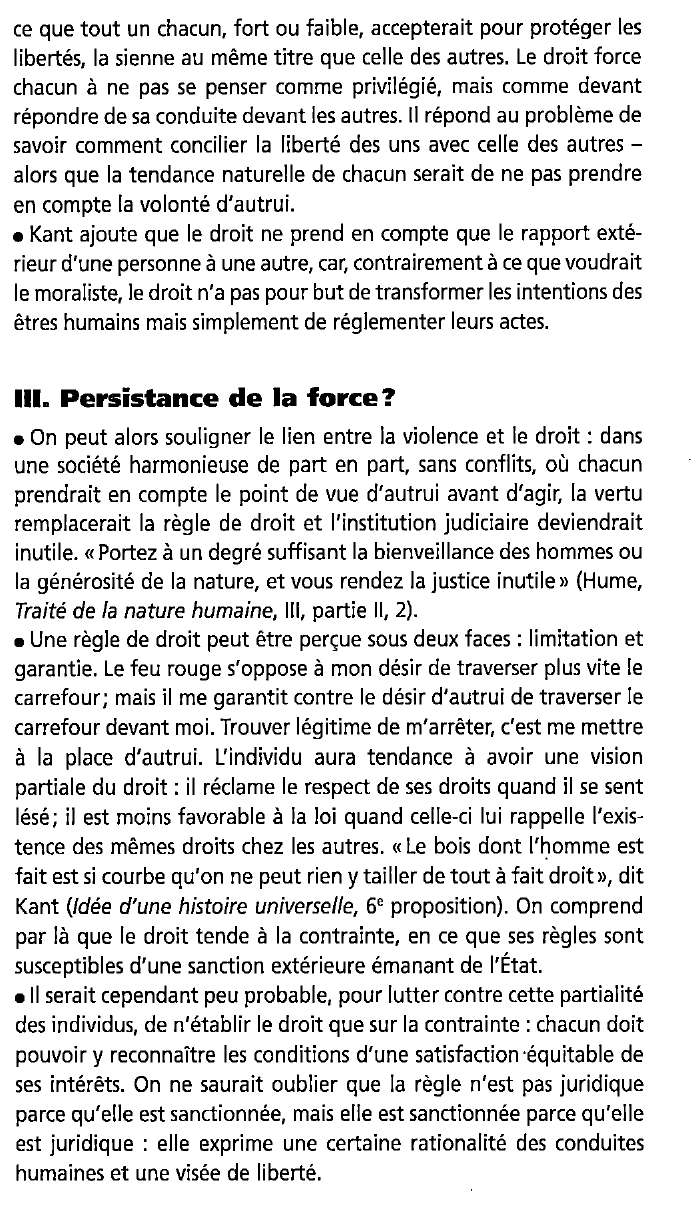Le droit nous impose-t-il DES LIMITES?
Publié le 25/01/2020
Extrait du document

• On peut alors souligner le lien entre la violence et le droit : dans une société harmonieuse de part en part, sans conflits, où chacun prendrait en compte le point de vue d'autrui avant d'agir, la vertu remplacerait la règle de droit et l'institution judiciaire deviendrait inutile. «Portez à un degré suffisant la bienveillance des hommes ou la générosité de la nature, et vous rendez la justice inutile» (Hume, Traité de la nature humaine, III, partie II, 2).
• Une règle de droit peut être perçue sous deux faces : limitation et garantie. Le feu rouge s'oppose à mon désir de traverser plus vite le carrefour; mais il me garantit contre le désir d'autrui de traverser le carrefour devant moi. Trouver légitime de m'arrêter, c'est me mettre à la place d'autrui. L'individu aura tendance à avoir une vision partiale du droit : il réclame le respect de ses droits quand il se sent lésé; il est moins favorable à la loi quand celle-ci lui rappelle l'existence des mêmes droits chez les autres. « Le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler detout à fait droit», dit Kant (Idée d'une histoire universelle, 6e proposition). On comprend par là que le droit tende à la contrainte, en ce que ses règles sont susceptibles d'une sanction extérieure émanant de l'État.
• Il serait cependant peu probable, pour lutter contre cette partialité des individus, de n'établir le droit que sur la contrainte : chacun doit pouvoir y reconnaître les conditions d'une satisfaction équitable de ses intérêts. On ne saurait oublier que la règle n'est pas juridique parce qu'elle est sanctionnée, mais elle est sanctionnée parce qu'elle est juridique : elle exprime une certaine rationalité des conduites humaines et une visée de liberté.

«
ce que tout un chacun, fort ou faible, accepterait pour protéger les
libertés, la sienne au même titre que celle des autres.
Le droit force
chacun à ne pas se penser comme privilégié, mais comme devant
Ill répondre de sa conduite devant les autres.
Il répond au problème de
::J savoir comment concilier la liberté des uns avec celle des autres - a alors que la tendance naturelle de chacun serait de ne pas prendre
..., en compte la volonté d'autrui.
.J • Kant ajoute que le droit ne prend en compte que le rapport exté- 0 a.
rieur d'une personne à une autre, car, contrairement à ce que voudrait
c:t le moraliste, le droit n'a pas pour but de transformer les intentions des
.J êtres humains mais simplement de réglementer leurs actes.
-"-'
Ill.
Persistance de la force?
•On peut alors souligner le lien entre la violence et le droit : dans
une société harmonieuse de part en part, sans conflits, où chacun
prendrait en compte le point de vue d'autrui avant d'agir, la vertu
remplacerait la règle de droit et l'institution judiciaire deviendrait
inutile.« Portez à un degré suffisant la bienveillance des hommes ou
la générosité de la nature, et vous rendez la justice inutile» (Hume,
Traité de la nature humaine, Ill, partie Il, 2).
•Une règle de droit peut être perçue sous deux faces : limitation et
garantie.
Le feu rouge s'oppose à mon désir de traverser plus vite le
carrefour; mais il me garantit contre le désir d'autrui de traverser le
carrefour devant moi.
Trouver légitime de m'arrêter, c'est me mettre
à la place d'autrui.
L'individu aura tendance à avoir une vision
partiale du droit : il réclame le respect de ses droits quand il se sent
lésé; il est moins favorable à la loi quand celle-ci lui rappelle l'exis
tence des mêmes droits chez les autres.
«Le bois dont l'homme est
fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de tout à fait droit», dit
Kant (Idée d'une histoire universelle, 6' proposition).
On comprend
par là que le droit tende à la contrainte, en ce que ses règles sont
susceptibles d'une sanction extérieure émanant de l'État.
e li serait cependant peu probable, pour lutter contre cette partialité
des individus, de n'établir le droit que sur la contrainte : chacun doit
pouvoir y reconnaître les conditions d'une satisfaction ·équitable de
ses intérêts.
On ne saurait oublier que la règle n'est pas juridique
parce qu'elle est sanctionnée, mais elle est sanctionnée parce qu'elle
est juridique : elle exprime une certaine rationalité des conduites
humaines et une visée de liberté.
> Flash bac P- "I 07
-=--------.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le droit nous impose-t-il des limites ?
- td droit civil séance 8 l'exercice de l'autorité parentale et ses limites
- Si l'homme s'accomplit dans le travail, comment comprendre la pénibilité qui y est associée ainsi que les diverses formes d'aliénation qu'il engendre? Mais si l'homme ne s'y accomplit pas, pourquoi le travail s'impose-t-il partout comme une nécessité au point qu'il existe un droit au travail?
- Quelles sont les limites du droit de reproduction en matière littéraire ?
- Un droit sans limites est-il encore un droit ?