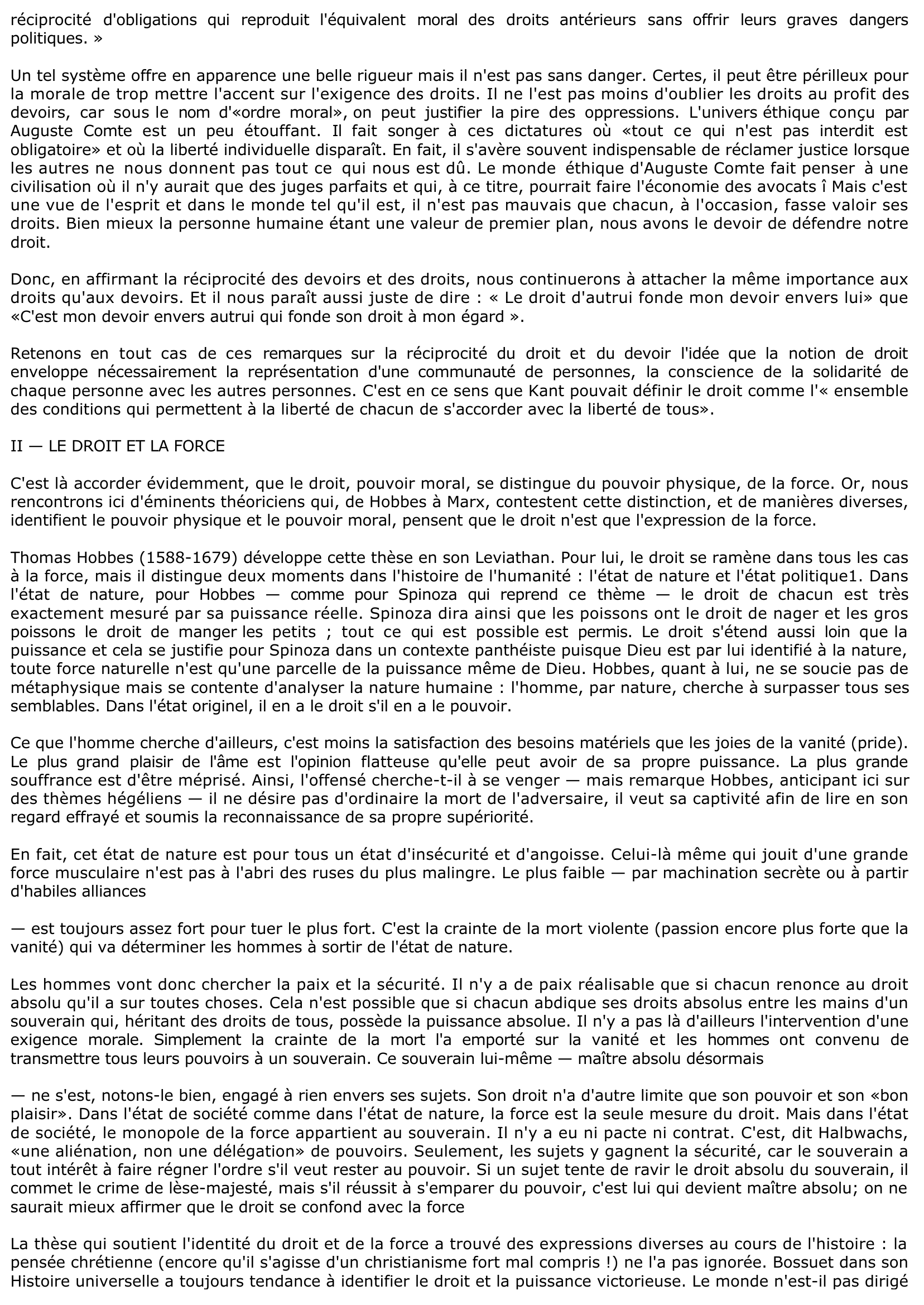LE DROIT (cours de terminale)
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
réciprocité d'obligations qui reproduit l'équivalent moral des droits antérieurs sans offrir leurs graves dangerspolitiques.
»
Un tel système offre en apparence une belle rigueur mais il n'est pas sans danger.
Certes, il peut être périlleux pourla morale de trop mettre l'accent sur l'exigence des droits.
Il ne l'est pas moins d'oublier les droits au profit desdevoirs, car sous le nom d'«ordre moral», on peut justifier la pire des oppressions.
L'univers éthique conçu parAuguste Comte est un peu étouffant.
Il fait songer à ces dictatures où «tout ce qui n'est pas interdit estobligatoire» et où la liberté individuelle disparaît.
En fait, il s'avère souvent indispensable de réclamer justice lorsqueles autres ne nous donnent pas tout ce qui nous est dû.
Le monde éthique d'Auguste Comte fait penser à unecivilisation où il n'y aurait que des juges parfaits et qui, à ce titre, pourrait faire l'économie des avocats î Mais c'estune vue de l'esprit et dans le monde tel qu'il est, il n'est pas mauvais que chacun, à l'occasion, fasse valoir sesdroits.
Bien mieux la personne humaine étant une valeur de premier plan, nous avons le devoir de défendre notredroit.
Donc, en affirmant la réciprocité des devoirs et des droits, nous continuerons à attacher la même importance auxdroits qu'aux devoirs.
Et il nous paraît aussi juste de dire : « Le droit d'autrui fonde mon devoir envers lui» que«C'est mon devoir envers autrui qui fonde son droit à mon égard ».
Retenons en tout cas de ces remarques sur la réciprocité du droit et du devoir l'idée que la notion de droitenveloppe nécessairement la représentation d'une communauté de personnes, la conscience de la solidarité dechaque personne avec les autres personnes.
C'est en ce sens que Kant pouvait définir le droit comme l'« ensembledes conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder avec la liberté de tous».
II — LE DROIT ET LA FORCE
C'est là accorder évidemment, que le droit, pouvoir moral, se distingue du pouvoir physique, de la force.
Or, nousrencontrons ici d'éminents théoriciens qui, de Hobbes à Marx, contestent cette distinction, et de manières diverses,identifient le pouvoir physique et le pouvoir moral, pensent que le droit n'est que l'expression de la force.
Thomas Hobbes (1588-1679) développe cette thèse en son Leviathan.
Pour lui, le droit se ramène dans tous les casà la force, mais il distingue deux moments dans l'histoire de l'humanité : l'état de nature et l'état politique1.
Dansl'état de nature, pour Hobbes — comme pour Spinoza qui reprend ce thème — le droit de chacun est trèsexactement mesuré par sa puissance réelle.
Spinoza dira ainsi que les poissons ont le droit de nager et les grospoissons le droit de manger les petits ; tout ce qui est possible est permis.
Le droit s'étend aussi loin que lapuissance et cela se justifie pour Spinoza dans un contexte panthéiste puisque Dieu est par lui identifié à la nature,toute force naturelle n'est qu'une parcelle de la puissance même de Dieu.
Hobbes, quant à lui, ne se soucie pas demétaphysique mais se contente d'analyser la nature humaine : l'homme, par nature, cherche à surpasser tous sessemblables.
Dans l'état originel, il en a le droit s'il en a le pouvoir.
Ce que l'homme cherche d'ailleurs, c'est moins la satisfaction des besoins matériels que les joies de la vanité (pride).Le plus grand plaisir de l'âme est l'opinion flatteuse qu'elle peut avoir de sa propre puissance.
La plus grandesouffrance est d'être méprisé.
Ainsi, l'offensé cherche-t-il à se venger — mais remarque Hobbes, anticipant ici surdes thèmes hégéliens — il ne désire pas d'ordinaire la mort de l'adversaire, il veut sa captivité afin de lire en sonregard effrayé et soumis la reconnaissance de sa propre supériorité.
En fait, cet état de nature est pour tous un état d'insécurité et d'angoisse.
Celui-là même qui jouit d'une grandeforce musculaire n'est pas à l'abri des ruses du plus malingre.
Le plus faible — par machination secrète ou à partird'habiles alliances
— est toujours assez fort pour tuer le plus fort.
C'est la crainte de la mort violente (passion encore plus forte que lavanité) qui va déterminer les hommes à sortir de l'état de nature.
Les hommes vont donc chercher la paix et la sécurité.
Il n'y a de paix réalisable que si chacun renonce au droitabsolu qu'il a sur toutes choses.
Cela n'est possible que si chacun abdique ses droits absolus entre les mains d'unsouverain qui, héritant des droits de tous, possède la puissance absolue.
Il n'y a pas là d'ailleurs l'intervention d'uneexigence morale.
Simplement la crainte de la mort l'a emporté sur la vanité et les hommes ont convenu detransmettre tous leurs pouvoirs à un souverain.
Ce souverain lui-même — maître absolu désormais
— ne s'est, notons-le bien, engagé à rien envers ses sujets.
Son droit n'a d'autre limite que son pouvoir et son «bonplaisir».
Dans l'état de société comme dans l'état de nature, la force est la seule mesure du droit.
Mais dans l'étatde société, le monopole de la force appartient au souverain.
Il n'y a eu ni pacte ni contrat.
C'est, dit Halbwachs,«une aliénation, non une délégation» de pouvoirs.
Seulement, les sujets y gagnent la sécurité, car le souverain atout intérêt à faire régner l'ordre s'il veut rester au pouvoir.
Si un sujet tente de ravir le droit absolu du souverain, ilcommet le crime de lèse-majesté, mais s'il réussit à s'emparer du pouvoir, c'est lui qui devient maître absolu; on nesaurait mieux affirmer que le droit se confond avec la force
La thèse qui soutient l'identité du droit et de la force a trouvé des expressions diverses au cours de l'histoire : lapensée chrétienne (encore qu'il s'agisse d'un christianisme fort mal compris !) ne l'a pas ignorée.
Bossuet dans sonHistoire universelle a toujours tendance à identifier le droit et la puissance victorieuse.
Le monde n'est-il pas dirigé.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Justice et Droit (cours de terminale)
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- justice et droit (cours)
- le droit commercial (cours complet)
- Le cancer, BPH, cours terminale ST2S