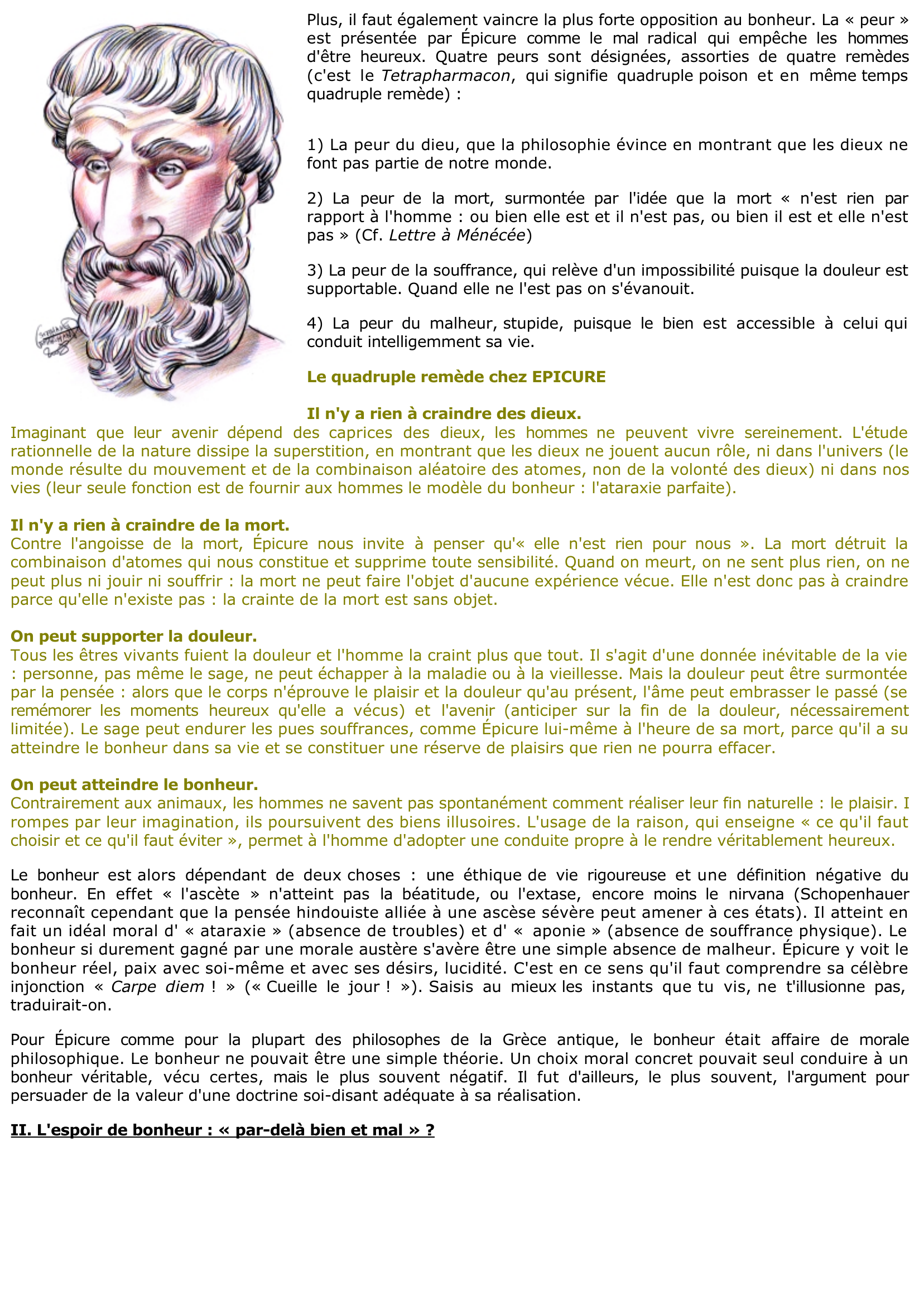Le bonheur est-il affaire de morale ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document


«
Plus, il faut également vaincre la plus forte opposition au bonheur.
La « peur »est présentée par Épicure comme le mal radical qui empêche les hommesd'être heureux.
Quatre peurs sont désignées, assorties de quatre remèdes(c'est le Tetrapharmacon , qui signifie quadruple poison et en même temps quadruple remède) :
1) La peur du dieu, que la philosophie évince en montrant que les dieux nefont pas partie de notre monde.
2) La peur de la mort, surmontée par l'idée que la mort « n'est rien parrapport à l'homme : ou bien elle est et il n'est pas, ou bien il est et elle n'estpas » (Cf.
Lettre à Ménécée )
3) La peur de la souffrance, qui relève d'un impossibilité puisque la douleur estsupportable.
Quand elle ne l'est pas on s'évanouit.
4) La peur du malheur, stupide, puisque le bien est accessible à celui quiconduit intelligemment sa vie.
Le quadruple remède chez EPICURE
Il n'y a rien à craindre des dieux. Imaginant que leur avenir dépend des caprices des dieux, les hommes ne peuvent vivre sereinement.
L'étuderationnelle de la nature dissipe la superstition, en montrant que les dieux ne jouent aucun rôle, ni dans l'univers (lemonde résulte du mouvement et de la combinaison aléatoire des atomes, non de la volonté des dieux) ni dans nosvies (leur seule fonction est de fournir aux hommes le modèle du bonheur : l'ataraxie parfaite).
Il n'y a rien à craindre de la mort.Contre l'angoisse de la mort, Épicure nous invite à penser qu'« elle n'est rien pour nous ».
La mort détruit lacombinaison d'atomes qui nous constitue et supprime toute sensibilité.
Quand on meurt, on ne sent plus rien, on nepeut plus ni jouir ni souffrir : la mort ne peut faire l'objet d'aucune expérience vécue.
Elle n'est donc pas à craindreparce qu'elle n'existe pas : la crainte de la mort est sans objet.
On peut supporter la douleur.Tous les êtres vivants fuient la douleur et l'homme la craint plus que tout.
Il s'agit d'une donnée inévitable de la vie: personne, pas même le sage, ne peut échapper à la maladie ou à la vieillesse.
Mais la douleur peut être surmontéepar la pensée : alors que le corps n'éprouve le plaisir et la douleur qu'au présent, l'âme peut embrasser le passé (seremémorer les moments heureux qu'elle a vécus) et l'avenir (anticiper sur la fin de la douleur, nécessairementlimitée).
Le sage peut endurer les pues souffrances, comme Épicure lui-même à l'heure de sa mort, parce qu'il a suatteindre le bonheur dans sa vie et se constituer une réserve de plaisirs que rien ne pourra effacer.
On peut atteindre le bonheur.Contrairement aux animaux, les hommes ne savent pas spontanément comment réaliser leur fin naturelle : le plaisir.
Irompes par leur imagination, ils poursuivent des biens illusoires.
L'usage de la raison, qui enseigne « ce qu'il fautchoisir et ce qu'il faut éviter », permet à l'homme d'adopter une conduite propre à le rendre véritablement heureux.
Le bonheur est alors dépendant de deux choses : une éthique de vie rigoureuse et une définition négative dubonheur.
En effet « l'ascète » n'atteint pas la béatitude, ou l'extase, encore moins le nirvana (Schopenhauerreconnaît cependant que la pensée hindouiste alliée à une ascèse sévère peut amener à ces états).
Il atteint enfait un idéal moral d' « ataraxie » (absence de troubles) et d' « aponie » (absence de souffrance physique).
Le bonheur si durement gagné par une morale austère s'avère être une simple absence de malheur.
Épicure y voit lebonheur réel, paix avec soi-même et avec ses désirs, lucidité.
C'est en ce sens qu'il faut comprendre sa célèbreinjonction « Carpe diem ! » (« Cueille le jour ! »).
Saisis au mieux les instants que tu vis, ne t'illusionne pas, traduirait-on.
Pour Épicure comme pour la plupart des philosophes de la Grèce antique, le bonheur était affaire de moralephilosophique.
Le bonheur ne pouvait être une simple théorie.
Un choix moral concret pouvait seul conduire à unbonheur véritable, vécu certes, mais le plus souvent négatif.
Il fut d'ailleurs, le plus souvent, l'argument pourpersuader de la valeur d'une doctrine soi-disant adéquate à sa réalisation.
II.
L'espoir de bonheur : « par-delà bien et mal » ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on fonder la morale SUR LA RECHERCHE DU BONHEUR?
- Expliquer le texte suivant : Kant - Devoir morale et Bonheur
- Le bonheur peut-il fonder la morale ?
- Kant : Le devoir et le bonheur; la morale; le droit et la politique.
- Analysez la notion de bonheur et précisez son rôle dans la vie morale.