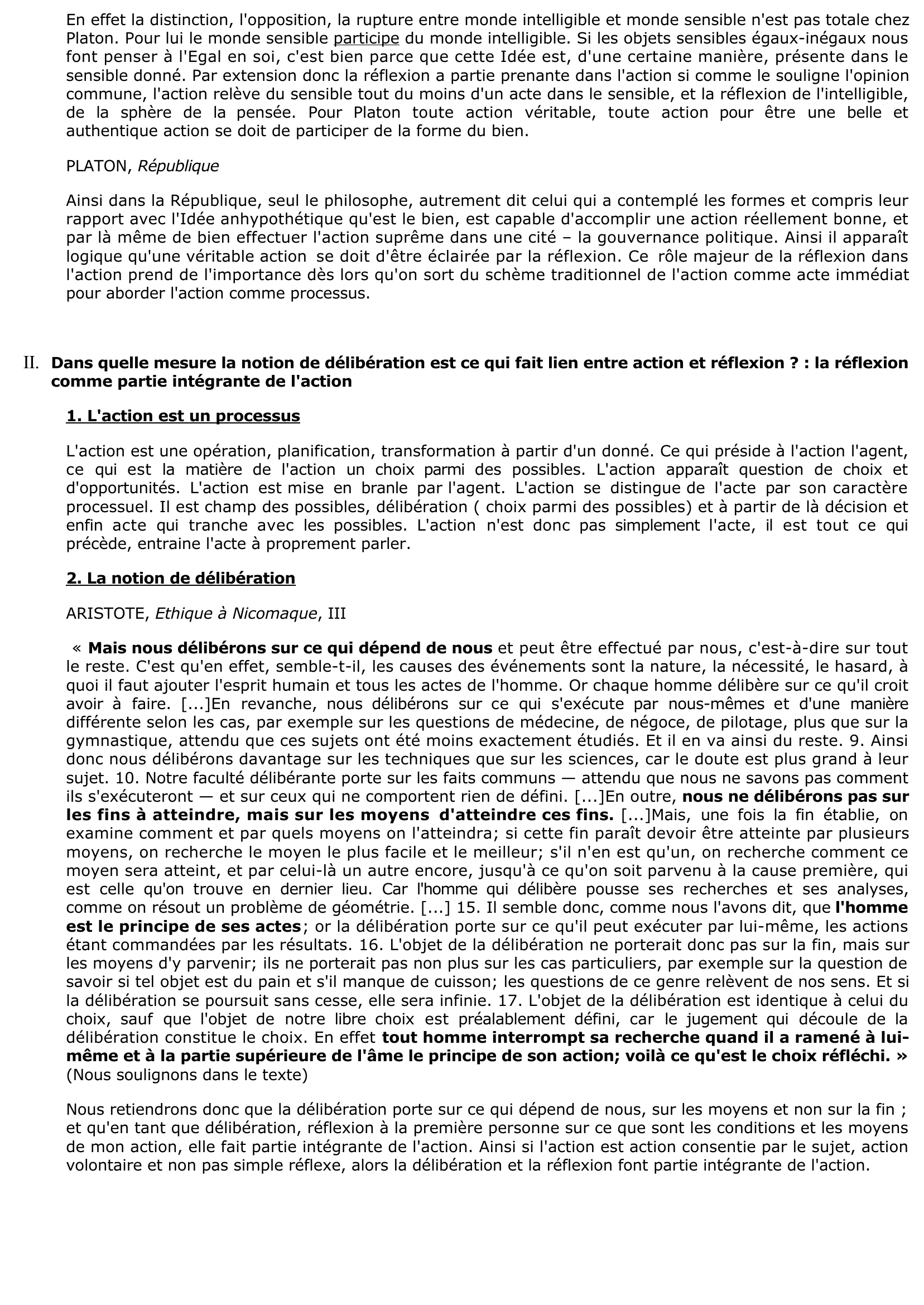l'action peut-elle se passer de la réflexion ?
Publié le 19/10/2005
Extrait du document
Ce sujet est formulé sous forme d'une question totale, autrement dit qui exige une réponse par oui, ou par non : soit l'action peut se passer de la réflexion, soit elle ne le peut pas. En effet si on se limite à l'opinion commune, l'action semble s'opposer à la réflexion. L' homme d'action serait celui qui agit dans l'immédiat, alors que la réflexion, en revanche, exigerait étant donné la mouvement de retour sur elle-même qu'elle implique et qu'elle exige une certaine durée, autrement dit du temps. Cependant l'action se fait dans le temps et exige aussi du temps. Nous le voyons le problème que laisse présager une analyse de l'opinion commune nous invite à nous attarder plus précisément sur les deux concepts en présence.
- L'action
On peut dégager plusieurs acceptions de ce terme. 1/ L'action est tout d'abord une opération d'un être considérée comme produite par cet être lui-même et non par une cause extérieure. L'action est celle du sujet qui agit. 2/ L'action c'est aussi l'effort, le travail, l'activité non plus comme processus opératoire à proprement parler mais comme se distinguant du repos et de l'inactivité. 3/ L'action se pense aussi directement dans son opposition à l'intelligence, la réflexion et la pensée : c'est la spontanéïté des êtres vivants, et plus précisément de l'homme considérée comme se distinguant de la représentation. NB :Nous ne prenons volontairement pas en considération l'action au sens d'influence d'un corps sur un autre. (Exemple : On parle à ce titre d'action de l'acide chlorydrique sur les métaux) En effet notre interrogation portant sur le lien « action « / « réflexion «, cette acception ne nous semble pas prioritaire.
- La réflexion
La ré-flexion est un retour de la pensée sur elle-même avec pour objet non pas un objet extérieur mais ses propres opérations. Ici la réflexion notons, car cela nous sera utile par la suite est quasi définie comme une action. Dans le sens plus courant, la réflexion elle est suspension du jugement afin de prendre en considération d'avantage les tenants et les aboutissants d'une situation. Dans ce cas la réflexion apparaît comme suspension de l'action.
- « Se passer de « : clé pour la problématisation
Pourquoi s'interroger sur ce concept qui semble évident, clair et distinct. En effet se passer de, c'est faire l'économie de, faire l'abstraction de. Cependant cette question part d'un présupposé évident : Si on accepte l'hypothèse selon laquelle l'action pourrait se passer de la réflexion, c'est que la réflexion ne serait qu'un moyen non nécessaire et donc contingent au service de l'action. Nous nous installerions dans un primat de l'action qui dénierait toute valeur à la réflexion. On le voit, le sujet a des enjeux insoupçonnés. Néanmoins penser le lien « action « / « réflexion « sur ce mode, autrement dit sur celui de la supériorité de l'un par rapport à l'autre semble infructueux. Ceci apparaît dans les distinctions conceptuelles que nous avons pu élaborer. La réflexion est dans une certaine mesure un type d'action ; et l'action dans son caractère d'opération semble intégrer une part de réflexion. D'où la question : l'action peut-elle se passer de la réflexion ?
«
En effet la distinction, l'opposition, la rupture entre monde intelligible et monde sensible n'est pas totale chezPlaton.
Pour lui le monde sensible participe du monde intelligible.
Si les objets sensibles égaux-inégaux nous font penser à l'Egal en soi, c'est bien parce que cette Idée est, d'une certaine manière, présente dans lesensible donné.
Par extension donc la réflexion a partie prenante dans l'action si comme le souligne l'opinioncommune, l'action relève du sensible tout du moins d'un acte dans le sensible, et la réflexion de l'intelligible,de la sphère de la pensée.
Pour Platon toute action véritable, toute action pour être une belle etauthentique action se doit de participer de la forme du bien.
PLATON, République
Ainsi dans la République, seul le philosophe, autrement dit celui qui a contemplé les formes et compris leurrapport avec l'Idée anhypothétique qu'est le bien, est capable d'accomplir une action réellement bonne, etpar là même de bien effectuer l'action suprême dans une cité – la gouvernance politique.
Ainsi il apparaîtlogique qu'une véritable action se doit d'être éclairée par la réflexion.
Ce rôle majeur de la réflexion dansl'action prend de l'importance dès lors qu'on sort du schème traditionnel de l'action comme acte immédiatpour aborder l'action comme processus.
Dans quelle mesure la notion de délibération est ce qui fait lien entre action et réflexion ? : la réflexioncomme partie intégrante de l'action II.
1.
L'action est un processus
L'action est une opération, planification, transformation à partir d'un donné.
Ce qui préside à l'action l'agent,ce qui est la matière de l'action un choix parmi des possibles.
L'action apparaît question de choix etd'opportunités.
L'action est mise en branle par l'agent.
L'action se distingue de l'acte par son caractèreprocessuel.
Il est champ des possibles, délibération ( choix parmi des possibles) et à partir de là décision etenfin acte qui tranche avec les possibles.
L'action n'est donc pas simplement l'acte, il est tout ce quiprécède, entraine l'acte à proprement parler.
2.
La notion de délibération
ARISTOTE, Ethique à Nicomaque , III
« Mais nous délibérons sur ce qui dépend de nous et peut être effectué par nous, c'est-à-dire sur tout le reste.
C'est qu'en effet, semble-t-il, les causes des événements sont la nature, la nécessité, le hasard, àquoi il faut ajouter l'esprit humain et tous les actes de l'homme.
Or chaque homme délibère sur ce qu'il croitavoir à faire.
[...]En revanche, nous délibérons sur ce qui s'exécute par nous-mêmes et d'une manièredifférente selon les cas, par exemple sur les questions de médecine, de négoce, de pilotage, plus que sur lagymnastique, attendu que ces sujets ont été moins exactement étudiés.
Et il en va ainsi du reste.
9.
Ainsidonc nous délibérons davantage sur les techniques que sur les sciences, car le doute est plus grand à leursujet.
10.
Notre faculté délibérante porte sur les faits communs — attendu que nous ne savons pas commentils s'exécuteront — et sur ceux qui ne comportent rien de défini.
[...]En outre, nous ne délibérons pas sur les fins à atteindre, mais sur les moyens d'atteindre ces fins.
[...]Mais, une fois la fin établie, on examine comment et par quels moyens on l'atteindra; si cette fin paraît devoir être atteinte par plusieursmoyens, on recherche le moyen le plus facile et le meilleur; s'il n'en est qu'un, on recherche comment cemoyen sera atteint, et par celui-là un autre encore, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la cause première, quiest celle qu'on trouve en dernier lieu.
Car l'homme qui délibère pousse ses recherches et ses analyses,comme on résout un problème de géométrie.
[...] 15.
Il semble donc, comme nous l'avons dit, que l'homme est le principe de ses actes ; or la délibération porte sur ce qu'il peut exécuter par lui-même, les actions étant commandées par les résultats.
16.
L'objet de la délibération ne porterait donc pas sur la fin, mais surles moyens d'y parvenir; ils ne porterait pas non plus sur les cas particuliers, par exemple sur la question desavoir si tel objet est du pain et s'il manque de cuisson; les questions de ce genre relèvent de nos sens.
Et sila délibération se poursuit sans cesse, elle sera infinie.
17.
L'objet de la délibération est identique à celui duchoix, sauf que l'objet de notre libre choix est préalablement défini, car le jugement qui découle de ladélibération constitue le choix.
En effet tout homme interrompt sa recherche quand il a ramené à lui- même et à la partie supérieure de l'âme le principe de son action; voilà ce qu'est le choix réfléchi.
»(Nous soulignons dans le texte)
Nous retiendrons donc que la délibération porte sur ce qui dépend de nous, sur les moyens et non sur la fin ;et qu'en tant que délibération, réflexion à la première personne sur ce que sont les conditions et les moyensde mon action, elle fait partie intégrante de l'action.
Ainsi si l'action est action consentie par le sujet, actionvolontaire et non pas simple réflexe, alors la délibération et la réflexion font partie intégrante de l'action..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Entre art et commerce : réflexion, spectacle et action définissent le cinéma des années 70
- La philosophie peut-elle se passer d’une réflexion sur les sciences?
- « L'homme, interprète et ministre de la nature, n'étend ses connaissances et son action qu'à mesure qu'il découvre l'ordre naturel des choses, soit par l'observation soit par la réflexion ; il ne sait et ne peut rien de plus. » Bacon, Novum Organum, 1620. Commentez.
- Se connait-on mieux soi-même par l'action que par la réflexion ?
- La philosophie peut-elle se passer d'une réflexion sur les sciences ?