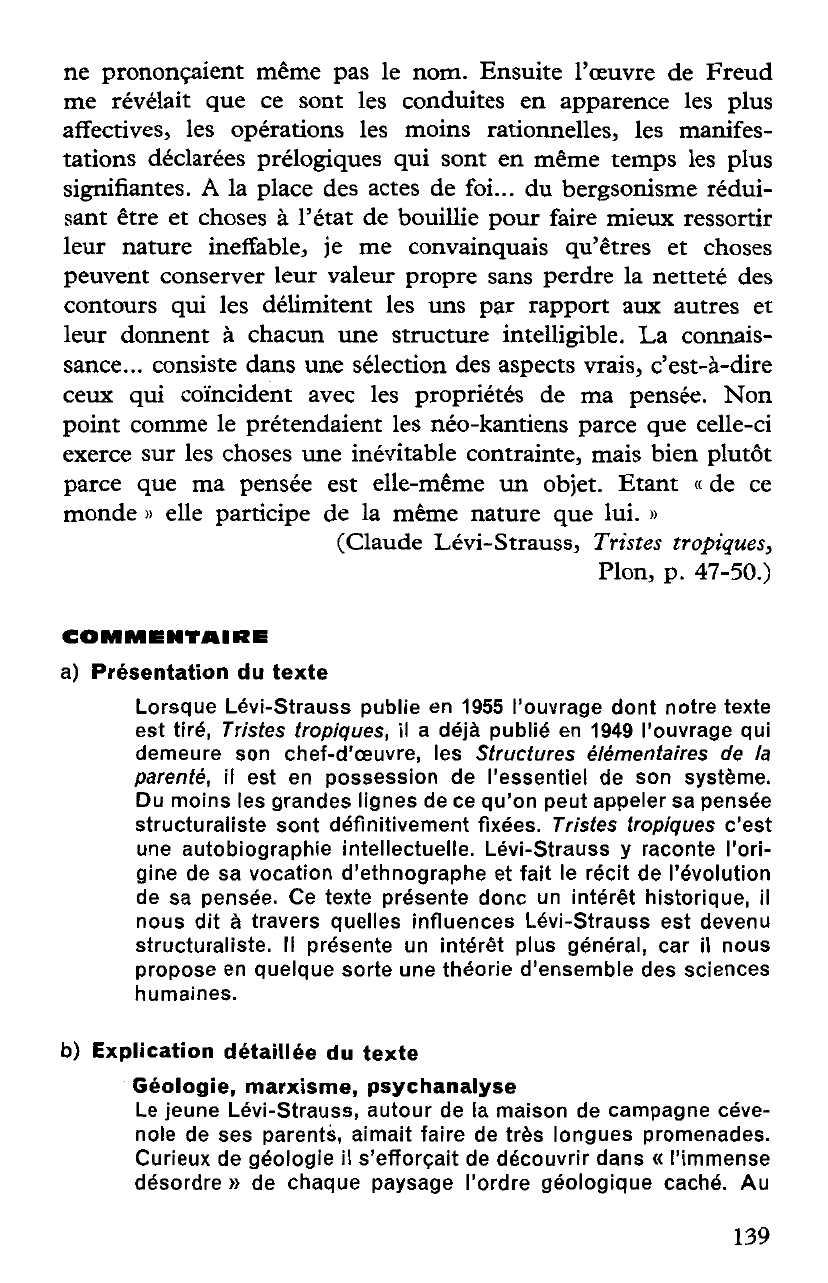LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES HUMAINES
Publié le 24/03/2015
Extrait du document
TEXTE
« A un niveau différent de la réalité le marxisme me semblait procéder de la même façon que la géologie et la psychanalyse entendue au sens que lui avait donné son fondateur : tous trois démontrent que comprendre consiste à réduire un type de réalité à un autre ; que la réalité vraie n'est jamais la plus mani¬feste, que la nature du vrai transparaît déjà dans le soin qu'il met à se dérober. Dans tous les cas le même problème se pose qui est celui du rapport entre le sensible et le rationnel et le but recherché est le même : une sorte de superrationalisme
visant à intégrer le premier au second sans rien sacrifier de ses propriétés.
« La période 1920-1930 a été celle de la diffusion des théories psychanalytiques en France. A travers elles j'apprenais... d'abord (qu') au-delà du rationnel il existait une catégorie plus impor¬tante et plus valable, celle du signifiant qui est la plus haute manière d'être du rationnel mais dont nos maîtres (plus occupés sans doute à méditer l'Essai sur les données immédiates de la conscience que le Cours de linguistique générale de F. de Saussure)
ne prononçaient même pas le nom. Ensuite l'oeuvre de Freud me révélait que ce sont les conduites en apparence les plus affectives, les opérations les moins rationnelles, les manifes-tations déclarées prélogiques qui sont en même temps les plus signifiantes. A la place des actes de foi... du bergsonisme rédui-sant être et choses à l'état de bouillie pour faire mieux ressortir leur nature ineffable, je me convainquais qu'êtres et choses peuvent conserver leur valeur propre sans perdre la netteté des contours qui les délimitent les uns par rapport aux autres et leur donnent à chacun une structure intelligible. La connais¬sance... consiste dans une sélection des aspects vrais, c'est-à-dire ceux qui coïncident avec les propriétés de ma pensée. Non point comme le prétendaient les néo-kantiens parce que celle-ci exerce sur les choses une inévitable contrainte, mais bien plutôt parce que ma pensée est elle-même un objet. Etant « de ce monde « elle participe de la même nature que lui. «
(Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Plon, p. 47-50.)
«
'' f'
'.
'' t'
"' fll
"
"
" ..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ne prononçaient même pas le nom.
Ensuite l'œuvre de Freud
me révélait que ce sont les conduites en apparence les plus
affectives, les opérations les
moins rationnelles, les manifes
tations déclarées prélogiques
qui sont en même temps les plus
signifiantes.
A la place des actes de foi...
du bergsonisme rédui
sant être et choses à l'état de bouillie pour faire mieux ressortir
leur nature ineffable, je me convainquais qu'êtres et choses
peuvent conserver leur valeur propre sans perdre la netteté des
contours qui les délimitent les uns par rapport aux autres et
leur donnent à chacun une structure intelligible.
La connais
sance ...
consiste dans
une sélection des aspects vrais, c'est-à-dire
ceux qui coïncident avec les propriétés de ma pensée.
Non
point comme le prétendaient les néo-kantiens parce que celle-ci
exerce
sur les choses une inévitable contrainte, mais bien plutôt
parce que ma pensée est elle-même un objet.
Etant « de ce
monde » elle participe de la même nature que lui.
»
COMMENTAIRE
a) Présentation du texte
(Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques,
Plon, p.
47-50.)
Lorsque Lévi-Strauss publie en 1955 l'ouvrage dont notre texte
est tiré, Tristes tropiques, il a déjà publié en 1949 l'ouvrage qui
demeure son chef-d'œuvre, les Structures élémentaires de la parenté, il est en possession de l'essentiel de son système.
Du moins les grandes lignes de ce qu'on peut appeler sa pensée
structuraliste sont définitivement fixées.
Tristes tropiques c'est une autobiographie intellectuelle.
Lévi-Strauss y raconte l'ori gine de sa vocation d'ethnographe et fait le récit de l'évolution de sa pensée.
Ce texte présente donc un intérêt historique, il
nous dit à travers quelles influences Lévi-Strauss est devenu
structuraliste.
Il présente un intérêt plus général, car il nous
propose en quelque sorte une théorie d'ensemble des sciences
humaines .
b) Explication détaillée du texte
Géologie, marxisme, psychanalyse Le jeune Lévi-Strauss, autour de la maison de campagne céve nole de ses parents, aimait faire de très longues promenades .
Curieux de géologie il s'efforçait de découvrir dans« l'immense désordre» de chaque paysage l'ordre géologique caché.
Au
139.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'herméneutique comme méthodologie des sciences humaines: Une lecture de Vérité et Méthode de Gadamer
- De toutes les sciences humaines, la science de l'homme est la plus digne de l'homme. [ De la recherche de la vérité ] Malebranche, Nicolas. Commentez cette citation.
- De toutes les sciences humaines, la science de l'homme est la plus digne de l'homme. De la recherche de la vérité Malebranche, Nicolas. Commentez cette citation.
- Descartes, Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, 1ère partie (GF, p. 75-76)
- MOTS ET LES CHOSES (LES), Une archéologie des sciences humaines, Michel Foucault