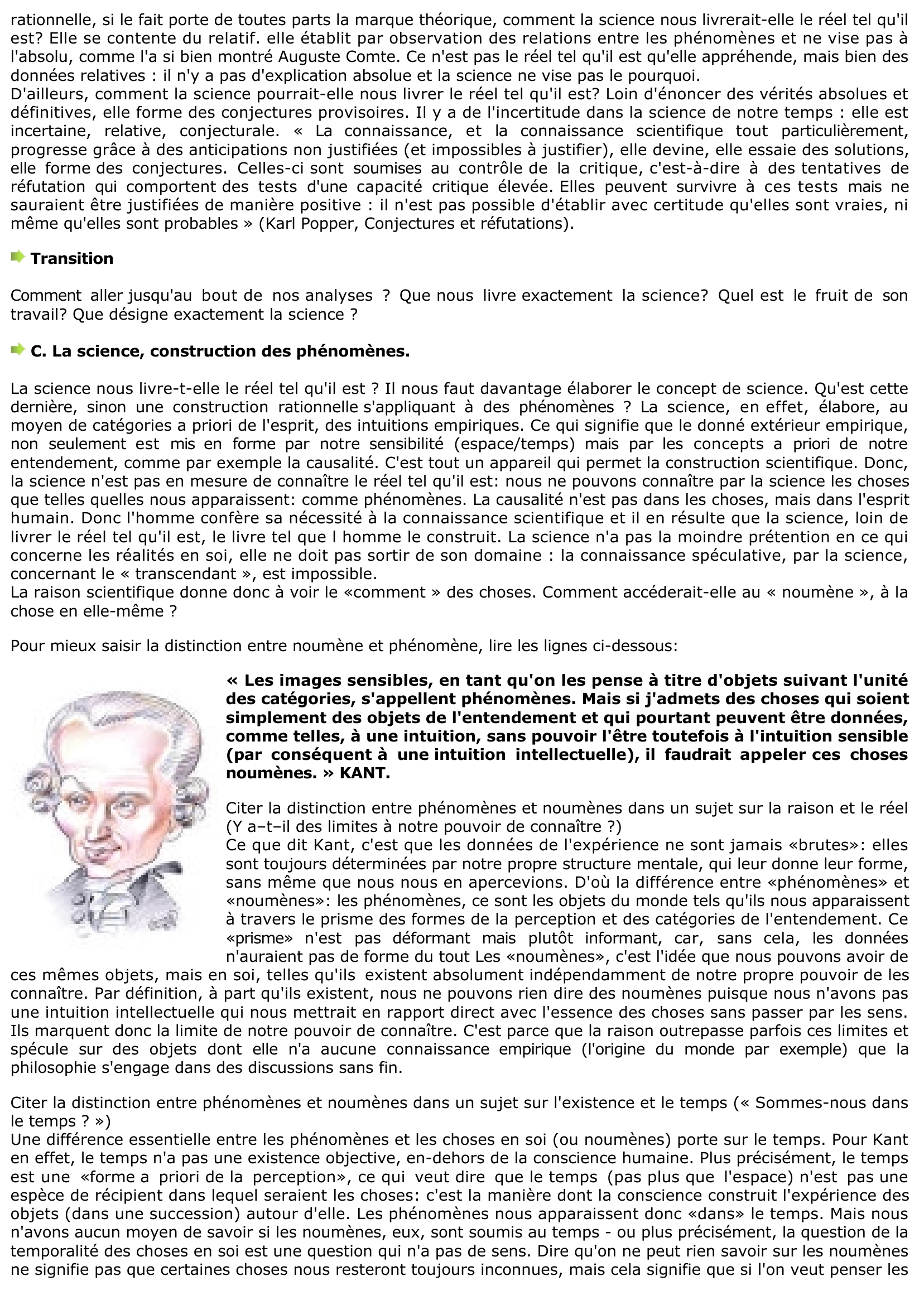La science nous livre-t-elle le réel tel qu'il est ?
Publié le 30/01/2004
Extrait du document
«
rationnelle, si le fait porte de toutes parts la marque théorique, comment la science nous livrerait-elle le réel tel qu'ilest? Elle se contente du relatif.
elle établit par observation des relations entre les phénomènes et ne vise pas àl'absolu, comme l'a si bien montré Auguste Comte.
Ce n'est pas le réel tel qu'il est qu'elle appréhende, mais bien desdonnées relatives : il n'y a pas d'explication absolue et la science ne vise pas le pourquoi.D'ailleurs, comment la science pourrait-elle nous livrer le réel tel qu'il est? Loin d'énoncer des vérités absolues etdéfinitives, elle forme des conjectures provisoires.
Il y a de l'incertitude dans la science de notre temps : elle estincertaine, relative, conjecturale.
« La connaissance, et la connaissance scientifique tout particulièrement,progresse grâce à des anticipations non justifiées (et impossibles à justifier), elle devine, elle essaie des solutions,elle forme des conjectures.
Celles-ci sont soumises au contrôle de la critique, c'est-à-dire à des tentatives deréfutation qui comportent des tests d'une capacité critique élevée.
Elles peuvent survivre à ces tests mais nesauraient être justifiées de manière positive : il n'est pas possible d'établir avec certitude qu'elles sont vraies, nimême qu'elles sont probables » (Karl Popper, Conjectures et réfutations).
Transition
Comment aller jusqu'au bout de nos analyses ? Que nous livre exactement la science? Quel est le fruit de sontravail? Que désigne exactement la science ?
C.
La science, construction des phénomènes.
La science nous livre-t-elle le réel tel qu'il est ? Il nous faut davantage élaborer le concept de science.
Qu'est cettedernière, sinon une construction rationnelle s'appliquant à des phénomènes ? La science, en effet, élabore, aumoyen de catégories a priori de l'esprit, des intuitions empiriques.
Ce qui signifie que le donné extérieur empirique,non seulement est mis en forme par notre sensibilité (espace/temps) mais par les concepts a priori de notreentendement, comme par exemple la causalité.
C'est tout un appareil qui permet la construction scientifique.
Donc,la science n'est pas en mesure de connaître le réel tel qu'il est: nous ne pouvons connaître par la science les chosesque telles quelles nous apparaissent: comme phénomènes.
La causalité n'est pas dans les choses, mais dans l'esprithumain.
Donc l'homme confère sa nécessité à la connaissance scientifique et il en résulte que la science, loin delivrer le réel tel qu'il est, le livre tel que l homme le construit.
La science n'a pas la moindre prétention en ce quiconcerne les réalités en soi, elle ne doit pas sortir de son domaine : la connaissance spéculative, par la science,concernant le « transcendant », est impossible.La raison scientifique donne donc à voir le «comment » des choses.
Comment accéderait-elle au « noumène », à lachose en elle-même ?
Pour mieux saisir la distinction entre noumène et phénomène, lire les lignes ci-dessous:
« Les images sensibles, en tant qu'on les pense à titre d'objets suivant l'unitédes catégories, s'appellent phénomènes.
Mais si j'admets des choses qui soientsimplement des objets de l'entendement et qui pourtant peuvent être données,comme telles, à une intuition, sans pouvoir l'être toutefois à l'intuition sensible(par conséquent à une intuition intellectuelle), il faudrait appeler ces chosesnoumènes.
» KANT.
Citer la distinction entre phénomènes et noumènes dans un sujet sur la raison et le réel(Y a–t–il des limites à notre pouvoir de connaître ?)Ce que dit Kant, c'est que les données de l'expérience ne sont jamais «brutes»: ellessont toujours déterminées par notre propre structure mentale, qui leur donne leur forme,sans même que nous nous en apercevions.
D'où la différence entre «phénomènes» et«noumènes»: les phénomènes, ce sont les objets du monde tels qu'ils nous apparaissentà travers le prisme des formes de la perception et des catégories de l'entendement.
Ce«prisme» n'est pas déformant mais plutôt informant, car, sans cela, les donnéesn'auraient pas de forme du tout Les «noumènes», c'est l'idée que nous pouvons avoir de ces mêmes objets, mais en soi, telles qu'ils existent absolument indépendamment de notre propre pouvoir de lesconnaître.
Par définition, à part qu'ils existent, nous ne pouvons rien dire des noumènes puisque nous n'avons pasune intuition intellectuelle qui nous mettrait en rapport direct avec l'essence des choses sans passer par les sens.Ils marquent donc la limite de notre pouvoir de connaître.
C'est parce que la raison outrepasse parfois ces limites etspécule sur des objets dont elle n'a aucune connaissance empirique (l'origine du monde par exemple) que laphilosophie s'engage dans des discussions sans fin.
Citer la distinction entre phénomènes et noumènes dans un sujet sur l'existence et le temps (« Sommes-nous dansle temps ? »)Une différence essentielle entre les phénomènes et les choses en soi (ou noumènes) porte sur le temps.
Pour Kanten effet, le temps n'a pas une existence objective, en-dehors de la conscience humaine.
Plus précisément, le tempsest une «forme a priori de la perception», ce qui veut dire que le temps (pas plus que l'espace) n'est pas uneespèce de récipient dans lequel seraient les choses: c'est la manière dont la conscience construit l'expérience desobjets (dans une succession) autour d'elle.
Les phénomènes nous apparaissent donc «dans» le temps.
Mais nousn'avons aucun moyen de savoir si les noumènes, eux, sont soumis au temps - ou plus précisément, la question de latemporalité des choses en soi est une question qui n'a pas de sens.
Dire qu'on ne peut rien savoir sur les noumènesne signifie pas que certaines choses nous resteront toujours inconnues, mais cela signifie que si l'on veut penser les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La science nous livre-t-elle le réel tel qu'il est ?
- La science nous livre-t-elle le réel tel qu'il est ?
- La science nous livre-t-elle le réel tel qu'il est ?
- La science épuise-t-elle le réel ?
- Commentez et discutez le texte suivant : « Notre époque technique n'a fait qu'augmenter le besoin d'une culture générale solide... De plus en plus, les grands industriels et même les purs scientifiques, tendent à recruter des collaborateurs cultivés de préférence à des collaborateurs avertis : les se-conds, bien souvent, ne progressent guère au-delà de leur succès initial, alors que les premiers sont sus-ceptibles d'apprendre. » « La culture générale n'est nullement cette culture vaine