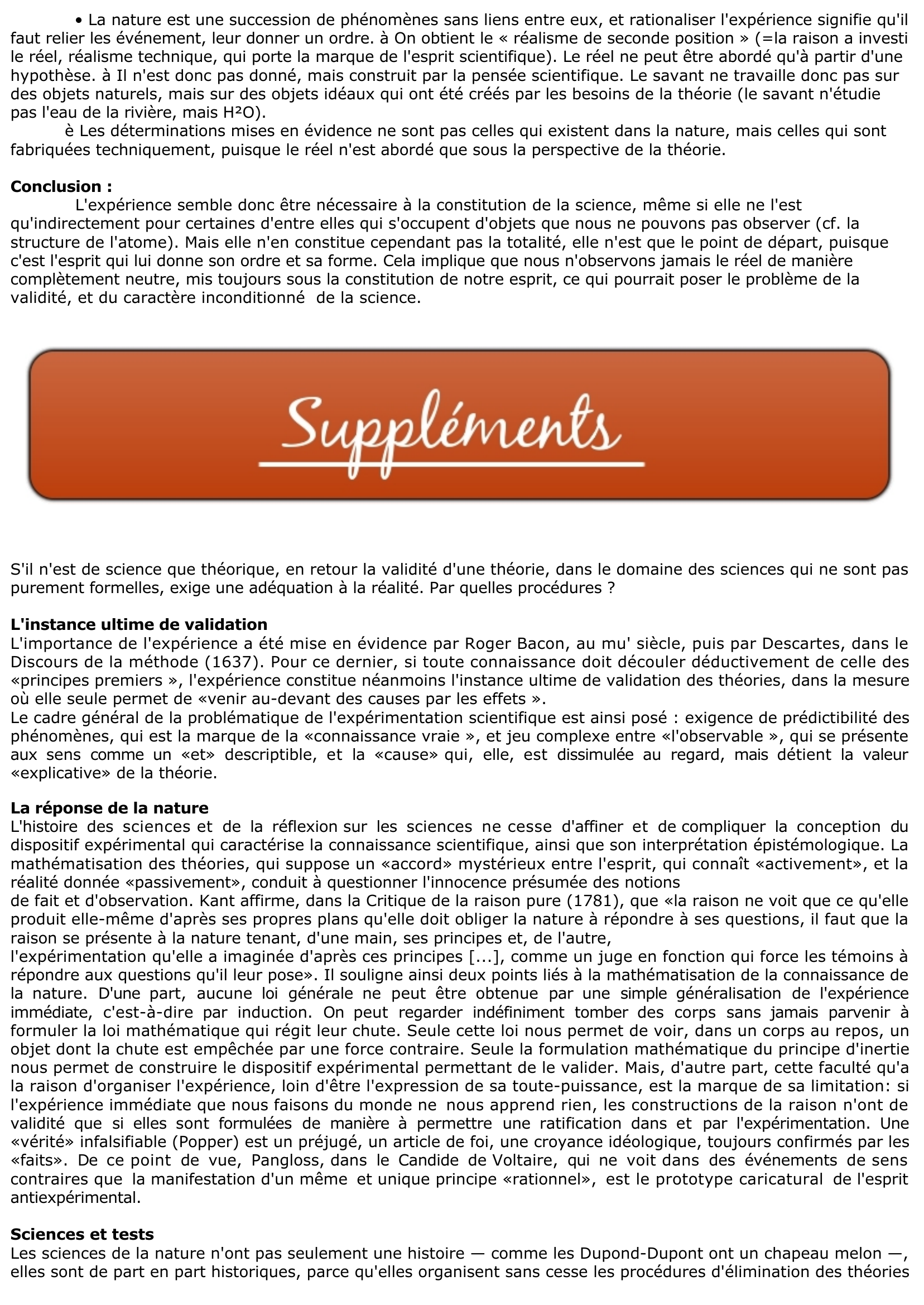La science a-t-elle pour point de départ l'expérience ?
Publié le 25/07/2009

Extrait du document
«
• La nature est une succession de phénomènes sans liens entre eux, et rationaliser l'expérience signifie qu'ilfaut relier les événement, leur donner un ordre.
à On obtient le « réalisme de seconde position » (=la raison a investi le réel, réalisme technique, qui porte la marque de l'esprit scientifique).
Le réel ne peut être abordé qu'à partir d'unehypothèse.
à Il n'est donc pas donné, mais construit par la pensée scientifique.
Le savant ne travaille donc pas sur des objets naturels, mais sur des objets idéaux qui ont été créés par les besoins de la théorie (le savant n'étudiepas l'eau de la rivière, mais H²O). è Les déterminations mises en évidence ne sont pas celles qui existent dans la nature, mais celles qui sont fabriquées techniquement, puisque le réel n'est abordé que sous la perspective de la théorie.
Conclusion : L'expérience semble donc être nécessaire à la constitution de la science, même si elle ne l'estqu'indirectement pour certaines d'entre elles qui s'occupent d'objets que nous ne pouvons pas observer (cf.
lastructure de l'atome).
Mais elle n'en constitue cependant pas la totalité, elle n'est que le point de départ, puisquec'est l'esprit qui lui donne son ordre et sa forme.
Cela implique que nous n'observons jamais le réel de manièrecomplètement neutre, mis toujours sous la constitution de notre esprit, ce qui pourrait poser le problème de lavalidité, et du caractère inconditionné de la science.
S'il n'est de science que théorique, en retour la validité d'une théorie, dans le domaine des sciences qui ne sont paspurement formelles, exige une adéquation à la réalité.
Par quelles procédures ?
L'instance ultime de validationL'importance de l'expérience a été mise en évidence par Roger Bacon, au mu' siècle, puis par Descartes, dans leDiscours de la méthode (1637).
Pour ce dernier, si toute connaissance doit découler déductivement de celle des«principes premiers », l'expérience constitue néanmoins l'instance ultime de validation des théories, dans la mesureoù elle seule permet de «venir au-devant des causes par les effets ».Le cadre général de la problématique de l'expérimentation scientifique est ainsi posé : exigence de prédictibilité desphénomènes, qui est la marque de la «connaissance vraie », et jeu complexe entre «l'observable », qui se présenteaux sens comme un «et» descriptible, et la «cause» qui, elle, est dissimulée au regard, mais détient la valeur«explicative» de la théorie.
La réponse de la natureL'histoire des sciences et de la réflexion sur les sciences ne cesse d'affiner et de compliquer la conception dudispositif expérimental qui caractérise la connaissance scientifique, ainsi que son interprétation épistémologique.
Lamathématisation des théories, qui suppose un «accord» mystérieux entre l'esprit, qui connaît «activement», et laréalité donnée «passivement», conduit à questionner l'innocence présumée des notionsde fait et d'observation.
Kant affirme, dans la Critique de la raison pure (1781), que «la raison ne voit que ce qu'elleproduit elle-même d'après ses propres plans qu'elle doit obliger la nature à répondre à ses questions, il faut que laraison se présente à la nature tenant, d'une main, ses principes et, de l'autre,l'expérimentation qu'elle a imaginée d'après ces principes [...], comme un juge en fonction qui force les témoins àrépondre aux questions qu'il leur pose».
Il souligne ainsi deux points liés à la mathématisation de la connaissance dela nature.
D'une part, aucune loi générale ne peut être obtenue par une simple généralisation de l'expérienceimmédiate, c'est-à-dire par induction.
On peut regarder indéfiniment tomber des corps sans jamais parvenir àformuler la loi mathématique qui régit leur chute.
Seule cette loi nous permet de voir, dans un corps au repos, unobjet dont la chute est empêchée par une force contraire.
Seule la formulation mathématique du principe d'inertienous permet de construire le dispositif expérimental permettant de le valider.
Mais, d'autre part, cette faculté qu'ala raison d'organiser l'expérience, loin d'être l'expression de sa toute-puissance, est la marque de sa limitation: sil'expérience immédiate que nous faisons du monde ne nous apprend rien, les constructions de la raison n'ont devalidité que si elles sont formulées de manière à permettre une ratification dans et par l'expérimentation.
Une«vérité» infalsifiable (Popper) est un préjugé, un article de foi, une croyance idéologique, toujours confirmés par les«faits».
De ce point de vue, Pangloss, dans le Candide de Voltaire, qui ne voit dans des événements de senscontraires que la manifestation d'un même et unique principe «rationnel», est le prototype caricatural de l'espritantiexpérimental.
Sciences et testsLes sciences de la nature n'ont pas seulement une histoire — comme les Dupond-Dupont ont un chapeau melon —,elles sont de part en part historiques, parce qu'elles organisent sans cesse les procédures d'élimination des théories.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La science a-t-elle son point de départ dans l'expérience?
- Dans la mesure où toute connaissance commence par l'expérience, il suit que toute nouvelle expérience est également le point de départ d'une nouvelle connaissance, et tout élargissement de l'expérience est le début d'un accroissement de la connaissance.
- Les sciences ont-elles leur point de départ dans l'expérience ?
- André Gide s'adresse ainsi à un jeune homme : « Ne cherche pas à remanger ce qu'ont digéré tes ancêtres. Vois s'envoler les grains ailés du platane et du sycomore, comme s'ils comprenaient que l'ombre paternelle ne leur promet qu'étiolement et qu'atrophie ... sache comprendre et t'éloigner le plus possible du passé. » Par ailleurs Renan a écrit : « Tous les siècles d'une nation sont les feuillets d'un même livre. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un res
- Le point de départ de Camus est le suicide.