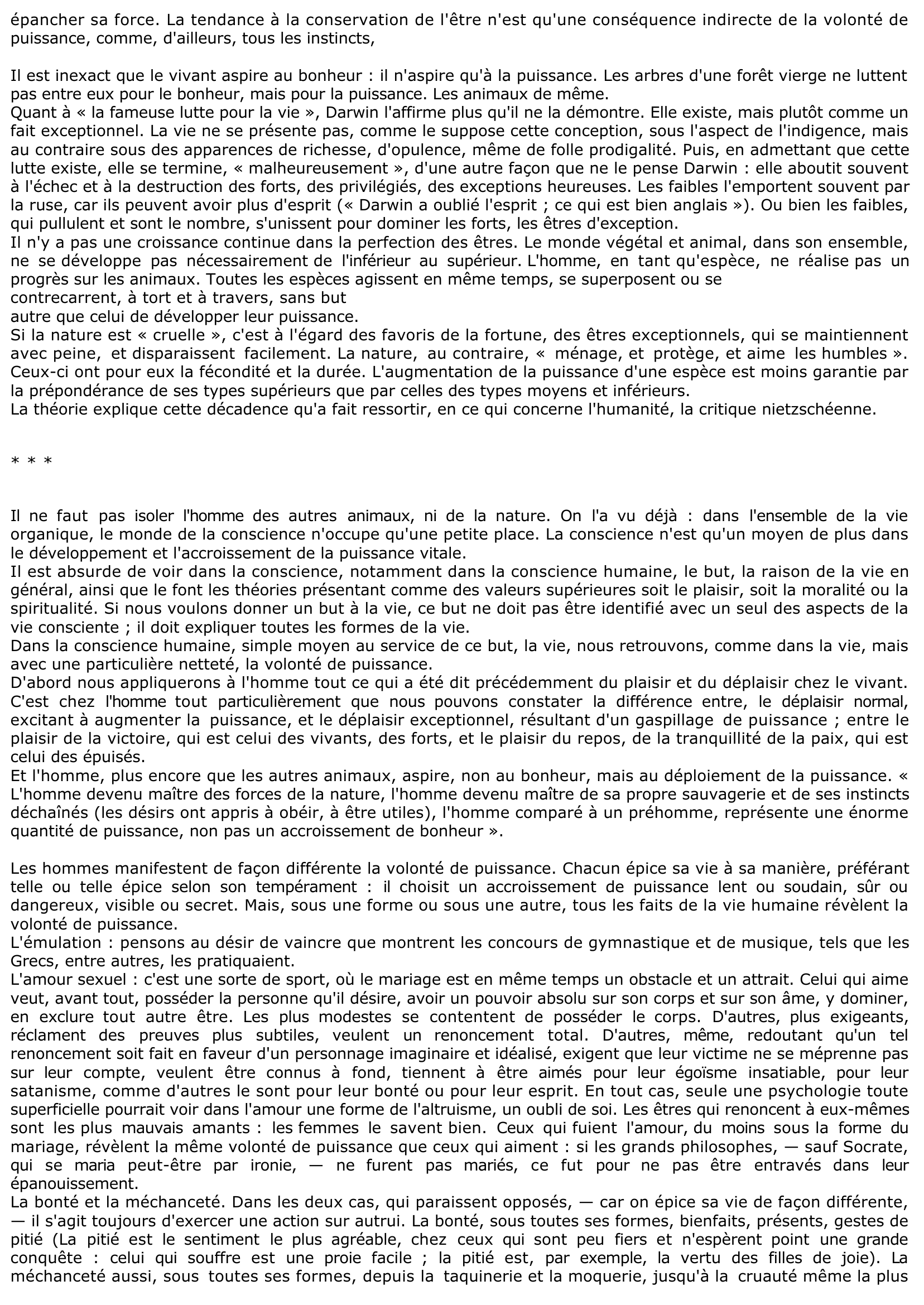LA RÉVÉLATION NIETZSCHÉENNE
Publié le 01/05/2011
Extrait du document
La critique nietzschéenne a détruit toutes les valeurs dont vivait, moralement et intellectuellement, l'humanité : quelles idées vont, désormais, pouvoir diriger les hommes ? quels espoirs ?
La foi en Dieu donnait à l'existence humaine sa signification profonde. Aujourd'hui nous savons que Dieu est mort, et nous n'apercevons pas de Dieu nouveau, dans son berceau, enveloppé dans ses langes : quel pourra être, maintenant, le sens de la vie ? Tragédie des tragédies : l'homme poète, au quatrième acte, a tué tous les Dieux, par moralité : que doit-il advenir au cinquième acte ? La réponse à ces problèmes, Nietzsche nous la donne par l'intermédiaire de son Zarathoustra : « Je veux enseigner aux hommes le sens de leur existence «, dit le prophète. Avant d'écouter le maître, voyons-le, tel que nous le montre M. Charles Andler, dans le dernier des beaux ouvrages qu'il a consacrés à Nietzsche : « Il faut se représenter Zarathoustra sous les traits de Léonard de Vinci, dessiné par le peintre lui-même, et conservé au Musée de Turin. Le front déjà dénudé est encadré de longues boucles qui retombent plus bas que l'épaule, et se mêlent à une barbe de prophète. Des sourcils dignes de Moïse abritent des yeux sévères et profonds. La lèvre supérieure, dégagée, se dessine entre deux douloureuses rides, qui tombent du nez aquilin. Un pli méditatif et volontaire incurve la bouche délicate et austère. Jamais visage plus éclairé d'humaine sagesse, ni plus raviné de douleur, ne garda sur ses traits majesté plus divine. Une tunique sobrement drapée, comme celle des archers de Suse, eût complété, dans la pensée de Nietzsche, cette apparition royale, appuyée sur un long sceptre au pommeau d'or «. Zarathoustra va nous apporter un nouvel idéal, humain, surhumain, inhumain peut-être. La révélation nietzschéenne qu'expose le prophète tient en quatre idée:, : volonté de puissance, transvaluation des valeurs, Surhomme, Retour éternel.
«
épancher sa force.
La tendance à la conservation de l'être n'est qu'une conséquence indirecte de la volonté depuissance, comme, d'ailleurs, tous les instincts,
Il est inexact que le vivant aspire au bonheur : il n'aspire qu'à la puissance.
Les arbres d'une forêt vierge ne luttentpas entre eux pour le bonheur, mais pour la puissance.
Les animaux de même.Quant à « la fameuse lutte pour la vie », Darwin l'affirme plus qu'il ne la démontre.
Elle existe, mais plutôt comme unfait exceptionnel.
La vie ne se présente pas, comme le suppose cette conception, sous l'aspect de l'indigence, maisau contraire sous des apparences de richesse, d'opulence, même de folle prodigalité.
Puis, en admettant que cettelutte existe, elle se termine, « malheureusement », d'une autre façon que ne le pense Darwin : elle aboutit souventà l'échec et à la destruction des forts, des privilégiés, des exceptions heureuses.
Les faibles l'emportent souvent parla ruse, car ils peuvent avoir plus d'esprit (« Darwin a oublié l'esprit ; ce qui est bien anglais »).
Ou bien les faibles,qui pullulent et sont le nombre, s'unissent pour dominer les forts, les êtres d'exception.Il n'y a pas une croissance continue dans la perfection des êtres.
Le monde végétal et animal, dans son ensemble,ne se développe pas nécessairement de l'inférieur au supérieur.
L'homme, en tant qu'espèce, ne réalise pas unprogrès sur les animaux.
Toutes les espèces agissent en même temps, se superposent ou secontrecarrent, à tort et à travers, sans butautre que celui de développer leur puissance.Si la nature est « cruelle », c'est à l'égard des favoris de la fortune, des êtres exceptionnels, qui se maintiennentavec peine, et disparaissent facilement.
La nature, au contraire, « ménage, et protège, et aime les humbles ».Ceux-ci ont pour eux la fécondité et la durée.
L'augmentation de la puissance d'une espèce est moins garantie parla prépondérance de ses types supérieurs que par celles des types moyens et inférieurs.La théorie explique cette décadence qu'a fait ressortir, en ce qui concerne l'humanité, la critique nietzschéenne.
* * *
Il ne faut pas isoler l'homme des autres animaux, ni de la nature.
On l'a vu déjà : dans l'ensemble de la vieorganique, le monde de la conscience n'occupe qu'une petite place.
La conscience n'est qu'un moyen de plus dansle développement et l'accroissement de la puissance vitale.Il est absurde de voir dans la conscience, notamment dans la conscience humaine, le but, la raison de la vie engénéral, ainsi que le font les théories présentant comme des valeurs supérieures soit le plaisir, soit la moralité ou laspiritualité.
Si nous voulons donner un but à la vie, ce but ne doit pas être identifié avec un seul des aspects de lavie consciente ; il doit expliquer toutes les formes de la vie.Dans la conscience humaine, simple moyen au service de ce but, la vie, nous retrouvons, comme dans la vie, maisavec une particulière netteté, la volonté de puissance.D'abord nous appliquerons à l'homme tout ce qui a été dit précédemment du plaisir et du déplaisir chez le vivant.C'est chez l'homme tout particulièrement que nous pouvons constater la différence entre, le déplaisir normal,excitant à augmenter la puissance, et le déplaisir exceptionnel, résultant d'un gaspillage de puissance ; entre leplaisir de la victoire, qui est celui des vivants, des forts, et le plaisir du repos, de la tranquillité de la paix, qui estcelui des épuisés.Et l'homme, plus encore que les autres animaux, aspire, non au bonheur, mais au déploiement de la puissance.
«L'homme devenu maître des forces de la nature, l'homme devenu maître de sa propre sauvagerie et de ses instinctsdéchaînés (les désirs ont appris à obéir, à être utiles), l'homme comparé à un préhomme, représente une énormequantité de puissance, non pas un accroissement de bonheur ».
Les hommes manifestent de façon différente la volonté de puissance.
Chacun épice sa vie à sa manière, préféranttelle ou telle épice selon son tempérament : il choisit un accroissement de puissance lent ou soudain, sûr oudangereux, visible ou secret.
Mais, sous une forme ou sous une autre, tous les faits de la vie humaine révèlent lavolonté de puissance.L'émulation : pensons au désir de vaincre que montrent les concours de gymnastique et de musique, tels que lesGrecs, entre autres, les pratiquaient.L'amour sexuel : c'est une sorte de sport, où le mariage est en même temps un obstacle et un attrait.
Celui qui aimeveut, avant tout, posséder la personne qu'il désire, avoir un pouvoir absolu sur son corps et sur son âme, y dominer,en exclure tout autre être.
Les plus modestes se contentent de posséder le corps.
D'autres, plus exigeants,réclament des preuves plus subtiles, veulent un renoncement total.
D'autres, même, redoutant qu'un telrenoncement soit fait en faveur d'un personnage imaginaire et idéalisé, exigent que leur victime ne se méprenne passur leur compte, veulent être connus à fond, tiennent à être aimés pour leur égoïsme insatiable, pour leursatanisme, comme d'autres le sont pour leur bonté ou pour leur esprit.
En tout cas, seule une psychologie toutesuperficielle pourrait voir dans l'amour une forme de l'altruisme, un oubli de soi.
Les êtres qui renoncent à eux-mêmessont les plus mauvais amants : les femmes le savent bien.
Ceux qui fuient l'amour, du moins sous la forme dumariage, révèlent la même volonté de puissance que ceux qui aiment : si les grands philosophes, — sauf Socrate,qui se maria peut-être par ironie, — ne furent pas mariés, ce fut pour ne pas être entravés dans leurépanouissement.La bonté et la méchanceté.
Dans les deux cas, qui paraissent opposés, — car on épice sa vie de façon différente,— il s'agit toujours d'exercer une action sur autrui.
La bonté, sous toutes ses formes, bienfaits, présents, gestes depitié (La pitié est le sentiment le plus agréable, chez ceux qui sont peu fiers et n'espèrent point une grandeconquête : celui qui souffre est une proie facile ; la pitié est, par exemple, la vertu des filles de joie).
Laméchanceté aussi, sous toutes ses formes, depuis la taquinerie et la moquerie, jusqu'à la cruauté même la plus.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CHOSES DIVINES ET DE LEUR RÉVÉLATION (Des) Friedrich Heinrich Jacobi (résumé & analyse)
- VÉRITÉ EN TANT QU’ELLE EST DISTINCTE DE LA RÉVÉLATION, DU VRAISEMBLABLE, DU POSSIBLE ET DU FAUX (De la)
- APOCALYPSE (L') (révélation), « Nouveau Testament » de l'apôtre Jean de Pathmos (résumé & analyse)
- PHILOSOPHIE DE LA RÉVÉLATION de Schelling
- Nicolas Berdiaeff, Vérité et Révélation.