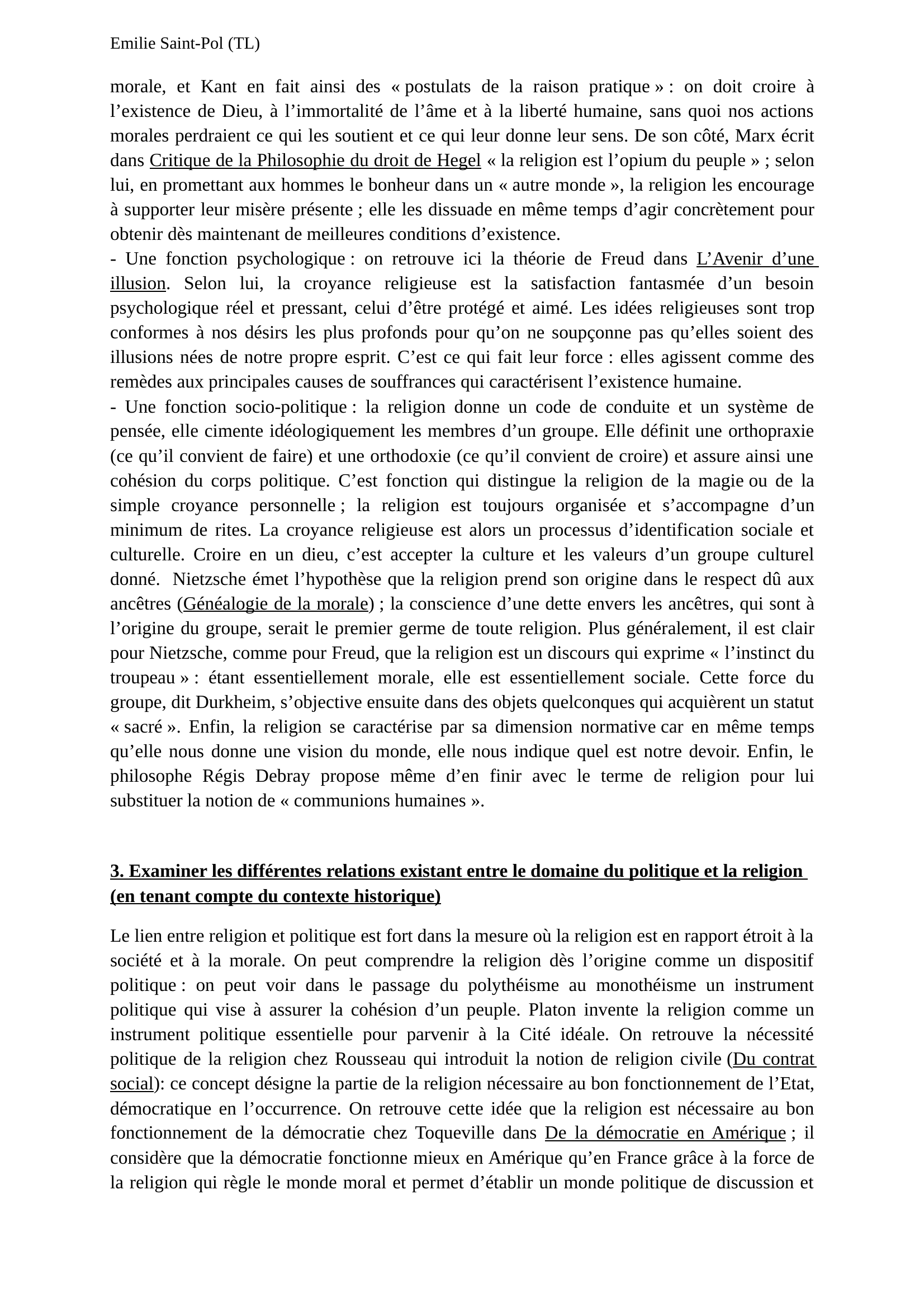la religion
Publié le 17/05/2014
Extrait du document


«
Emilie Saint-Pol (TL)
morale, et Kant en fait ainsi des « postulats de la raison pratique » : on doit croire à
l’existence de Dieu, à l’immortalité de l’âme et à la liberté humaine, sans quoi nos actions
morales perdraient ce qui les soutient et ce qui leur donne leur sens.
De son côté, Marx écrit
dans Critique de la Philosophie du droit de Hegel « la religion est l’opium du peuple » ; selon
lui, en promettant aux hommes le bonheur dans un « autre monde », la religion les encourage
à supporter leur misère présente ; elle les dissuade en même temps d’agir concrètement pour
obtenir dès maintenant de meilleures conditions d’existence.
- Une fonction psychologique : on retrouve ici la théorie de Freud dans L’Avenir d’une
illusion .
Selon lui, la croyance religieuse est la satisfaction fantasmée d’un besoin
psychologique réel et pressant, celui d’être protégé et aimé.
Les idées religieuses sont trop
conformes à nos désirs les plus profonds pour qu’on ne soupçonne pas qu’elles soient des
illusions nées de notre propre esprit.
C’est ce qui fait leur force : elles agissent comme des
remèdes aux principales causes de souffrances qui caractérisent l’existence humaine.
- Une fonction socio-politique : la religion donne un code de conduite et un système de
pensée, elle cimente idéologiquement les membres d’un groupe.
Elle définit une orthopraxie
(ce qu’il convient de faire) et une orthodoxie (ce qu’il convient de croire) et assure ainsi une
cohésion du corps politique.
C’est fonction qui distingue la religion de la magie ou de la
simple croyance personnelle ; la religion est toujours organisée et s’accompagne d’un
minimum de rites.
La croyance religieuse est alors un processus d’identification sociale et
culturelle.
Croire en un dieu, c’est accepter la culture et les valeurs d’un groupe culturel
donné.
Nietzsche émet l’hypothèse que la religion prend son origine dans le respect dû aux
ancêtres ( Généalogie de la morale ) ; la conscience d’une dette envers les ancêtres, qui sont à
l’origine du groupe, serait le premier germe de toute religion.
Plus généralement, il est clair
pour Nietzsche, comme pour Freud, que la religion est un discours qui exprime « l’instinct du
troupeau » : étant essentiellement morale, elle est essentiellement sociale.
Cette force du
groupe, dit Durkheim, s’objective ensuite dans des objets quelconques qui acquièrent un statut
« sacré ».
Enfin, la religion se caractérise par sa dimension normative car en même temps
qu’elle nous donne une vision du monde, elle nous indique quel est notre devoir.
Enfin, le
philosophe Régis Debray propose même d’en finir avec le terme de religion pour lui
substituer la notion de « communions humaines ».
3.
Examiner les différentes relations existant entre le domaine du politique et la religion
(en tenant compte du contexte historique)
Le lien entre religion et politique est fort dans la mesure où la religion est en rapport étroit à la
société et à la morale.
On peut comprendre la religion dès l’origine comme un dispositif
politique : on peut voir dans le passage du polythéisme au monothéisme un instrument
politique qui vise à assurer la cohésion d’un peuple.
Platon invente la religion comme un
instrument politique essentielle pour parvenir à la Cité idéale.
On retrouve la nécessité
politique de la religion chez Rousseau qui introduit la notion de religion civile ( Du contrat
social ): ce concept désigne la partie de la religion nécessaire au bon fonctionnement de l’Etat,
démocratique en l’occurrence.
On retrouve cette idée que la religion est nécessaire au bon
fonctionnement de la démocratie chez Toqueville dans De la démocratie en Amérique ; il
considère que la démocratie fonctionne mieux en Amérique qu’en France grâce à la force de
la religion qui règle le monde moral et permet d’établir un monde politique de discussion et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Relationship between religion, spirituality, and young Lebanese university students’ well-being.
- : En quoi ce passage est-il une parodie des romans de chevalerie et une satire de la religion ?
- ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET SOCIALE. THEME : LE MOUVEMENT ALMORAVIDE ENTRE ECONOMIE ET RELIGION.
- Ethique appendice du livre I de Spinoza: déterminisme et religion
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?