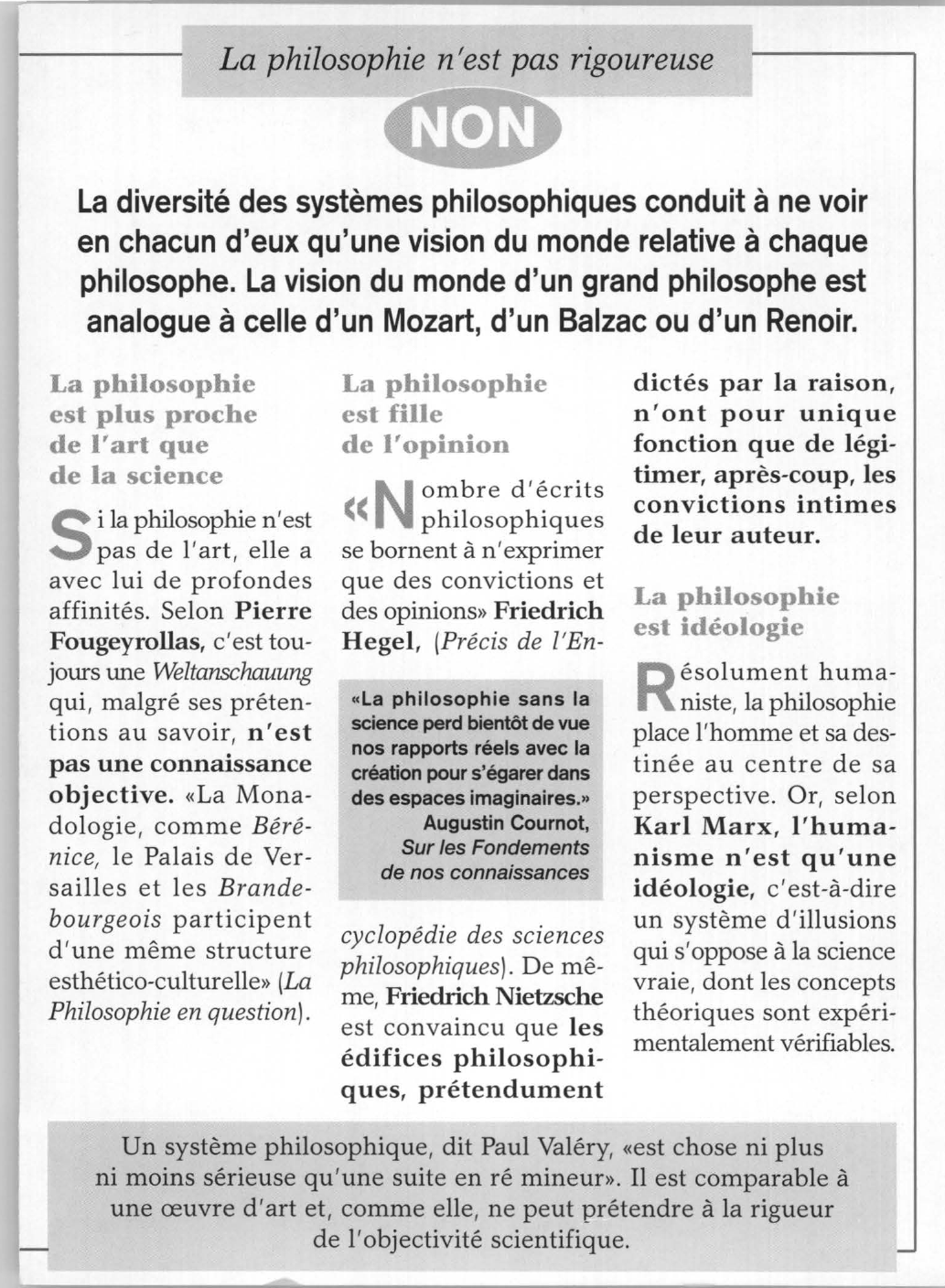La philosophie peut-elle se prétendre rigoureuse ?
Publié le 28/02/2004
Extrait du document

PHILOSOPHIE (gr. philo, désirer; sophia, savoir) Étymologiquement, « amour de la sagesse ». Cependant, la sagesse n'étant qu'un art de vivre, la définition commune de la philosophie comme sagesse" est critiquable. En effet, sophia désigne en fait moins un savoir empirique adapté à la conduite de la vie qu'un savoir abstrait. En ce sens, la philosophie est essentiellement élévation de la pensée, théoria, contemplation. Cependant, comme l'indique l'allégorie de la caverne de Platon, le philosophe ne quitte le monde sensible que pour y redescendre, puisqu'il lui revient de gouverner la cité idéale. S'il s'agit de s'exercer à l'abstraction, il faut ne pas s'y perdre. Or, si la philosophie ancienne reste encore marquée par l'opposition de la contemplation (théoria) et de l'action (praxis"), la philosophie moderne est plutôt soucieuse d'abolir cette distinction, comme le signale le projet cartésien de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Elle cesse alors d'être un savoir désintéressé pour se mettre au service de la construction d'un monde régi par la science". Du coup, elle risque ou bien de devenir une spécialité comme les autres, ou bien, refusant cette spécialisation, de passer pour une activité dilettante réservée à quelques dandys de la pensée. Telle est l'aporie du philosophe contemporain : rester un généraliste sans sombrer dans l'insignifiance. Dès lors, pour éviter ce piège, la philosophie doit affirmer son sérieux par la prudence d'un jugement née de l'accumulation du savoir. Elle devient ainsi histoire de la philosophie, non pas connaissance érudite des doctrines, mais plutôt éveil de la pensée à elle-même à partir de ce qu'ont pensé les autres. Le développement de la philosophie peut alors se comprendre comme celui de la vérité à travers les différents moments nécessaires à son déploiement. Cette définition dialectique, proposée par Hegel, permet de saisir la nécessité rationnelle qui gouverne l'histoire de la philosophie : le philosophe est fils de son temps, et comme ceux d'hier, il lui revient de répondre aux besoins de son époque. La philosophie ne se réduit donc pas à ses oeuvres qui sont comme les tombeaux de la philosophie passée : elle est essentiellement vivante dans l'activité présente de penser, qu'exprime magnifiquement tout enseignement où le maître, à la manière de Socrate, requiert la participation du disciple.

«
La philosophie n'est pas rigoureuse
La diversité des systèmes philosophiques conduit à ne voir
en chacun d'eux qu'une vision du monde relative à chaque
philosophe.
La vision du monde d'un grand philosophe est
analogue à celle d'un Mozart, d'un Balzac ou d'un Renoir.
La philosophie
est plus proche
de l'art que
de la science
S
i la philosophie n'est
pas de l'art, elle a
avec lui de profondes
affinités.
Selon Pierre
Fougeyrollas, c'est tou
jours
une Weltanschauung
qui, malgré ses préten
tions au savoir, n'est
pas une connaissance
objective.
«La Mona
dologie, comme Béré
nice,
le Palais de Ver
sailles et les Brande
bourgeois parti ci pen t
d 'une même structure
esthético-culturelle» (La
Philosophie en question).
La philosophie
est fille
de l'opinion
N
ombre d'écrits
(( philosophiques
se bornent à n'exprimer
que des convictions et
des opinions» Friedrich
Hegel, (Précis de l'En-
•La philosophie sans la science perd bientôt de vue
nos rapports réels avec la création pour s'égarer dans
des espaces imaginaires.•
Augustin Cournot,
Sur les Fondements
de nos connaissances
cyclopédie des sciences
philosophiques).
De mê
me , Friedrich Nietzsche
est convaincu que les
édifices philosophi
ques, prétendument
dictés par la raison,
n'ont pour unique
fonction que de légi
timer, après-coup, les
convictions intimes
de leur auteur.
La philosophie
est idéologie
R
ésolument huma
niste, la philosophie
place l'
homme et sa des
tinée au centre de sa
perspective.
Or, selon
Karl Marx, l'huma
nisme n'est qu'une
idéologie, c'est -à -dire
un système d'illusions
qui s'oppose à la science
vraie,
dont les concepts
théoriques sont expéri
mentalement vérifiables.
Un système philosophique, dit Paul Valéry, «est chose ni plus
ni moins sérieuse qu'une suite en ré mineur».
Il est comparable à
une œuvre d'art et, comme elle, ne peut prétendre à la rigueur
de l 'objectivité scientifique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quoi la philosophie peut elle prétendre être rigoureuse ?
- Pourquoi la philosophie est-elle moins rigoureuse et scientifique que les mathématiques ?
- Suffit-il de prétendre que la philosophie est inutile pour la récuser légitimement ?
- l'absence d'unanimité empêche-t-elle la philosophie de prétendre dire la vérité ?
- PHILOSOPHIE COMME SCIENCE RIGOUREUSE (LA), Edmund Husserl