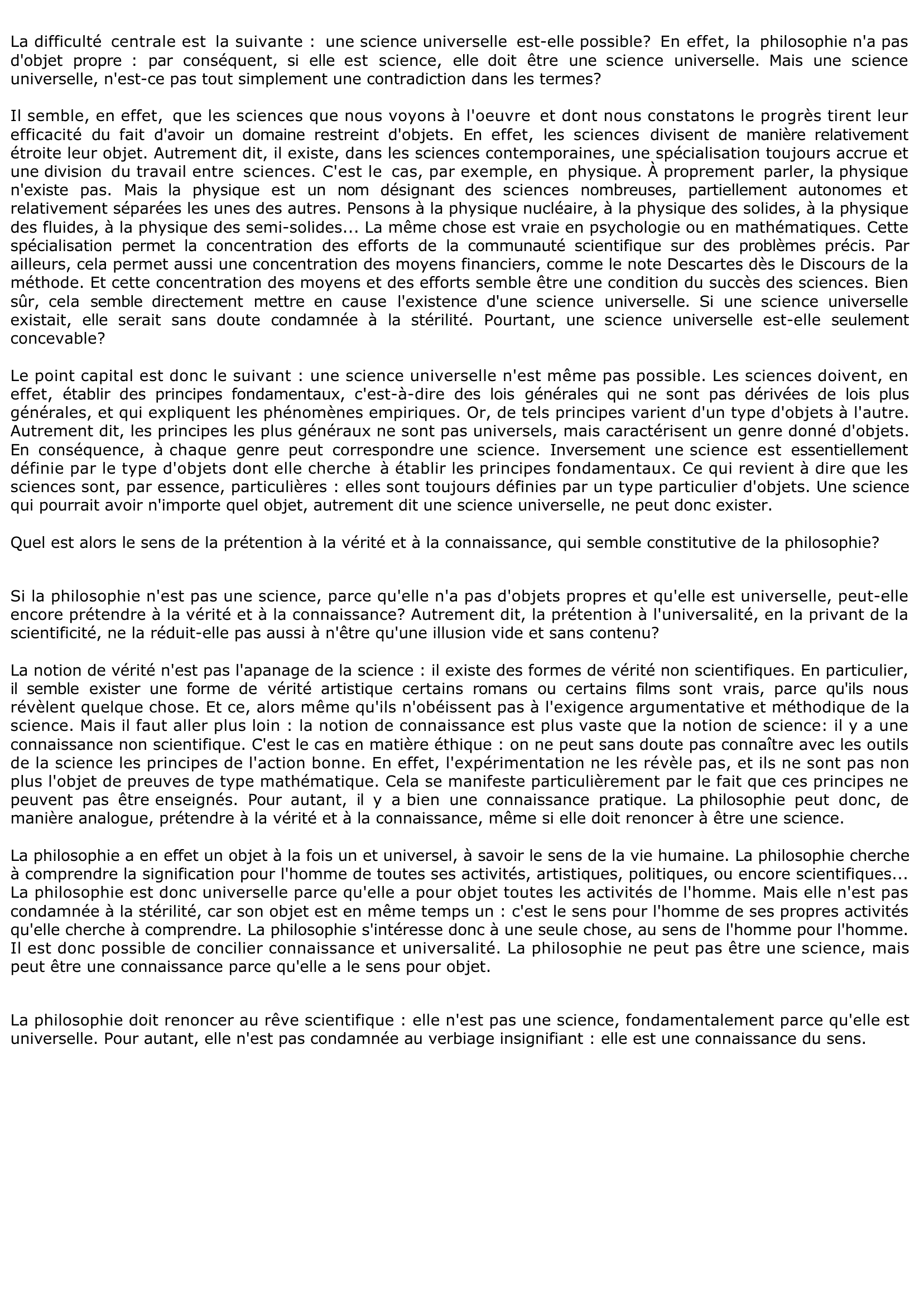La philosophie est-elle une science ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document

HTML clipboard Le mot « philosophie « vient du grec « philosophia «, terme composé de deux racines, philo- et sophia. L'adjectif correspondant à cette seconde partie du mot, à savoir « sophos «, est ambigu : cet adjectif désigne aussi bien le sage que le savant. Cette étymologie suggère que la philosophie entretient une relation complexe avec la science : en particulier, peut-on affirmer que la philosophie est une science?

«
La difficulté centrale est la suivante : une science universelle est-elle possible? En effet, la philosophie n'a pasd'objet propre : par conséquent, si elle est science, elle doit être une science universelle.
Mais une scienceuniverselle, n'est-ce pas tout simplement une contradiction dans les termes?
Il semble, en effet, que les sciences que nous voyons à l'oeuvre et dont nous constatons le progrès tirent leurefficacité du fait d'avoir un domaine restreint d'objets.
En effet, les sciences divisent de manière relativementétroite leur objet.
Autrement dit, il existe, dans les sciences contemporaines, une spécialisation toujours accrue etune division du travail entre sciences.
C'est le cas, par exemple, en physique.
À proprement parler, la physiquen'existe pas.
Mais la physique est un nom désignant des sciences nombreuses, partiellement autonomes etrelativement séparées les unes des autres.
Pensons à la physique nucléaire, à la physique des solides, à la physiquedes fluides, à la physique des semi-solides...
La même chose est vraie en psychologie ou en mathématiques.
Cettespécialisation permet la concentration des efforts de la communauté scientifique sur des problèmes précis.
Parailleurs, cela permet aussi une concentration des moyens financiers, comme le note Descartes dès le Discours de laméthode.
Et cette concentration des moyens et des efforts semble être une condition du succès des sciences.
Biensûr, cela semble directement mettre en cause l'existence d'une science universelle.
Si une science universelleexistait, elle serait sans doute condamnée à la stérilité.
Pourtant, une science universelle est-elle seulementconcevable?
Le point capital est donc le suivant : une science universelle n'est même pas possible.
Les sciences doivent, eneffet, établir des principes fondamentaux, c'est-à-dire des lois générales qui ne sont pas dérivées de lois plusgénérales, et qui expliquent les phénomènes empiriques.
Or, de tels principes varient d'un type d'objets à l'autre.Autrement dit, les principes les plus généraux ne sont pas universels, mais caractérisent un genre donné d'objets.En conséquence, à chaque genre peut correspondre une science.
Inversement une science est essentiellementdéfinie par le type d'objets dont elle cherche à établir les principes fondamentaux.
Ce qui revient à dire que lessciences sont, par essence, particulières : elles sont toujours définies par un type particulier d'objets.
Une sciencequi pourrait avoir n'importe quel objet, autrement dit une science universelle, ne peut donc exister.
Quel est alors le sens de la prétention à la vérité et à la connaissance, qui semble constitutive de la philosophie?
Si la philosophie n'est pas une science, parce qu'elle n'a pas d'objets propres et qu'elle est universelle, peut-elleencore prétendre à la vérité et à la connaissance? Autrement dit, la prétention à l'universalité, en la privant de lascientificité, ne la réduit-elle pas aussi à n'être qu'une illusion vide et sans contenu?
La notion de vérité n'est pas l'apanage de la science : il existe des formes de vérité non scientifiques.
En particulier,il semble exister une forme de vérité artistique certains romans ou certains films sont vrais, parce qu'ils nousrévèlent quelque chose.
Et ce, alors même qu'ils n'obéissent pas à l'exigence argumentative et méthodique de lascience.
Mais il faut aller plus loin : la notion de connaissance est plus vaste que la notion de science: il y a uneconnaissance non scientifique.
C'est le cas en matière éthique : on ne peut sans doute pas connaître avec les outilsde la science les principes de l'action bonne.
En effet, l'expérimentation ne les révèle pas, et ils ne sont pas nonplus l'objet de preuves de type mathématique.
Cela se manifeste particulièrement par le fait que ces principes nepeuvent pas être enseignés.
Pour autant, il y a bien une connaissance pratique.
La philosophie peut donc, demanière analogue, prétendre à la vérité et à la connaissance, même si elle doit renoncer à être une science.
La philosophie a en effet un objet à la fois un et universel, à savoir le sens de la vie humaine.
La philosophie chercheà comprendre la signification pour l'homme de toutes ses activités, artistiques, politiques, ou encore scientifiques...La philosophie est donc universelle parce qu'elle a pour objet toutes les activités de l'homme.
Mais elle n'est pascondamnée à la stérilité, car son objet est en même temps un : c'est le sens pour l'homme de ses propres activitésqu'elle cherche à comprendre.
La philosophie s'intéresse donc à une seule chose, au sens de l'homme pour l'homme.Il est donc possible de concilier connaissance et universalité.
La philosophie ne peut pas être une science, maispeut être une connaissance parce qu'elle a le sens pour objet.
La philosophie doit renoncer au rêve scientifique : elle n'est pas une science, fondamentalement parce qu'elle estuniverselle.
Pour autant, elle n'est pas condamnée au verbiage insignifiant : elle est une connaissance du sens..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE OU DROIT, ou Droit naturel et science de l’État en abrégé, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- PHYSIQUE ET PHILOSOPHIE, la Science moderne en révolution, Werner Karl Heisenberg - résumé de l'oeuvre
- SCIENCE ET PHILOSOPHIE, 1886. Marcelin Berthelot (résumé & analyse)
- PARABOLES ET CATASTROPHES, Entretiens sur les mathématiques, la science et la philosophie, René Thom
- PRINCIPES D’UNE SCIENCE NOUVELLE RELATIVE A LA NATURE DES NATIONS ou PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DE L’HISTOIRE, Giambattista Vico