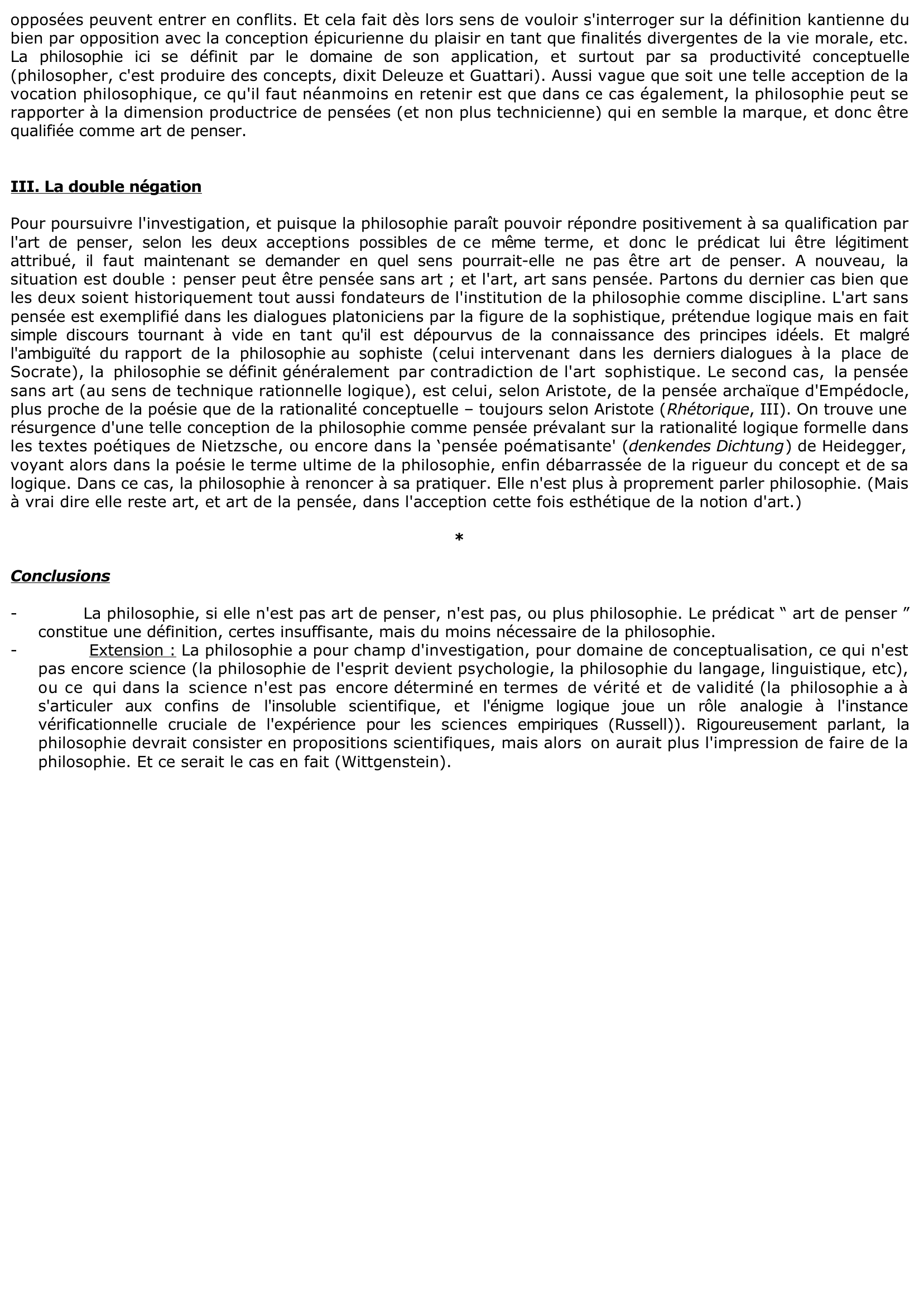La philosophie est-elle un art de penser ?
Publié le 26/10/2009
Extrait du document

Incipit : Vouloir définir la philosophie trace un étrange cercle qui la conduit à elle-même se prendre pour objet. Car la philosophie, tel que l’énoncé de l’exercice l’exige, ne peut se définir qu’à l’aide de ses propres moyens (en effet, définir la philosophie est toujours déjà philosopher), pour autant qu’il s’agisse de savoir ce qu’elle est, c’est-à-dire à en donner une définition. Aussi toute tentative de répondre à la question de la définition de la philosophie n’est jamais idéologiquement neutre. En vue de clarifier la structure circulaire de l’énoncé à traiter, explicitons en les termes. Afin d’éviter toute pétition de principe (supposer ce qui est à démontrer, ou du moins, supposer donnée la réponse à apporter au problème), les thèmes ne doivent pas comprendre la notion de philosophie elle-même, car cela serait présupposer défini ce qui est à définir.
Thèmes : L’énoncé proposé simplifie l’exigence de donner une définition à la philosophie en interrogeant uniquement sur la légitimité d’une attribution prédicative (être un art de penser) au sujet de la philosophie. En ce sens, il ne s’agit pas à proprement parler d’une définition de la philosophie, mais plutôt de reconnaître, ou non, la validité d’une manière de qualifier la philosophie. En insistant sur le caractère prédicatif de l’exercice de définition, nous voulons indiquer que cette dernière pourrait ne pas être exhaustive, autrement dit que le fait d’être caractérisable, ou non, en tant qu’art de penser pourrait n’être qu’un qualificatif parmi d’autres permettant de restreindre l’acception de la notion de philosophie. (i) Art : le terme d’art est ici à prendre dans sa signification propre, à savoir en tant que technique, ensemble de règles prescriptives assurant la réalisation d’un produit extérieur à la production, à l’acte de produire (telle est la définition aristotélicienne de la technè). Deux choses sont ici à souligner : l’extériorité de l’objet produit envers la logique de production, et la dimension technique de l’art, le fait d’être constitué par un ensemble codifié de principes dirigeant la pratique. (ii) Penser : en tant que verbe, il s’agit d’une activité. Mais évidemment, son étymologie tend à immédiatement le rapporter à la question de la définition de la pensée comme concept abstrait. Définir la pensée serait un exercice d’une complexité au moins égale à la tentative de définir la philosophie in abstracto, sans le guide que nous fourni l’énoncé par avec son questionnement restreint à la légitimité d’une prédication. Ce qu’on peut toutefois en dire sommairement est que penser qualifie une activité de l’esprit obéissant à des lois (d’où la possibilité de raisonner) et appliquée à un objet, qu’il soit abstrait, comme dans le cas du concept ou idée, ou concret, comme c’est le cas lors de la confrontation de l’esprit à l’expérience du monde réel. (iii) “ Art de penser ” : ce dernier peut maintenant se caractériser comme la production d’un objet, la pensée rationnelle, selon l’application des lois de l’esprit, ou règles logiques du raisonnement.

«
opposées peuvent entrer en conflits.
Et cela fait dès lors sens de vouloir s'interroger sur la définition kantienne dubien par opposition avec la conception épicurienne du plaisir en tant que finalités divergentes de la vie morale, etc.La philosophie ici se définit par le domaine de son application, et surtout par sa productivité conceptuelle(philosopher, c'est produire des concepts, dixit Deleuze et Guattari).
Aussi vague que soit une telle acception de lavocation philosophique, ce qu'il faut néanmoins en retenir est que dans ce cas également, la philosophie peut serapporter à la dimension productrice de pensées (et non plus technicienne) qui en semble la marque, et donc êtrequalifiée comme art de penser.
III.
La double négation Pour poursuivre l'investigation, et puisque la philosophie paraît pouvoir répondre positivement à sa qualification parl'art de penser, selon les deux acceptions possibles de ce même terme, et donc le prédicat lui être légitimentattribué, il faut maintenant se demander en quel sens pourrait-elle ne pas être art de penser.
A nouveau, lasituation est double : penser peut être pensée sans art ; et l'art, art sans pensée.
Partons du dernier cas bien queles deux soient historiquement tout aussi fondateurs de l'institution de la philosophie comme discipline.
L'art sanspensée est exemplifié dans les dialogues platoniciens par la figure de la sophistique, prétendue logique mais en faitsimple discours tournant à vide en tant qu'il est dépourvus de la connaissance des principes idéels.
Et malgrél'ambiguïté du rapport de la philosophie au sophiste (celui intervenant dans les derniers dialogues à la place deSocrate), la philosophie se définit généralement par contradiction de l'art sophistique.
Le second cas, la penséesans art (au sens de technique rationnelle logique), est celui, selon Aristote, de la pensée archaïque d'Empédocle,plus proche de la poésie que de la rationalité conceptuelle – toujours selon Aristote ( Rhétorique , III).
On trouve une résurgence d'une telle conception de la philosophie comme pensée prévalant sur la rationalité logique formelle dansles textes poétiques de Nietzsche, ou encore dans la ‘pensée poématisante' ( denkendes Dichtung ) de Heidegger, voyant alors dans la poésie le terme ultime de la philosophie, enfin débarrassée de la rigueur du concept et de salogique.
Dans ce cas, la philosophie à renoncer à sa pratiquer.
Elle n'est plus à proprement parler philosophie.
(Maisà vrai dire elle reste art, et art de la pensée, dans l'acception cette fois esthétique de la notion d'art.) * Conclusions - La philosophie, si elle n'est pas art de penser, n'est pas, ou plus philosophie.
Le prédicat “ art de penser ” constitue une définition, certes insuffisante, mais du moins nécessaire de la philosophie. - Extension : La philosophie a pour champ d'investigation, pour domaine de conceptualisation, ce qui n'est pas encore science (la philosophie de l'esprit devient psychologie, la philosophie du langage, linguistique, etc),ou ce qui dans la science n'est pas encore déterminé en termes de vérité et de validité (la philosophie a às'articuler aux confins de l'insoluble scientifique, et l'énigme logique joue un rôle analogie à l'instancevérificationnelle cruciale de l'expérience pour les sciences empiriques (Russell)).
Rigoureusement parlant, laphilosophie devrait consister en propositions scientifiques, mais alors on aurait plus l'impression de faire de laphilosophie.
Et ce serait le cas en fait (Wittgenstein)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie : Faut il être cultivé pour apprécier une oeuvre d'art?
- Cours sur l'art Philosophie
- PHILOSOPHIE ET EXISTENCE, DU BON USAGE DU "LIBRE PENSER" PHILOSOPHIQUE
- LOGIQUE OU L’ART DE PENSER (LA), Antoine Arnauld - résumé de l'oeuvre
- ART D’ARRIVER AU VRAI — Philosophie pratique Jaime Balmes (résumé & analyse)