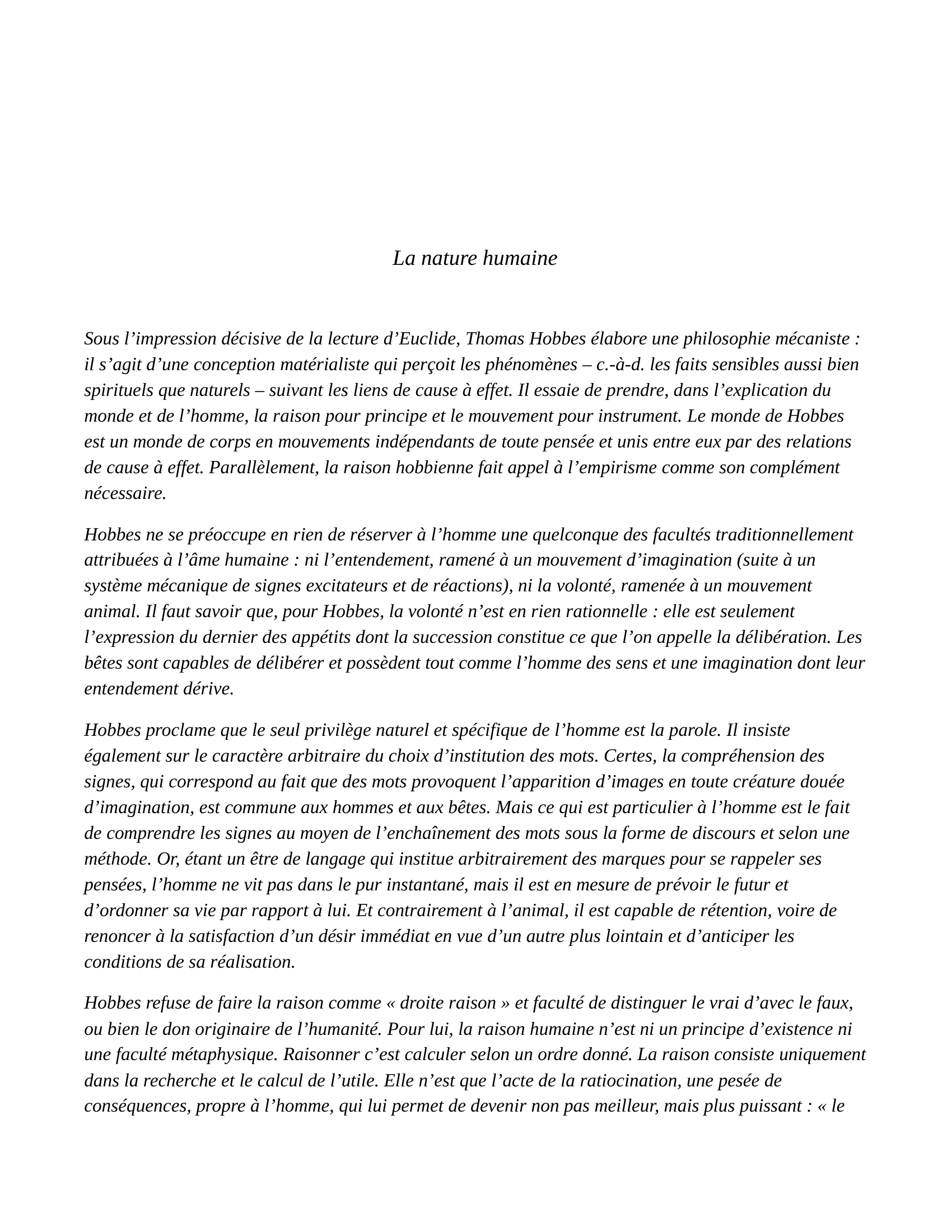La pensée de Thomas Hobbes
Publié le 25/09/2013
Extrait du document
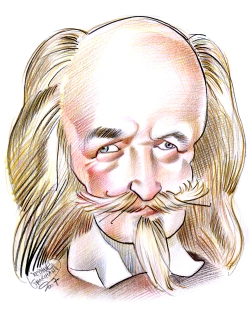
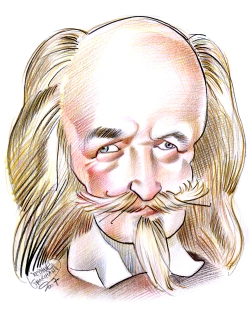
«
La nature humaine
Sous l’impression décisive de la lecture d’Euclide, Thomas Hobbes élabore une philosophie mécaniste :
il s’agit d’une conception matérialiste qui perçoit les phénomènes – c.-à-d.
les faits sensibles aussi bien
spirituels que naturels – suivant les liens de cause à effet.
Il essaie de prendre, dans l’explication du
monde et de l’homme, la raison pour principe et le mouvement pour instrument.
Le monde de Hobbes
est un monde de corps en mouvements indépendants de toute pensée et unis entre eux par des relations
de cause à effet.
Parallèlement, la raison hobbienne fait appel à l’empirisme comme son complément
nécessaire.
Hobbes ne se préoccupe en rien de réserver à l’homme une quelconque des facultés traditionnellement
attribuées à l’âme humaine : ni l’entendement, ramené à un mouvement d’imagination (suite à un
système mécanique de signes excitateurs et de réactions), ni la volonté, ramenée à un mouvement
animal.
Il faut savoir que, pour Hobbes, la volonté n’est en rien rationnelle : elle est seulement
l’expression du dernier des appétits dont la succession constitue ce que l’on appelle la délibération.
Les
bêtes sont capables de délibérer et possèdent tout comme l’homme des sens et une imagination dont leur
entendement dérive.
Hobbes proclame que le seul privilège naturel et spécifique de l’homme est la parole.
Il insiste
également sur le caractère arbitraire du choix d’institution des mots.
Certes, la compréhension des
signes, qui correspond au fait que des mots provoquent l’apparition d’images en toute créature douée
d’imagination, est commune aux hommes et aux bêtes.
Mais ce qui est particulier à l’homme est le fait
de comprendre les signes au moyen de l’enchaînement des mots sous la forme de discours et selon une
méthode.
Or, étant un être de langage qui institue arbitrairement des marques pour se rappeler ses
pensées, l’homme ne vit pas dans le pur instantané, mais il est en mesure de prévoir le futur et
d’ordonner sa vie par rapport à lui.
Et contrairement à l’animal, il est capable de rétention, voire de
renoncer à la satisfaction d’un désir immédiat en vue d’un autre plus lointain et d’anticiper les
conditions de sa réalisation.
Hobbes refuse de faire la raison comme « droite raison » et faculté de distinguer le vrai d’avec le faux,
ou bien le don originaire de l’humanité.
Pour lui, la raison humaine n’est ni un principe d’existence ni
une faculté métaphysique.
Raisonner c’est calculer selon un ordre donné.
La raison consiste uniquement
dans la recherche et le calcul de l’utile.
Elle n’est que l’acte de la ratiocination, une pesée de
conséquences, propre à l’homme, qui lui permet de devenir non pas meilleur, mais plus puissant : « le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CORPS (DU), De corpore, 1655. Thomas Hobbes (résumé et analyse)
- LE LÉVIATHAN DE THOMAS HOBBES
- CORPS (Du) [De corpore] de Thomas Hobbes
- ÉLÉMENTS PHILOSOPHIQUES DU CITOYEN de Thomas Hobbes (résumé)
- HOMME (DE L’), De homine, 1658. Thomas Hobbes - étude de l'œuvre