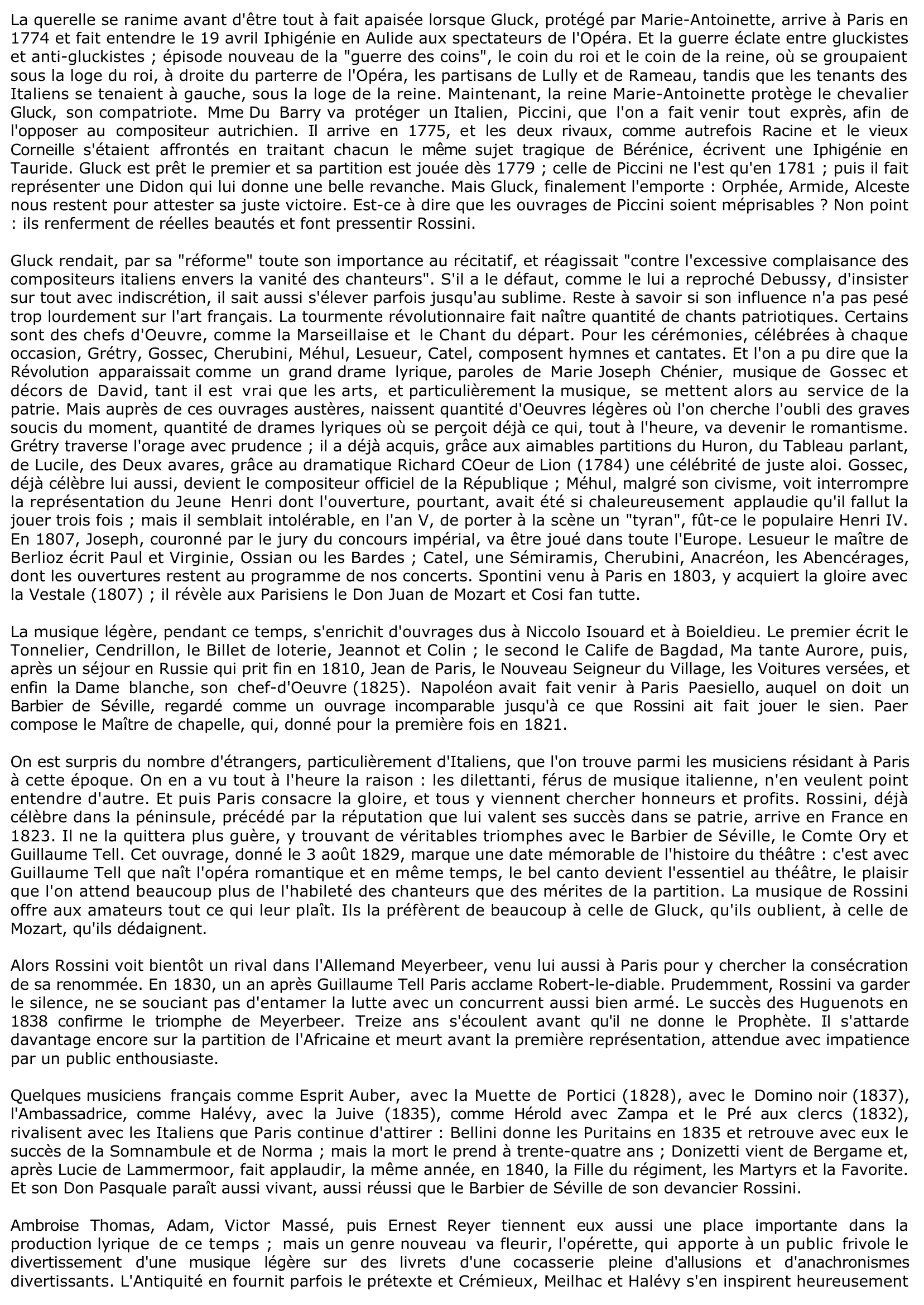La musique à Paris de Pergolèse à Offenbach
Publié le 26/02/2010
Extrait du document
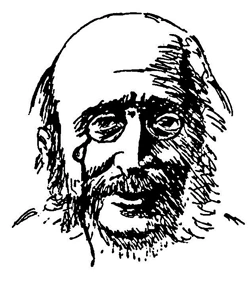
Durant la période qui s'étend du milieu du XVIIIe siècle à la fin du second empire, c'est au théâtre, presque uniquement, que la musique se manifeste en France. Certes, il ne viendrait à personne l'idée de contester la valeur des Oeuvres de nos grands organistes, ni l'importance des Concerts Spirituels où Mozart va trouver la révélation d'un nouveau style mais si nous nous tournons aujourd'hui plus volontiers vers les Oeuvres concertantes de Rameau, si nous rendons justice à un Leclair et à ses émules, il n'en est pas moins vrai que le XVIIIe siècle n'a point encore un public musical assez large pour s'intéresser, ailleurs qu'au théâtre, à un art qui, au surplus, vise surtout à plaire aux raffinés. Il faudra le grand souffle révolutionnaire pour que la musique tente de traduire les aspirations enthousiastes d'un peuple enivré de liberté et trouve une place élargie dans les fêtes nationales. Mais en se mettant au service de la nation, le musicien abandonne trop souvent les préoccupations d'art pur, et si nobles que soient ses desseins, il obéit presque toujours à des sujétions dont il lui est difficile de s'affranchir pour s'élever jusqu'au sublime qu'il veut atteindre.
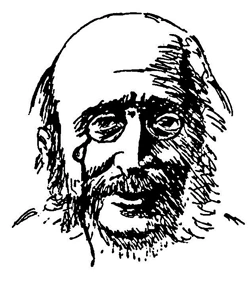
«
La querelle se ranime avant d'être tout à fait apaisée lorsque Gluck, protégé par Marie-Antoinette, arrive à Paris en1774 et fait entendre le 19 avril Iphigénie en Aulide aux spectateurs de l'Opéra.
Et la guerre éclate entre gluckisteset anti-gluckistes ; épisode nouveau de la "guerre des coins", le coin du roi et le coin de la reine, où se groupaientsous la loge du roi, à droite du parterre de l'Opéra, les partisans de Lully et de Rameau, tandis que les tenants desItaliens se tenaient à gauche, sous la loge de la reine.
Maintenant, la reine Marie-Antoinette protège le chevalierGluck, son compatriote.
Mme Du Barry va protéger un Italien, Piccini, que l'on a fait venir tout exprès, afin del'opposer au compositeur autrichien.
Il arrive en 1775, et les deux rivaux, comme autrefois Racine et le vieuxCorneille s'étaient affrontés en traitant chacun le même sujet tragique de Bérénice, écrivent une Iphigénie enTauride.
Gluck est prêt le premier et sa partition est jouée dès 1779 ; celle de Piccini ne l'est qu'en 1781 ; puis il faitreprésenter une Didon qui lui donne une belle revanche.
Mais Gluck, finalement l'emporte : Orphée, Armide, Alcestenous restent pour attester sa juste victoire.
Est-ce à dire que les ouvrages de Piccini soient méprisables ? Non point: ils renferment de réelles beautés et font pressentir Rossini.
Gluck rendait, par sa "réforme" toute son importance au récitatif, et réagissait "contre l'excessive complaisance descompositeurs italiens envers la vanité des chanteurs".
S'il a le défaut, comme le lui a reproché Debussy, d'insistersur tout avec indiscrétion, il sait aussi s'élever parfois jusqu'au sublime.
Reste à savoir si son influence n'a pas pesétrop lourdement sur l'art français.
La tourmente révolutionnaire fait naître quantité de chants patriotiques.
Certainssont des chefs d'Oeuvre, comme la Marseillaise et le Chant du départ.
Pour les cérémonies, célébrées à chaqueoccasion, Grétry, Gossec, Cherubini, Méhul, Lesueur, Catel, composent hymnes et cantates.
Et l'on a pu dire que laRévolution apparaissait comme un grand drame lyrique, paroles de Marie Joseph Chénier, musique de Gossec etdécors de David, tant il est vrai que les arts, et particulièrement la musique, se mettent alors au service de lapatrie.
Mais auprès de ces ouvrages austères, naissent quantité d'Oeuvres légères où l'on cherche l'oubli des gravessoucis du moment, quantité de drames lyriques où se perçoit déjà ce qui, tout à l'heure, va devenir le romantisme.Grétry traverse l'orage avec prudence ; il a déjà acquis, grâce aux aimables partitions du Huron, du Tableau parlant,de Lucile, des Deux avares, grâce au dramatique Richard COeur de Lion (1784) une célébrité de juste aloi.
Gossec,déjà célèbre lui aussi, devient le compositeur officiel de la République ; Méhul, malgré son civisme, voit interromprela représentation du Jeune Henri dont l'ouverture, pourtant, avait été si chaleureusement applaudie qu'il fallut lajouer trois fois ; mais il semblait intolérable, en l'an V, de porter à la scène un "tyran", fût-ce le populaire Henri IV.En 1807, Joseph, couronné par le jury du concours impérial, va être joué dans toute l'Europe.
Lesueur le maître deBerlioz écrit Paul et Virginie, Ossian ou les Bardes ; Catel, une Sémiramis, Cherubini, Anacréon, les Abencérages,dont les ouvertures restent au programme de nos concerts.
Spontini venu à Paris en 1803, y acquiert la gloire avecla Vestale (1807) ; il révèle aux Parisiens le Don Juan de Mozart et Cosi fan tutte.
La musique légère, pendant ce temps, s'enrichit d'ouvrages dus à Niccolo Isouard et à Boieldieu.
Le premier écrit leTonnelier, Cendrillon, le Billet de loterie, Jeannot et Colin ; le second le Calife de Bagdad, Ma tante Aurore, puis,après un séjour en Russie qui prit fin en 1810, Jean de Paris, le Nouveau Seigneur du Village, les Voitures versées, etenfin la Dame blanche, son chef-d'Oeuvre (1825).
Napoléon avait fait venir à Paris Paesiello, auquel on doit unBarbier de Séville, regardé comme un ouvrage incomparable jusqu'à ce que Rossini ait fait jouer le sien.
Paercompose le Maître de chapelle, qui, donné pour la première fois en 1821.
On est surpris du nombre d'étrangers, particulièrement d'Italiens, que l'on trouve parmi les musiciens résidant à Parisà cette époque.
On en a vu tout à l'heure la raison : les dilettanti, férus de musique italienne, n'en veulent pointentendre d'autre.
Et puis Paris consacre la gloire, et tous y viennent chercher honneurs et profits.
Rossini, déjàcélèbre dans la péninsule, précédé par la réputation que lui valent ses succès dans se patrie, arrive en France en1823.
Il ne la quittera plus guère, y trouvant de véritables triomphes avec le Barbier de Séville, le Comte Ory etGuillaume Tell.
Cet ouvrage, donné le 3 août 1829, marque une date mémorable de l'histoire du théâtre : c'est avecGuillaume Tell que naît l'opéra romantique et en même temps, le bel canto devient l'essentiel au théâtre, le plaisirque l'on attend beaucoup plus de l'habileté des chanteurs que des mérites de la partition.
La musique de Rossinioffre aux amateurs tout ce qui leur plaît.
Ils la préfèrent de beaucoup à celle de Gluck, qu'ils oublient, à celle deMozart, qu'ils dédaignent.
Alors Rossini voit bientôt un rival dans l'Allemand Meyerbeer, venu lui aussi à Paris pour y chercher la consécrationde sa renommée.
En 1830, un an après Guillaume Tell Paris acclame Robert-le-diable.
Prudemment, Rossini va garderle silence, ne se souciant pas d'entamer la lutte avec un concurrent aussi bien armé.
Le succès des Huguenots en1838 confirme le triomphe de Meyerbeer.
Treize ans s'écoulent avant qu'il ne donne le Prophète.
Il s'attardedavantage encore sur la partition de l'Africaine et meurt avant la première représentation, attendue avec impatiencepar un public enthousiaste.
Quelques musiciens français comme Esprit Auber, avec la Muette de Portici (1828), avec le Domino noir (1837),l'Ambassadrice, comme Halévy, avec la Juive (1835), comme Hérold avec Zampa et le Pré aux clercs (1832),rivalisent avec les Italiens que Paris continue d'attirer : Bellini donne les Puritains en 1835 et retrouve avec eux lesuccès de la Somnambule et de Norma ; mais la mort le prend à trente-quatre ans ; Donizetti vient de Bergame et,après Lucie de Lammermoor, fait applaudir, la même année, en 1840, la Fille du régiment, les Martyrs et la Favorite.Et son Don Pasquale paraît aussi vivant, aussi réussi que le Barbier de Séville de son devancier Rossini.
Ambroise Thomas, Adam, Victor Massé, puis Ernest Reyer tiennent eux aussi une place importante dans laproduction lyrique de ce temps ; mais un genre nouveau va fleurir, l'opérette, qui apporte à un public frivole ledivertissement d'une musique légère sur des livrets d'une cocasserie pleine d'allusions et d'anachronismesdivertissants.
L'Antiquité en fournit parfois le prétexte et Crémieux, Meilhac et Halévy s'en inspirent heureusement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La musique à Paris de Pergolèse à Offenbach par René Dumesnil Durant la période qui s'étend du milieu du XVIIIe siècle à la fin du second empire, c'est au théâtre, presque uniquement, que la musique se manifeste en France.
- VIE PARISIENNE (La). d’Henri Meilhac musique de Jacques Offenbach
- André CAMPRA 1660 - Aix-en-Provence 1744 - Versailles D'abord maître de musique à Arles et Toulouse, il occupa ensuite cet emploi à Notre-Dame de Paris (1694-1700) puis à la chapelle royale de Versailles.
- Gustave CHARPENTIER 1860 - Dieuze 19;6 - Paris Élève de Massenet, il obtint le prix de Rome de musique en 1887.
- Opéra de Paris Bastille - musique.