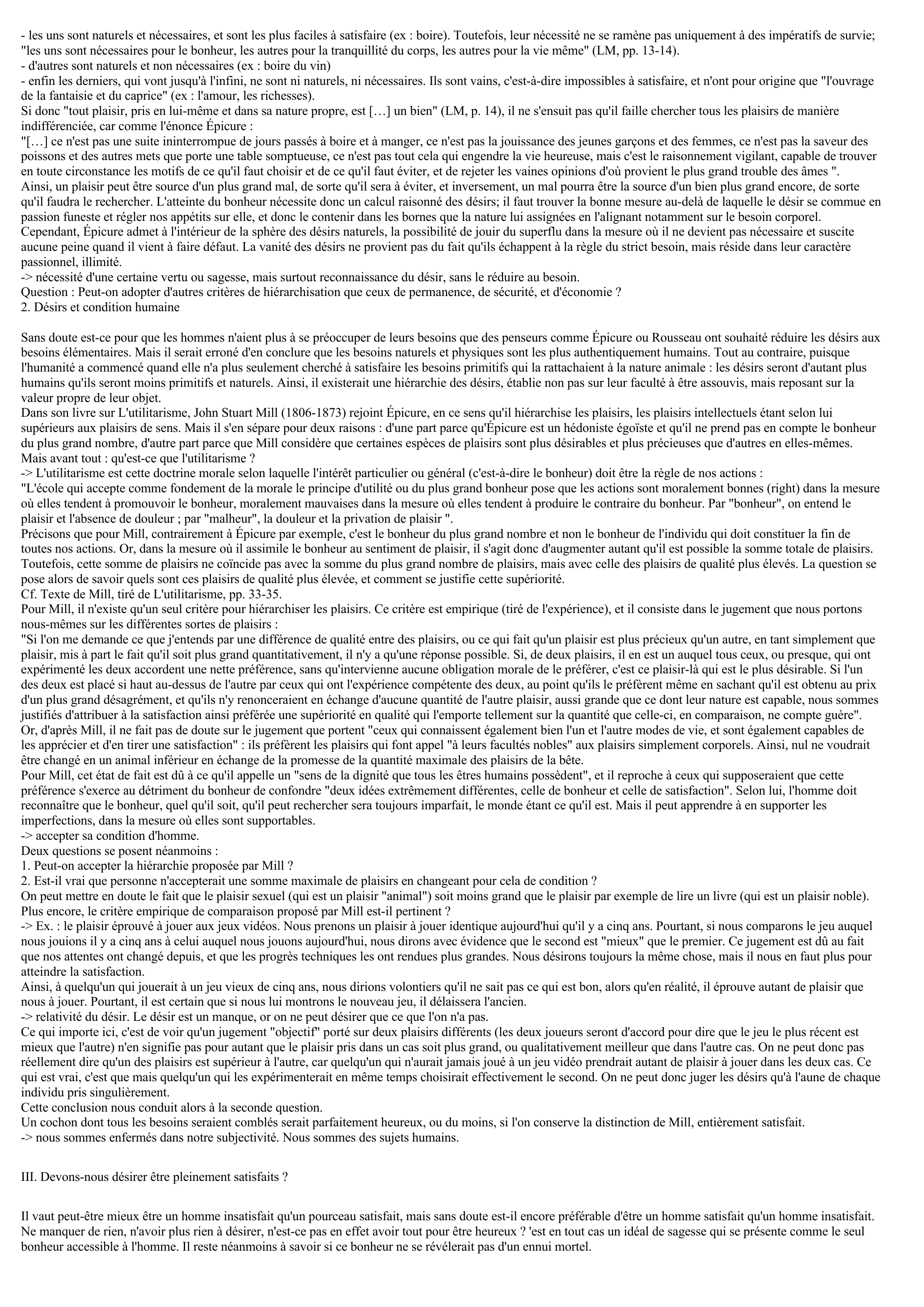La morale peut-elle nous commander de réaliser tous nos désirs ?
Publié le 30/08/2012
Extrait du document

Ainsi, Freud finit par opposer deux types d'instincts, les instincts de vie (Éros) et les instincts de mort. La libido, que l'on peut assimiler au désir dans la théorie freudienne, est cette énergie qui s'oppose à l'instinct de mort et qui permet ainsi à l'homme de "persévérer dans son être". C'est en effet à Spinoza que ne manque pas de nous renvoyer la théorie freudienne. Cf. texte de Spinoza tiré de l'Ethique, livre III, théorèmes VI et VII + scolie du théorème IX. ou texte de Hobbes, Léviathan (1651), Folio Essais, pp. 186-188. Ou texte de Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, tome 1, pp. 323-325 Pour Spinoza, le désir est premier, et en un sens, il ne fait qu'un avec son objet. Il n'y a pas pour lui de distinction radicale antre le sujet désirant et l'objet désiré. Les hommes croient généralement que leurs appétits sont les effets de la représentation d'un but et qu'ils désirent une chose parce qu'ils la jugent bonne. Ils sont enclins à penser qu'ils tendent vers des fins ou des biens extérieurs qui exerceraient sur eux un attrait et ils dissocient alors le désir de la fin poursuivie. En réalité, la fin n'est rien d'autre que le désir lui-même en tant qu'il est la cause d'une chose. Ex. : vouloir construire une maison. C'est le désir de jouir des commodités d'un abri qui est cause première de l'habitation et non l'inverse. -> le désir produit ses objets et non l'inverse.

«
- les uns sont naturels et nécessaires, et sont les plus faciles à satisfaire (ex : boire).
Toutefois, leur nécessité ne se ramène pas uniquement à des impératifs de survie;"les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps, les autres pour la vie même" (LM, pp.
13-14).- d'autres sont naturels et non nécessaires (ex : boire du vin)- enfin les derniers, qui vont jusqu'à l'infini, ne sont ni naturels, ni nécessaires.
Ils sont vains, c'est-à-dire impossibles à satisfaire, et n'ont pour origine que "l'ouvragede la fantaisie et du caprice" (ex : l'amour, les richesses).Si donc "tout plaisir, pris en lui-même et dans sa nature propre, est […] un bien" (LM, p.
14), il ne s'ensuit pas qu'il faille chercher tous les plaisirs de manièreindifférenciée, car comme l'énonce Épicure :"[…] ce n'est pas une suite ininterrompue de jours passés à boire et à manger, ce n'est pas la jouissance des jeunes garçons et des femmes, ce n'est pas la saveur despoissons et des autres mets que porte une table somptueuse, ce n'est pas tout cela qui engendre la vie heureuse, mais c'est le raisonnement vigilant, capable de trouveren toute circonstance les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et de rejeter les vaines opinions d'où provient le plus grand trouble des âmes ".Ainsi, un plaisir peut être source d'un plus grand mal, de sorte qu'il sera à éviter, et inversement, un mal pourra être la source d'un bien plus grand encore, de sortequ'il faudra le rechercher.
L'atteinte du bonheur nécessite donc un calcul raisonné des désirs; il faut trouver la bonne mesure au-delà de laquelle le désir se commue enpassion funeste et régler nos appétits sur elle, et donc le contenir dans les bornes que la nature lui assignées en l'alignant notamment sur le besoin corporel.Cependant, Épicure admet à l'intérieur de la sphère des désirs naturels, la possibilité de jouir du superflu dans la mesure où il ne devient pas nécessaire et susciteaucune peine quand il vient à faire défaut.
La vanité des désirs ne provient pas du fait qu'ils échappent à la règle du strict besoin, mais réside dans leur caractèrepassionnel, illimité.-> nécessité d'une certaine vertu ou sagesse, mais surtout reconnaissance du désir, sans le réduire au besoin.Question : Peut-on adopter d'autres critères de hiérarchisation que ceux de permanence, de sécurité, et d'économie ?2.
Désirs et condition humaine
Sans doute est-ce pour que les hommes n'aient plus à se préoccuper de leurs besoins que des penseurs comme Épicure ou Rousseau ont souhaité réduire les désirs auxbesoins élémentaires.
Mais il serait erroné d'en conclure que les besoins naturels et physiques sont les plus authentiquement humains.
Tout au contraire, puisquel'humanité a commencé quand elle n'a plus seulement cherché à satisfaire les besoins primitifs qui la rattachaient à la nature animale : les désirs seront d'autant plushumains qu'ils seront moins primitifs et naturels.
Ainsi, il existerait une hiérarchie des désirs, établie non pas sur leur faculté à être assouvis, mais reposant sur lavaleur propre de leur objet.Dans son livre sur L'utilitarisme, John Stuart Mill (1806-1873) rejoint Épicure, en ce sens qu'il hiérarchise les plaisirs, les plaisirs intellectuels étant selon luisupérieurs aux plaisirs de sens.
Mais il s'en sépare pour deux raisons : d'une part parce qu'Épicure est un hédoniste égoïste et qu'il ne prend pas en compte le bonheurdu plus grand nombre, d'autre part parce que Mill considère que certaines espèces de plaisirs sont plus désirables et plus précieuses que d'autres en elles-mêmes.Mais avant tout : qu'est-ce que l'utilitarisme ?-> L'utilitarisme est cette doctrine morale selon laquelle l'intérêt particulier ou général (c'est-à-dire le bonheur) doit être la règle de nos actions :"L'école qui accepte comme fondement de la morale le principe d'utilité ou du plus grand bonheur pose que les actions sont moralement bonnes (right) dans la mesureoù elles tendent à promouvoir le bonheur, moralement mauvaises dans la mesure où elles tendent à produire le contraire du bonheur.
Par "bonheur", on entend leplaisir et l'absence de douleur ; par "malheur", la douleur et la privation de plaisir ".Précisons que pour Mill, contrairement à Épicure par exemple, c'est le bonheur du plus grand nombre et non le bonheur de l'individu qui doit constituer la fin detoutes nos actions.
Or, dans la mesure où il assimile le bonheur au sentiment de plaisir, il s'agit donc d'augmenter autant qu'il est possible la somme totale de plaisirs.Toutefois, cette somme de plaisirs ne coïncide pas avec la somme du plus grand nombre de plaisirs, mais avec celle des plaisirs de qualité plus élevés.
La question sepose alors de savoir quels sont ces plaisirs de qualité plus élevée, et comment se justifie cette supériorité.Cf.
Texte de Mill, tiré de L'utilitarisme, pp.
33-35.Pour Mill, il n'existe qu'un seul critère pour hiérarchiser les plaisirs.
Ce critère est empirique (tiré de l'expérience), et il consiste dans le jugement que nous portonsnous-mêmes sur les différentes sortes de plaisirs :"Si l'on me demande ce que j'entends par une différence de qualité entre des plaisirs, ou ce qui fait qu'un plaisir est plus précieux qu'un autre, en tant simplement queplaisir, mis à part le fait qu'il soit plus grand quantitativement, il n'y a qu'une réponse possible.
Si, de deux plaisirs, il en est un auquel tous ceux, ou presque, qui ontexpérimenté les deux accordent une nette préférence, sans qu'intervienne aucune obligation morale de le préférer, c'est ce plaisir-là qui est le plus désirable.
Si l'undes deux est placé si haut au-dessus de l'autre par ceux qui ont l'expérience compétente des deux, au point qu'ils le préfèrent même en sachant qu'il est obtenu au prixd'un plus grand désagrément, et qu'ils n'y renonceraient en échange d'aucune quantité de l'autre plaisir, aussi grande que ce dont leur nature est capable, nous sommesjustifiés d'attribuer à la satisfaction ainsi préférée une supériorité en qualité qui l'emporte tellement sur la quantité que celle-ci, en comparaison, ne compte guère".Or, d'après Mill, il ne fait pas de doute sur le jugement que portent "ceux qui connaissent également bien l'un et l'autre modes de vie, et sont également capables deles apprécier et d'en tirer une satisfaction" : ils préfèrent les plaisirs qui font appel "à leurs facultés nobles" aux plaisirs simplement corporels.
Ainsi, nul ne voudraitêtre changé en un animal inférieur en échange de la promesse de la quantité maximale des plaisirs de la bête.Pour Mill, cet état de fait est dû à ce qu'il appelle un "sens de la dignité que tous les êtres humains possèdent", et il reproche à ceux qui supposeraient que cettepréférence s'exerce au détriment du bonheur de confondre "deux idées extrêmement différentes, celle de bonheur et celle de satisfaction".
Selon lui, l'homme doitreconnaître que le bonheur, quel qu'il soit, qu'il peut rechercher sera toujours imparfait, le monde étant ce qu'il est.
Mais il peut apprendre à en supporter lesimperfections, dans la mesure où elles sont supportables.-> accepter sa condition d'homme.Deux questions se posent néanmoins :1.
Peut-on accepter la hiérarchie proposée par Mill ?2.
Est-il vrai que personne n'accepterait une somme maximale de plaisirs en changeant pour cela de condition ?On peut mettre en doute le fait que le plaisir sexuel (qui est un plaisir "animal") soit moins grand que le plaisir par exemple de lire un livre (qui est un plaisir noble).Plus encore, le critère empirique de comparaison proposé par Mill est-il pertinent ?-> Ex.
: le plaisir éprouvé à jouer aux jeux vidéos.
Nous prenons un plaisir à jouer identique aujourd'hui qu'il y a cinq ans.
Pourtant, si nous comparons le jeu auquelnous jouions il y a cinq ans à celui auquel nous jouons aujourd'hui, nous dirons avec évidence que le second est "mieux" que le premier.
Ce jugement est dû au faitque nos attentes ont changé depuis, et que les progrès techniques les ont rendues plus grandes.
Nous désirons toujours la même chose, mais il nous en faut plus pouratteindre la satisfaction.Ainsi, à quelqu'un qui jouerait à un jeu vieux de cinq ans, nous dirions volontiers qu'il ne sait pas ce qui est bon, alors qu'en réalité, il éprouve autant de plaisir quenous à jouer.
Pourtant, il est certain que si nous lui montrons le nouveau jeu, il délaissera l'ancien.-> relativité du désir.
Le désir est un manque, or on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas.Ce qui importe ici, c'est de voir qu'un jugement "objectif" porté sur deux plaisirs différents (les deux joueurs seront d'accord pour dire que le jeu le plus récent estmieux que l'autre) n'en signifie pas pour autant que le plaisir pris dans un cas soit plus grand, ou qualitativement meilleur que dans l'autre cas.
On ne peut donc pasréellement dire qu'un des plaisirs est supérieur à l'autre, car quelqu'un qui n'aurait jamais joué à un jeu vidéo prendrait autant de plaisir à jouer dans les deux cas.
Cequi est vrai, c'est que mais quelqu'un qui les expérimenterait en même temps choisirait effectivement le second.
On ne peut donc juger les désirs qu'à l'aune de chaqueindividu pris singulièrement.Cette conclusion nous conduit alors à la seconde question.Un cochon dont tous les besoins seraient comblés serait parfaitement heureux, ou du moins, si l'on conserve la distinction de Mill, entièrement satisfait.-> nous sommes enfermés dans notre subjectivité.
Nous sommes des sujets humains.
III.
Devons-nous désirer être pleinement satisfaits ?
Il vaut peut-être mieux être un homme insatisfait qu'un pourceau satisfait, mais sans doute est-il encore préférable d'être un homme satisfait qu'un homme insatisfait.Ne manquer de rien, n'avoir plus rien à désirer, n'est-ce pas en effet avoir tout pour être heureux ? 'est en tout cas un idéal de sagesse qui se présente comme le seulbonheur accessible à l'homme.
Il reste néanmoins à savoir si ce bonheur ne se révélerait pas d'un ennui mortel..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Est-il vertueux d’accomplir tous ces désirs ? Sous quelles conditions la satisfaction de tous ses désirs peut-elle amener l’homme à suivre une vie heureuse et morale ?
- Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion: Réaliser une explication de texte
- Commenter ou discuter cette pensée de Renouvier : « La morale et les mathématiques ont cela de commun que, pour exister en tant que sciences, elles doivent se fonder sur de purs concepts. L'expérience et l’histoire sont plus loin de représenter les lois de la morale que la nature ne l’est de réaliser exactement les Idées mathématiques »
- La morale est étroitement liée à la politique : elle est une tentative pour imposer à des individus les désirs collectifs d'un groupe ; ou, inversement, elle est une tentative faite par un individu pour que ses désirs deviennent ceux de son groupe.
- La morale ne contient aucune affirmation, vraie ou fausse, mais se compose de désirs d'un certain genre, à savoir de ceux qui ont trait aux désirs de l'humanité en général.