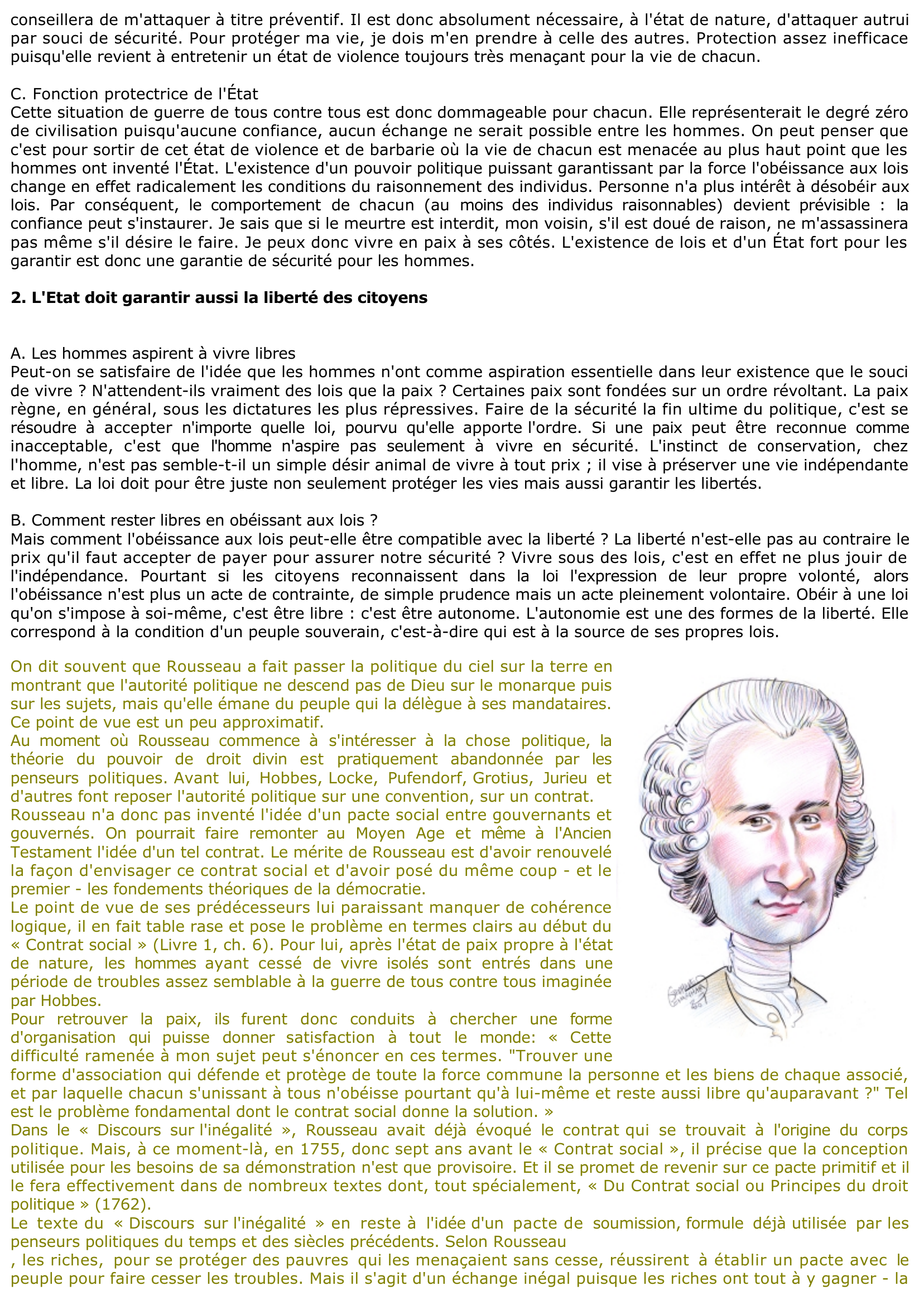La liberté est-elle la fin de l'État?
Publié le 25/01/2005
Extrait du document
.../...
Il s'agit non pas de se venger, mais de restaurer la loi. Il n'y a d'ordre véritable que dans le cadre d'une législation juste qui permette l'accord de la liberté de chacun avec celle de tous - législation qui doit être respectée par tous. Mais bâtir la justice, cela justifie aussi veiller à une répartition équitable des richesses produites. L'État doit donc favoriser une plus grande justice sociale, en évitant toutefois la logique totalitaire.
1. La protection de la vie est la fin du politique
A. Le souci de sécurité est une fin naturelle Vivre en sécurité, c'est vivre à l'abri du danger, dans des conditions ou la vie n'est menacée ni directement ni indirectement. La maladie, l'accident, la famine sont des risques qui mettent en cause la sécurité de l'individu. C'est manifestement l'instinct de conservation qui pousse l'homme à rechercher la sécurité. L'union faisant la force, chacun comprend qu'il accroît ses chances de faire face aux menaces naturelles en coopérant avec autrui.
- Analyse du sujet : Un sujet à la limite de la question de cours. Il interroge sur la finalité de l'État en proposant une solution : la liberté. Au-delà d'une simple réponse affirmative (ou négative ; mais en ce cas déterminez avec rigueur quelle autre finalité peut être proposée), demandez-vous quels présupposés, quelle conception de l'État rendent possible une telle solution.
- Conseils pratiques : Attention au vocabulaire : précisez bien la notion de finalité ; distinguez avec rigueur État et nation, État et pouvoir.
Montrez l'ambiguïté de la notion d'État. Celui-ci peut être instrument d'émancipation et de liberté en garantissant la sécurité des individus, mais peut aussi devenir une machinerie totalement déshumanisée et profondément destructrice : " le plus froid des monstres froids " comme dit Nietzsche.
«
conseillera de m'attaquer à titre préventif.
Il est donc absolument nécessaire, à l'état de nature, d'attaquer autruipar souci de sécurité.
Pour protéger ma vie, je dois m'en prendre à celle des autres.
Protection assez inefficacepuisqu'elle revient à entretenir un état de violence toujours très menaçant pour la vie de chacun.
C.
Fonction protectrice de l'ÉtatCette situation de guerre de tous contre tous est donc dommageable pour chacun.
Elle représenterait le degré zérode civilisation puisqu'aucune confiance, aucun échange ne serait possible entre les hommes.
On peut penser quec'est pour sortir de cet état de violence et de barbarie où la vie de chacun est menacée au plus haut point que leshommes ont inventé l'État.
L'existence d'un pouvoir politique puissant garantissant par la force l'obéissance aux loischange en effet radicalement les conditions du raisonnement des individus.
Personne n'a plus intérêt à désobéir auxlois.
Par conséquent, le comportement de chacun (au moins des individus raisonnables) devient prévisible : laconfiance peut s'instaurer.
Je sais que si le meurtre est interdit, mon voisin, s'il est doué de raison, ne m'assassinerapas même s'il désire le faire.
Je peux donc vivre en paix à ses côtés.
L'existence de lois et d'un État fort pour lesgarantir est donc une garantie de sécurité pour les hommes.
2.
L'Etat doit garantir aussi la liberté des citoyens
A.
Les hommes aspirent à vivre libresPeut-on se satisfaire de l'idée que les hommes n'ont comme aspiration essentielle dans leur existence que le soucide vivre ? N'attendent-ils vraiment des lois que la paix ? Certaines paix sont fondées sur un ordre révoltant.
La paixrègne, en général, sous les dictatures les plus répressives.
Faire de la sécurité la fin ultime du politique, c'est serésoudre à accepter n'importe quelle loi, pourvu qu'elle apporte l'ordre.
Si une paix peut être reconnue commeinacceptable, c'est que l'homme n'aspire pas seulement à vivre en sécurité.
L'instinct de conservation, chezl'homme, n'est pas semble-t-il un simple désir animal de vivre à tout prix ; il vise à préserver une vie indépendanteet libre.
La loi doit pour être juste non seulement protéger les vies mais aussi garantir les libertés.
B.
Comment rester libres en obéissant aux lois ?Mais comment l'obéissance aux lois peut-elle être compatible avec la liberté ? La liberté n'est-elle pas au contraire leprix qu'il faut accepter de payer pour assurer notre sécurité ? Vivre sous des lois, c'est en effet ne plus jouir del'indépendance.
Pourtant si les citoyens reconnaissent dans la loi l'expression de leur propre volonté, alorsl'obéissance n'est plus un acte de contrainte, de simple prudence mais un acte pleinement volontaire.
Obéir à une loiqu'on s'impose à soi-même, c'est être libre : c'est être autonome.
L'autonomie est une des formes de la liberté.
Ellecorrespond à la condition d'un peuple souverain, c'est-à-dire qui est à la source de ses propres lois.
On dit souvent que Rousseau a fait passer la politique du ciel sur la terre enmontrant que l'autorité politique ne descend pas de Dieu sur le monarque puissur les sujets, mais qu'elle émane du peuple qui la délègue à ses mandataires.Ce point de vue est un peu approximatif.Au moment où Rousseau commence à s'intéresser à la chose politique, lathéorie du pouvoir de droit divin est pratiquement abandonnée par lespenseurs politiques.
Avant lui, Hobbes, Locke, Pufendorf, Grotius, Jurieu etd'autres font reposer l'autorité politique sur une convention, sur un contrat.Rousseau n'a donc pas inventé l'idée d'un pacte social entre gouvernants etgouvernés.
On pourrait faire remonter au Moyen Age et même à l'AncienTestament l'idée d'un tel contrat.
Le mérite de Rousseau est d'avoir renouveléla façon d'envisager ce contrat social et d'avoir posé du même coup - et lepremier - les fondements théoriques de la démocratie.Le point de vue de ses prédécesseurs lui paraissant manquer de cohérencelogique, il en fait table rase et pose le problème en termes clairs au début du« Contrat social » (Livre 1, ch.
6).
Pour lui, après l'état de paix propre à l'étatde nature, les hommes ayant cessé de vivre isolés sont entrés dans unepériode de troubles assez semblable à la guerre de tous contre tous imaginéepar Hobbes.Pour retrouver la paix, ils furent donc conduits à chercher une formed'organisation qui puisse donner satisfaction à tout le monde: « Cettedifficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes.
"Trouver uneforme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé,et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant ?" Telest le problème fondamental dont le contrat social donne la solution.
»Dans le « Discours sur l'inégalité », Rousseau avait déjà évoqué le contrat qui se trouvait à l'origine du corpspolitique.
Mais, à ce moment-là, en 1755, donc sept ans avant le « Contrat social », il précise que la conceptionutilisée pour les besoins de sa démonstration n'est que provisoire.
Et il se promet de revenir sur ce pacte primitif et ille fera effectivement dans de nombreux textes dont, tout spécialement, « Du Contrat social ou Principes du droitpolitique » (1762).Le texte du « Discours sur l'inégalité » en reste à l'idée d'un pacte de soumission, formule déjà utilisée par lespenseurs politiques du temps et des siècles précédents.
Selon Rousseau, les riches, pour se protéger des pauvres qui les menaçaient sans cesse, réussirent à établir un pacte avec lepeuple pour faire cesser les troubles.
Mais il s'agit d'un échange inégal puisque les riches ont tout à y gagner - la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La fin de l’Etat est-elle la liberté ?
- La logique impose les règles de la pensée correcte. Est-ce porter atteinte à la liberté de l'esprit que de s'imposer ces règles? Dans quelle mesure ? Cela ne dépend-il pas de la fin que l'on se donne, recherche de la vérité ou vagabondage dans la fantaisie?
- Il est certain que la fin d'une loi n'est pas d'abolir ou de restreindre la liberté mais de la préserver et de l'augmenter.
- La fin de l'Etat est-elle la liberté de chacun ou de tous ?
- ROUSSEAU: Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité...