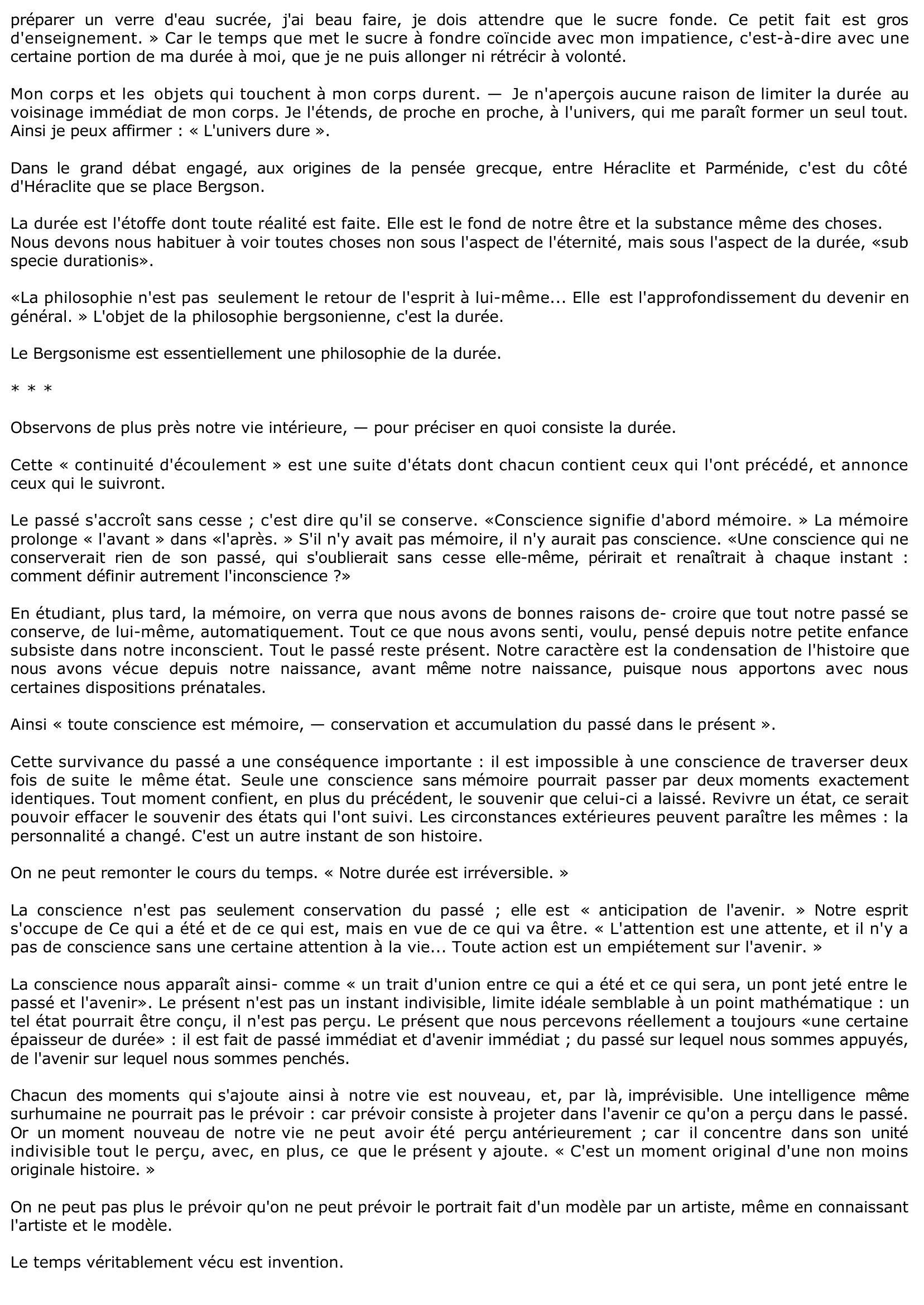La durée chez Bergson
Publié le 19/03/2011
Extrait du document
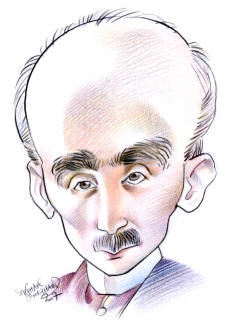
Longtemps on a nommé philosophe celui qui possédait la science totale. Mais la multiplicité des sciences particulières, la diversité de leurs méthodes, l'abondance des faits recueillis rendent impossible l'accumulation de toutes les connaissances humaines dans un seul esprit.
Dès lors, certains penseurs veulent que l'effort du philosophe vise à embrasser en une vaste synthèse tous les résultats des sciences particulières, à réaliser ce qu'on a nommé « l'unification du savoir «. Cette conception est aussi désobligeante pour la science que pour la philosophie, aussi injurieuse pour le savant que pour le philosophe. Comment la profession de philosophe confère-rait-elle à celui qui l'exerce le pouvoir d'aller plus loin que le savant, dans le même sens que lui ? et comment le philosophe pourrait-il dépasser les généralisations auxquelles arrive le savant sans se placer systématiquement dans l'hypothétique et dans l'arbitraire ?
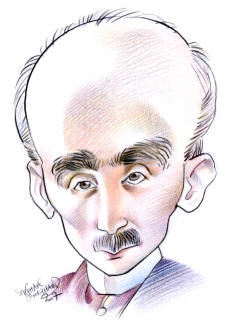
«
préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde.
Ce petit fait est grosd'enseignement.
» Car le temps que met le sucre à fondre coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec unecertaine portion de ma durée à moi, que je ne puis allonger ni rétrécir à volonté.
Mon corps et les objets qui touchent à mon corps durent.
— Je n'aperçois aucune raison de limiter la durée auvoisinage immédiat de mon corps.
Je l'étends, de proche en proche, à l'univers, qui me paraît former un seul tout.Ainsi je peux affirmer : « L'univers dure ».
Dans le grand débat engagé, aux origines de la pensée grecque, entre Héraclite et Parménide, c'est du côtéd'Héraclite que se place Bergson.
La durée est l'étoffe dont toute réalité est faite.
Elle est le fond de notre être et la substance même des choses.Nous devons nous habituer à voir toutes choses non sous l'aspect de l'éternité, mais sous l'aspect de la durée, «subspecie durationis».
«La philosophie n'est pas seulement le retour de l'esprit à lui-même...
Elle est l'approfondissement du devenir engénéral.
» L'objet de la philosophie bergsonienne, c'est la durée.
Le Bergsonisme est essentiellement une philosophie de la durée.
* * *
Observons de plus près notre vie intérieure, — pour préciser en quoi consiste la durée.
Cette « continuité d'écoulement » est une suite d'états dont chacun contient ceux qui l'ont précédé, et annonceceux qui le suivront.
Le passé s'accroît sans cesse ; c'est dire qu'il se conserve.
«Conscience signifie d'abord mémoire.
» La mémoireprolonge « l'avant » dans «l'après.
» S'il n'y avait pas mémoire, il n'y aurait pas conscience.
«Une conscience qui neconserverait rien de son passé, qui s'oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à chaque instant :comment définir autrement l'inconscience ?»
En étudiant, plus tard, la mémoire, on verra que nous avons de bonnes raisons de- croire que tout notre passé seconserve, de lui-même, automatiquement.
Tout ce que nous avons senti, voulu, pensé depuis notre petite enfancesubsiste dans notre inconscient.
Tout le passé reste présent.
Notre caractère est la condensation de l'histoire quenous avons vécue depuis notre naissance, avant même notre naissance, puisque nous apportons avec nouscertaines dispositions prénatales.
Ainsi « toute conscience est mémoire, — conservation et accumulation du passé dans le présent ».
Cette survivance du passé a une conséquence importante : il est impossible à une conscience de traverser deuxfois de suite le même état.
Seule une conscience sans mémoire pourrait passer par deux moments exactementidentiques.
Tout moment confient, en plus du précédent, le souvenir que celui-ci a laissé.
Revivre un état, ce seraitpouvoir effacer le souvenir des états qui l'ont suivi.
Les circonstances extérieures peuvent paraître les mêmes : lapersonnalité a changé.
C'est un autre instant de son histoire.
On ne peut remonter le cours du temps.
« Notre durée est irréversible.
»
La conscience n'est pas seulement conservation du passé ; elle est « anticipation de l'avenir.
» Notre esprits'occupe de Ce qui a été et de ce qui est, mais en vue de ce qui va être.
« L'attention est une attente, et il n'y apas de conscience sans une certaine attention à la vie...
Toute action est un empiétement sur l'avenir.
»
La conscience nous apparaît ainsi- comme « un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre lepassé et l'avenir».
Le présent n'est pas un instant indivisible, limite idéale semblable à un point mathématique : untel état pourrait être conçu, il n'est pas perçu.
Le présent que nous percevons réellement a toujours «une certaineépaisseur de durée» : il est fait de passé immédiat et d'avenir immédiat ; du passé sur lequel nous sommes appuyés,de l'avenir sur lequel nous sommes penchés.
Chacun des moments qui s'ajoute ainsi à notre vie est nouveau, et, par là, imprévisible.
Une intelligence mêmesurhumaine ne pourrait pas le prévoir : car prévoir consiste à projeter dans l'avenir ce qu'on a perçu dans le passé.Or un moment nouveau de notre vie ne peut avoir été perçu antérieurement ; car il concentre dans son unitéindivisible tout le perçu, avec, en plus, ce que le présent y ajoute.
« C'est un moment original d'une non moinsoriginale histoire.
»
On ne peut pas plus le prévoir qu'on ne peut prévoir le portrait fait d'un modèle par un artiste, même en connaissantl'artiste et le modèle.
Le temps véritablement vécu est invention..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La durée et la conscience de BERGSON
- BERGSON: Le moi et la durée
- Durée et Simultanéité [Henri Bergson] - fiche de lecture.
- Durée vraie et temps pensé (H. Bergson) ?
- BERGSON: Durée et mémoire