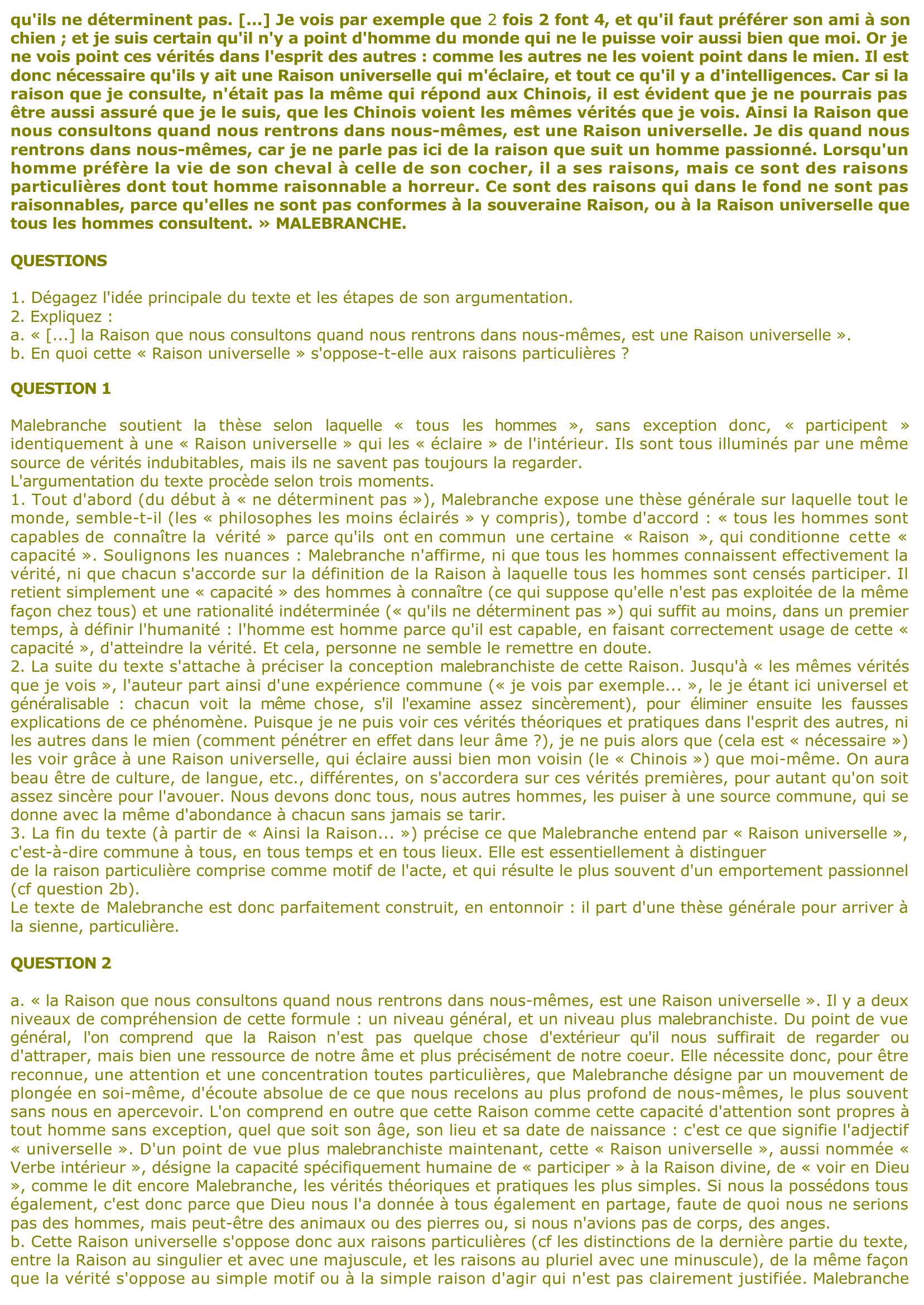La diversité des langues remet-elle en cause l'universalité des pensées ?
Publié le 27/09/2005
Extrait du document
Le langage, au sens strict, est une institution universelle et spécifique de l'humanité. On oppose généralement le langage, en tant que faculté ou aptitude à constituer un système de signes, à la langue qui est l'instrument de communication propre à une communauté humaine : une langue est un ensemble institué de symboles verbaux propres à un corps social, et susceptible d'être bien ou mal traduit. Il s'agit ici d'étudier si la multiplicité de langue peut permettre aux hommes de construire une pensée commune, de comprendre les mêmes idées. De prime abord, il semble que le mécanisme de la pensée soit universel. Les langues ne sont-elles pas formées sur cette pensée universelle? Ne sont-elles pas issues d'une même grammaire? Pourtant une langue porte plus que des simples mots. N'est-elle pas corrélative d'une manière de penser, d'une vision du monde? La traduction épuise-t-elle vraiment la signification d'une langue? De plus, peut-on vraiment dire qu'il existe une universalité de la pensée? Si le langage est pensée, n'existe-t-il beaucoup de pensées différentes? Est-ce un mal?
«
qu'ils ne déterminent pas.
[...] Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4, et qu'il faut préférer son ami à son chien ; et je suis certain qu'il n'y a point d'homme du monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi.
Or jene vois point ces vérités dans l'esprit des autres : comme les autres ne les voient point dans le mien.
Il estdonc nécessaire qu'ils y ait une Raison universelle qui m'éclaire, et tout ce qu'il y a d'intelligences.
Car si laraison que je consulte, n'était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne pourrais pasêtre aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes vérités que je vois.
Ainsi la Raison quenous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes, est une Raison universelle.
Je dis quand nousrentrons dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné.
Lorsqu'unhomme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons, mais ce sont des raisonsparticulières dont tout homme raisonnable a horreur.
Ce sont des raisons qui dans le fond ne sont pasraisonnables, parce qu'elles ne sont pas conformes à la souveraine Raison, ou à la Raison universelle quetous les hommes consultent.
» MALEB RANCHE.
QUESTIONS
1.
Dégagez l'idée principale du texte et les étapes de son argumentation.2.
Expliquez :a.
« [...] la Raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes, est une Raison universelle ».b.
En quoi cette « Raison universelle » s'oppose-t-elle aux raisons particulières ?
QUESTION 1
Maleb ranche soutient la thèse selon laquelle « tous les hommes », sans exception donc, « participent » identiquement à une « Raison universelle » qui les « éclaire » de l'intérieur.
Ils sont tous illuminés par une mêmesource de vérités indubitables, mais ils ne savent pas toujours la regarder.L'argumentation du texte procède selon trois moments.1.
Tout d'abord (du début à « ne déterminent pas »), Maleb ranche expose une thèse générale sur laquelle tout le monde, semble-t-il (les « philosophes les moins éclairés » y compris), tombe d'accord : « tous les hommes sontcapables de connaître la vérité » parce qu'ils ont en commun une certaine « Raison », qui conditionne cette «capacité ».
Soulignons les nuances : Maleb ranche n'affirme, ni que tous les hommes connaissent effectivement la vérité, ni que chacun s'accorde sur la définition de la Raison à laquelle tous les hommes sont censés participer.
Ilretient simplement une « capacité » des hommes à connaître (ce qui suppose qu'elle n'est pas exploitée de la mêmefaçon chez tous) et une rationalité indéterminée (« qu'ils ne déterminent pas ») qui suffit au moins, dans un premiertemps, à définir l'humanité : l'homme est homme parce qu'il est capable, en faisant correctement usage de cette «capacité », d'atteindre la vérité.
Et cela, personne ne semble le remettre en doute.2.
La suite du texte s'attache à préciser la conception maleb ranchiste de cette Raison.
Jusqu'à « les mêmes vérités que je vois », l'auteur part ainsi d'une expérience commune (« je vois par exemple...
», le je étant ici universel etgénéralisable : chacun voit la même chose, s'il l'examine assez sincèrement), pour éliminer ensuite les faussesexplications de ce phénomène.
Puisque je ne puis voir ces vérités théoriques et pratiques dans l'esprit des autres, niles autres dans le mien (comment pénétrer en effet dans leur âme ?), je ne puis alors que (cela est « nécessaire »)les voir grâce à une Raison universelle, qui éclaire aussi bien mon voisin (le « Chinois ») que moi-même.
On aurabeau être de culture, de langue, etc., différentes, on s'accordera sur ces vérités premières, pour autant qu'on soitassez sincère pour l'avouer.
Nous devons donc tous, nous autres hommes, les puiser à une source commune, qui sedonne avec la même d'abondance à chacun sans jamais se tarir.3.
La fin du texte (à partir de « Ainsi la Raison...
») précise ce que Maleb ranche entend par « Raison universelle », c'est-à-dire commune à tous, en tous temps et en tous lieux.
Elle est essentiellement à distinguerde la raison particulière comprise comme motif de l'acte, et qui résulte le plus souvent d'un emportement passionnel(cf question 2b). Le texte de Maleb ranche est donc parfaitement construit, en entonnoir : il part d'une thèse générale pour arriver à la sienne, particulière.
QUESTION 2
a.
« la Raison que nous consultons quand nous rentrons dans nous-mêmes, est une Raison universelle ».
Il y a deuxniveaux de compréhension de cette formule : un niveau général, et un niveau plus maleb ranchiste.
Du point de vue général, l'on comprend que la Raison n'est pas quelque chose d'extérieur qu'il nous suffirait de regarder oud'attraper, mais bien une ressource de notre âme et plus précisément de notre coeur.
Elle nécessite donc, pour êtrereconnue, une attention et une concentration toutes particulières, que Maleb ranche désigne par un mouvement de plongée en soi-même, d'écoute absolue de ce que nous recelons au plus profond de nous-mêmes, le plus souventsans nous en apercevoir.
L'on comprend en outre que cette Raison comme cette capacité d'attention sont propres àtout homme sans exception, quel que soit son âge, son lieu et sa date de naissance : c'est ce que signifie l'adjectif« universelle ».
D'un point de vue plus maleb ranchiste maintenant, cette « Raison universelle », aussi nommée « Verbe intérieur », désigne la capacité spécifiquement humaine de « participer » à la Raison divine, de « voir en Dieu», comme le dit encore Maleb ranche, les vérités théoriques et pratiques les plus simples.
Si nous la possédons tous également, c'est donc parce que Dieu nous l'a donnée à tous également en partage, faute de quoi nous ne serionspas des hommes, mais peut-être des animaux ou des pierres ou, si nous n'avions pas de corps, des anges.b.
Cette Raison universelle s'oppose donc aux raisons particulières (cf les distinctions de la dernière partie du texte,entre la Raison au singulier et avec une majuscule, et les raisons au pluriel avec une minuscule), de la même façonque la vérité s'oppose au simple motif ou à la simple raison d'agir qui n'est pas clairement justifiée.
Maleb ranche.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La diversité des langues s'oppose-t-elle à l'universalité de la pensée ?
- La diversité des langues s'oppose-t-elle à l'universalité de la pensée ?
- Dans l’année 1814 et 1849, l’Europe est entre restauration et révolution, le mouvement des nationalités commence à se mettre en place et remet l’Europe en cause.
- La diversité des cultures remet-elle en question l’unité du genre humain ?
- Hegel_langues_pensées_devoirdephilo