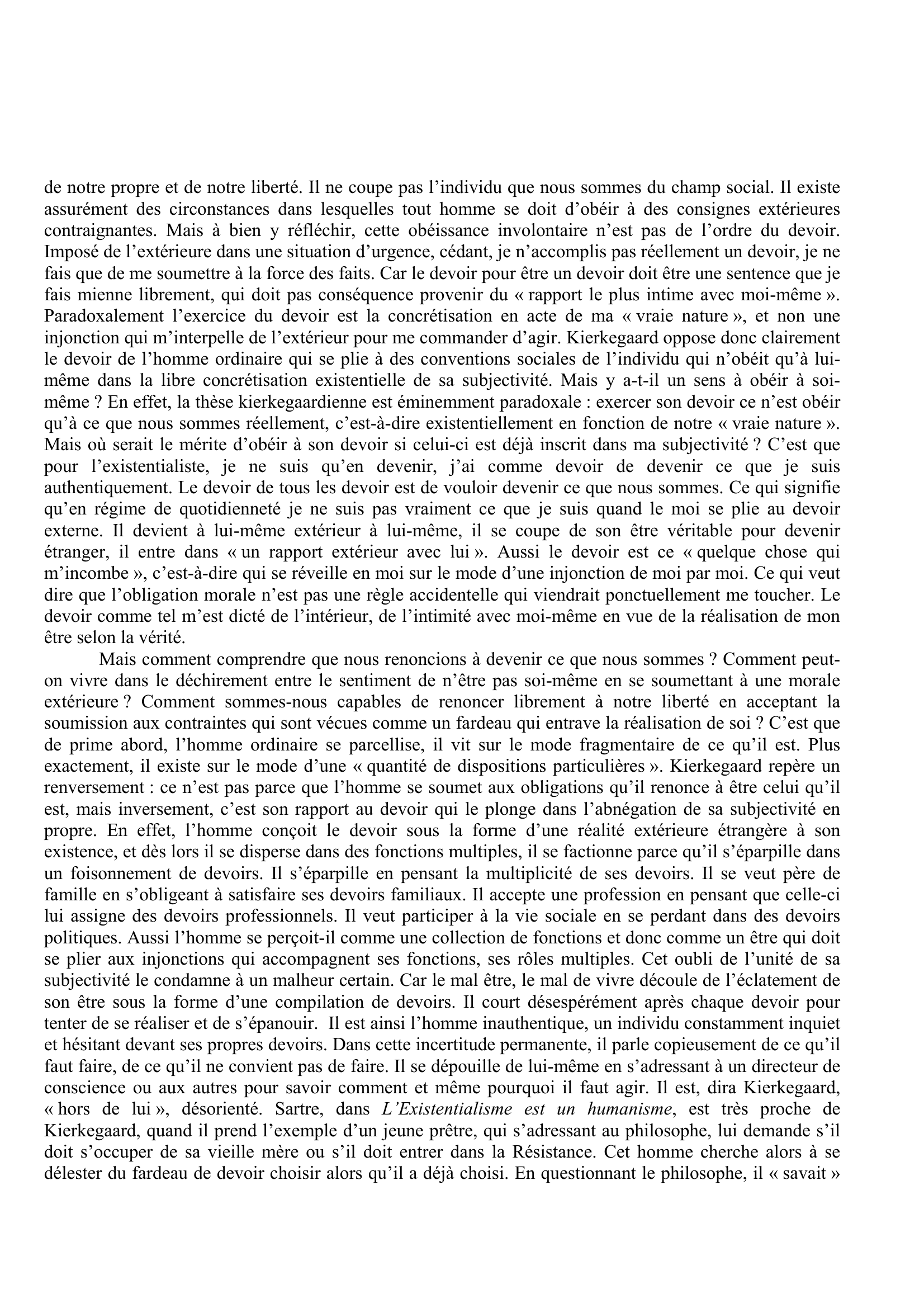Kierkegaard, Ou bien, ou bien : Le devoir
Publié le 06/05/2013
Extrait du document
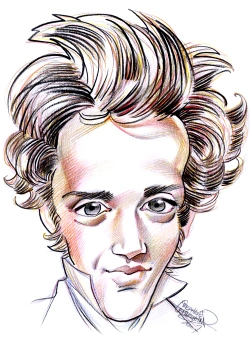
« Il est assez curieux qu'en parlant du devoir on pense à quelque chose d'extérieur, bien que le mot lui-même indique qu'il s'applique à quelque chose d'intérieur ; car ce qui m'incombe, non pas comme à un individu accidentel, mais d'après ma vraie nature, est bien le rapport le plus intime avec moi-même. Le devoir n'est pas une consigne, mais quelque chose qui incombe. Si un individu regarde ainsi le devoir, cela prouve qu'il s'est orienté en lui même. Alors le devoir ne se démembrera pas pour lui en une quantité de dispositions particulières, ce qui indique toujours qu'il ne se trouve qu'en un rapport extérieur avec lui. Il s'est revêtu du devoir, qui est pour lui l'expression de sa nature la plus intime. Ainsi orienté en lui même, il a approfondi l'éthique ; il ne sera pas essoufflé en faisant son possible pour remplir ses devoirs. L'individu vraiment éthique éprouve par conséquent de la tranquillité et de l'assurance, parce qu'il n'a pas le devoir hors de lui, mais en lui. Plus un homme a fondé profondément sa vie sur l'éthique, moins il sentira le besoin de parler constamment du devoir, de s'inquiéter pour savoir si il le remplit, de consulter à chaque instant les autres pour le connaître enfin. «
Kierkegaard, Ou bien, ou bien…, 1843.
Que devons-nous faire ? En quoi consiste notre devoir ? De prime abord le devoir quelque soit son contenu apparaît comme synonyme de contrainte, de violence qui viendrait de l’extérieur, qui nous forcerait à agir de telle sorte plutôt que d’une autre manière en faisant l’économie et de notre individualité et de notre liberté. Quelle est alors la véritable nature du devoir ? Est-il une inquiétante contrainte extérieure ou une sereine obligation venue de l’intériorité de l’individu ? Ces questions sont de poids puisqu’elles portent sur le fondement de l’éthique : qu’est-ce qui au fond nous oblige ? Si la contrainte extérieure détruit tout sens du devoir, ne vaut-il pas alors pour conserver notre subjectivité et notre liberté qu’elle ressorte d’une conviction profonde ? Elles mettent en jeu la liberté de la subjectivité dans son rapport au bonheur. En effet, comment être heureux en accomplissant son devoir ?
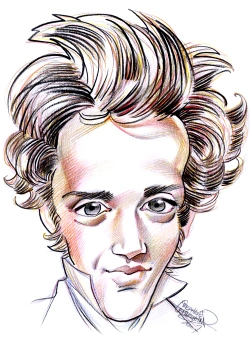
«
de notre propre et de notre liberté.
Il ne coupe pas l’individu que nous sommes du champ social.
Il existe
assurément des cir constances dans lesquelles tout homme se doit d’obéir à des consignes extérieures
contraigna ntes.
Mais à bien y ré fléchir, cette obéissance invol ontaire n’est pas de l’ordre du devoi r.
Imposé de l’extérieure dans u ne situation d’urgence, cédant , je n’accomplis pas réellement un devoir, je ne
fais que de me sou mettre à la f orce des faits.
Car le devoir pour être un devoir doit êtr e une sentence que je
fais mienne librement, qui doit pas conséquence provenir du « rapport le plus intime avec moi -même ».
Paradoxalement l’exercice du devoir est la concrétisation en acte de ma « vraie nature », et non une
injoncti on qui m’interp elle de l’extérieur pour me commander d’agir.
Kierkegaard oppose donc clairement
le devoir de l’homme ordinaire qui se plie à des conventions sociales de l’individu qui n’obéit qu’à lui -
même dans la libre concrétisation existentielle de sa subjectivité.
Mais y a- t- il un sens à obéir à soi -
même ? En effet, la thèse kierkegaardienne est éminemment paradoxale : exercer son devoir ce n’est obéir
qu’ à ce que nous sommes réellement, c’ est-à -dire existentiellement en fonction de notre « vraie nature ».
Mais où serait le mérite d’obéir à son devoir si celui -ci est déjà inscrit dans ma subjectiv ité ? C’est que
pour l’existentialiste , je ne suis qu’en devenir, j’ai comme devoir de devenir ce que je suis
authentiquement.
Le devoir de tous les devoir est de vouloir devenir ce que nous sommes.
Ce qui signifie
qu’en régime de quotidienneté je ne suis pas vraiment ce que je suis quand le moi se plie au devoir
externe.
Il devient à lui -même extérieur à lui -même, il se coupe de son être véritable pour devenir
étranger, il entre dans « un rapport extérieur avec lui ».
Aussi le devoir est ce « quelque chose qui
m’incombe », c’est -à -dire qui se réveille en moi sur le mode d’une injonction de moi par moi.
C e qui veut
dire que l’obligation morale n’est pas une règle accidentelle qui viendrait ponctuellement me toucher.
Le
devoir comme tel m’est dicté de l’intér ieur, de l’intimité avec moi-même en vue de la réalisation de mon
être selon la vérité.
Mais comment comprendre que nous renoncions à devenir ce que nous sommes ? Comment peut-
on vivre dans le déchirement entre le sentiment de n’être pas soi -même en se soumettant à une morale
extérieure ? Comment sommes -nous capables de renoncer librement à notre liberté en acceptant la
soumission aux contraintes qui sont vécues comme un fardeau qui entrave la réalisation de soi ? C’est que
de prime abord, l’homme ordinai re se parcellise, il vit sur le mode fragmentaire de ce qu’il est.
Plus
exactement, il existe sur le mode d’une « quantité de dispositions particulières ».
Kierkegaard repère un
renversement : ce n’est pas parce que l’homme se soumet aux obligations qu’il renonce à être celui qu’il
est, mais inversement, c’est son rapport au devoir qui le plonge dans l’abnégation de sa subjectivité en
propre.
En effet, l’homme conçoit le devoir sous la forme d’une réalité extérieure étrangère à son
existence, et dès lors il se disperse dans des fonctions multiples, il se factionne parce qu’il s’éparpille dans
un foisonnement de devoirs.
Il s’éparpille en pensant la multiplicité de ses devoirs.
Il se veut père de
famille en s’obligeant à satisfaire ses devoirs familiaux.
Il a ccepte une profession en pensant que celle-ci
lui assigne des devoirs professionnels.
Il veut participer à la vie sociale en se perdant dans des devoirs
politiques.
Aussi l’homme se perçoit -il comme une collection de fonctions et donc comme un être qui doi t
se plier aux injonctions qui accompagnent ses fonctions, ses rôles multiples.
Cet oubli de l’unité de sa
subjectivité le condamne à un malheur certain.
Car le mal être, le mal de vivre découle de l’éclatement de
son être sous la forme d’une compilation de devoirs.
Il court désespérément après chaque devoir pour
tenter de se réaliser et de s’épanouir.
Il est ainsi l’homme inauthentique, un individu constamment inquiet
et hésitant devant ses propres devoirs.
Dans cette incertitude permanente, il parle copi eusement de ce qu’il
faut faire, de ce qu’il ne convient pas de faire.
Il se dépouille de lui -même en s’adressant à un directeur de
conscience ou aux autres pour savoir comment et même pourquoi il faut agir.
Il est, dira Kierkegaard,
« hors de lui », désorienté.
Sartre, dans L’Existentialisme est un humanisme, est très proche de
Kierkegaard, quand il prend l’exemple d’un jeune prêtre, qui s’adressant au philosophe, lui demande s’il
doit s’occuper de sa vieille mère ou s’il doit entrer dans la Résistance.
Cet homme cherche alors à se
délester du fardeau de devoir choisir alors qu’il a déjà choisi.
En questionnant le philosophe, il « savait ».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard
- devoir laboratoire physique chaleur massique
- Avons-nous le devoir de chercher la vérité ?
- alphabétisation des femmes - DEVOIR COMMUN HGGSP
- DEVOIR HG: Sujet : comment la société Française évolue-t-elle de 1848 à 1870 ?