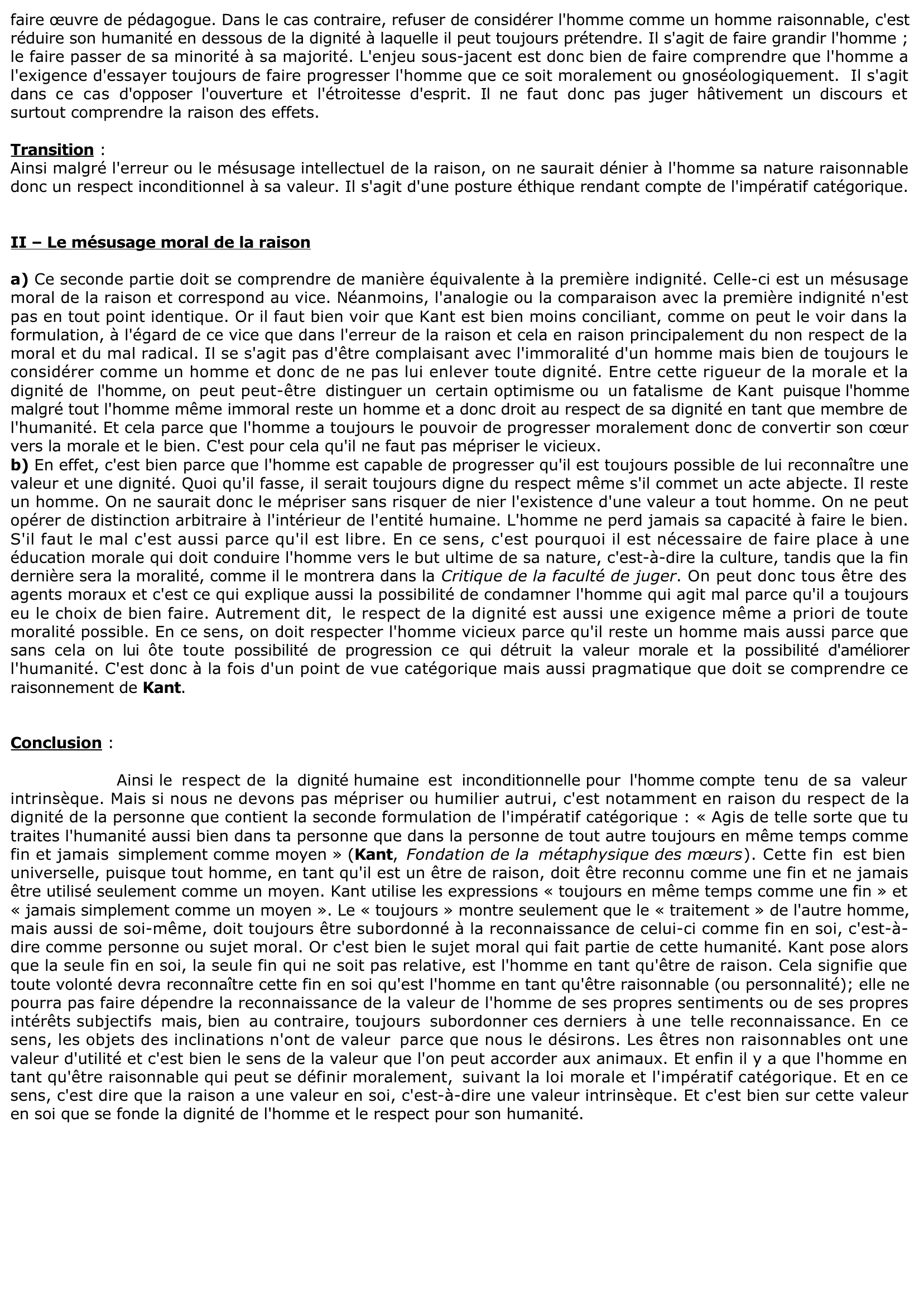Kant: On ne flétrira pas leurs erreurs
Publié le 27/02/2008
Extrait du document

QUESTIONNEMENT INDICATIF
• Pourquoi ne faut-il pas, selon Kant, flétrir les erreurs des hommes sous le nom d'absurdités, de jugements ineptes ? • Pourquoi faut-il, selon Kant, s'appliquer « à découvrir l'apparence qui les trompe «? • Que signifie « le principe subjectif des raisons déterminantes de leur jugement « ? • Quelle est la force du raisonnement par l'absurde opéré dans la deuxième phrase du texte ? • Quelle est l'importance, dans le raisonnement, de l'adverbe « absolument «? • Comment Kant s'y prend-il pour tenter de démontrer qu'il ne faut pas « pousser les reproches jusqu'à mépriser l'homme vicieux et lui refuser toute valeur morale «? • Ne pourrait-on soutenir que de tels jugements (ainsi que ceux qui flétrissent les erreurs sous le nom d'absurdités) sont des jugements à certains égards contradictoires ? • Quel est, finalement, l'enjeu de ce texte ?

«
faire œuvre de pédagogue.
Dans le cas contraire, refuser de considérer l'homme comme un homme raisonnable, c'estréduire son humanité en dessous de la dignité à laquelle il peut toujours prétendre.
Il s'agit de faire grandir l'homme ;le faire passer de sa minorité à sa majorité.
L'enjeu sous-jacent est donc bien de faire comprendre que l'homme al'exigence d'essayer toujours de faire progresser l'homme que ce soit moralement ou gnoséologiquement.
Il s'agitdans ce cas d'opposer l'ouverture et l'étroitesse d'esprit.
Il ne faut donc pas juger hâtivement un discours etsurtout comprendre la raison des effets.
Transition : Ainsi malgré l'erreur ou le mésusage intellectuel de la raison, on ne saurait dénier à l'homme sa nature raisonnabledonc un respect inconditionnel à sa valeur.
Il s'agit d'une posture éthique rendant compte de l'impératif catégorique.
II – Le mésusage moral de la raison a) Ce seconde partie doit se comprendre de manière équivalente à la première indignité.
Celle-ci est un mésusagemoral de la raison et correspond au vice.
Néanmoins, l'analogie ou la comparaison avec la première indignité n'estpas en tout point identique.
Or il faut bien voir que Kant est bien moins conciliant, comme on peut le voir dans laformulation, à l'égard de ce vice que dans l'erreur de la raison et cela en raison principalement du non respect de lamoral et du mal radical.
Il se s'agit pas d'être complaisant avec l'immoralité d'un homme mais bien de toujours leconsidérer comme un homme et donc de ne pas lui enlever toute dignité.
Entre cette rigueur de la morale et ladignité de l'homme, on peut peut-être distinguer un certain optimisme ou un fatalisme de Kant puisque l'hommemalgré tout l'homme même immoral reste un homme et a donc droit au respect de sa dignité en tant que membre del'humanité.
Et cela parce que l'homme a toujours le pouvoir de progresser moralement donc de convertir son cœurvers la morale et le bien.
C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser le vicieux.b) En effet, c'est bien parce que l'homme est capable de progresser qu'il est toujours possible de lui reconnaître unevaleur et une dignité.
Quoi qu'il fasse, il serait toujours digne du respect même s'il commet un acte abjecte.
Il resteun homme.
On ne saurait donc le mépriser sans risquer de nier l'existence d'une valeur a tout homme.
On ne peutopérer de distinction arbitraire à l'intérieur de l'entité humaine.
L'homme ne perd jamais sa capacité à faire le bien.S'il faut le mal c'est aussi parce qu'il est libre.
En ce sens, c'est pourquoi il est nécessaire de faire place à uneéducation morale qui doit conduire l'homme vers le but ultime de sa nature, c'est-à-dire la culture, tandis que la findernière sera la moralité, comme il le montrera dans la Critique de la faculté de juger .
On peut donc tous être des agents moraux et c'est ce qui explique aussi la possibilité de condamner l'homme qui agit mal parce qu'il a toujourseu le choix de bien faire.
Autrement dit, le respect de la dignité est aussi une exigence même a priori de toutemoralité possible.
En ce sens, on doit respecter l'homme vicieux parce qu'il reste un homme mais aussi parce quesans cela on lui ôte toute possibilité de progression ce qui détruit la valeur morale et la possibilité d'améliorerl'humanité.
C'est donc à la fois d'un point de vue catégorique mais aussi pragmatique que doit se comprendre ceraisonnement de Kant . Conclusion : Ainsi le respect de la dignité humaine est inconditionnelle pour l'homme compte tenu de sa valeurintrinsèque.
Mais si nous ne devons pas mépriser ou humilier autrui, c'est notamment en raison du respect de ladignité de la personne que contient la seconde formulation de l'impératif catégorique : « Agis de telle sorte que tutraites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps commefin et jamais simplement comme moyen » ( Kant , Fondation de la métaphysique des mœurs ).
Cette fin est bien universelle, puisque tout homme, en tant qu'il est un être de raison, doit être reconnu comme une fin et ne jamaisêtre utilisé seulement comme un moyen.
Kant utilise les expressions « toujours en même temps comme une fin » et« jamais simplement comme un moyen ».
Le « toujours » montre seulement que le « traitement » de l'autre homme,mais aussi de soi-même, doit toujours être subordonné à la reconnaissance de celui-ci comme fin en soi, c'est-à-dire comme personne ou sujet moral.
Or c'est bien le sujet moral qui fait partie de cette humanité.
Kant pose alorsque la seule fin en soi, la seule fin qui ne soit pas relative, est l'homme en tant qu'être de raison.
Cela signifie quetoute volonté devra reconnaître cette fin en soi qu'est l'homme en tant qu'être raisonnable (ou personnalité); elle nepourra pas faire dépendre la reconnaissance de la valeur de l'homme de ses propres sentiments ou de ses propresintérêts subjectifs mais, bien au contraire, toujours subordonner ces derniers à une telle reconnaissance.
En cesens, les objets des inclinations n'ont de valeur parce que nous le désirons.
Les êtres non raisonnables ont unevaleur d'utilité et c'est bien le sens de la valeur que l'on peut accorder aux animaux.
Et enfin il y a que l'homme entant qu'être raisonnable qui peut se définir moralement, suivant la loi morale et l'impératif catégorique.
Et en cesens, c'est dire que la raison a une valeur en soi, c'est-à-dire une valeur intrinsèque.
Et c'est bien sur cette valeuren soi que se fonde la dignité de l'homme et le respect pour son humanité..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?
- Je dus abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance Emmanuel Kant (1724-1804)