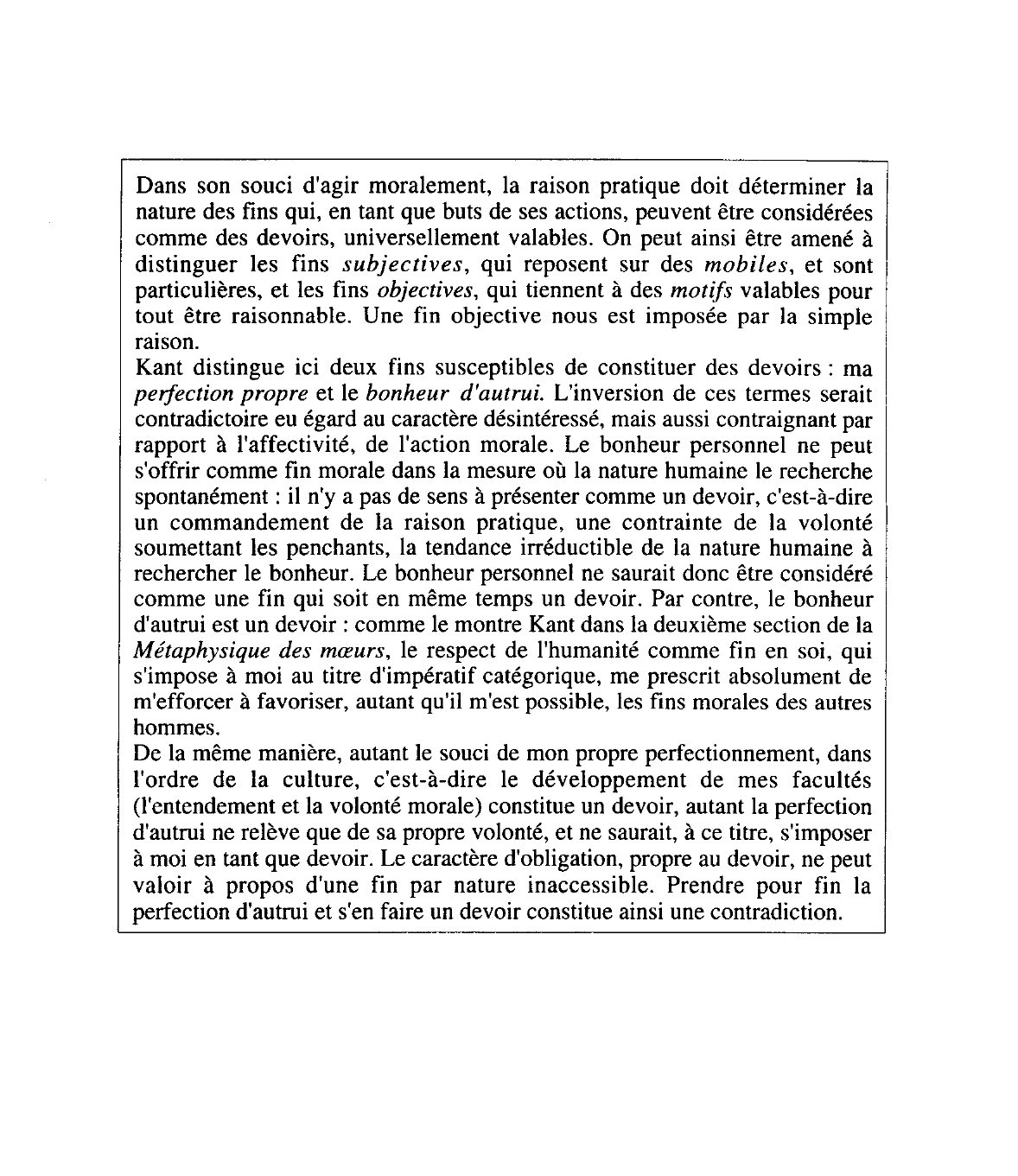Kant, Métaphysique des moeurs : Doctrine de la vertu, introduction, IV, trad. A. Philonenko, Vrin, Paris, 1968, p. 56.
Publié le 23/03/2015

Extrait du document

« Quelles sont les fins qui sont en même temps des devoirs ?
Ces fins sont : ma perfection propre et le bonheur d'autrui. On ne peut inverser la relation de ces termes et faire du bonheur personnel d'une part, lié à la perfection d'autrui d'autre part, des fins qui seraient en elles-mêmes des devoirs pour la même personne.
Le bonheur personnel, en effet, est une fin propre à tous les hommes (en raison de l'inclination de leur nature), mais cette fin ne peut jamais être regardée comme un devoir, sans que l'on se contredise. Ce que chacun inévitablement veut déjà de soi-même ne peut appartenir au concept du devoir ; en effet le devoir est une contrainte en vue d'une fin qui n'est pas voulue de bon gré. C'est donc se contredire que de dire qu'on est obligé de réaliser de toutes ses forces son propre bonheur.
C'est également une contradiction que de me prescrire comme fin la perfection d'autrui et que de me tenir comme obligé de la réaliser. En effet la perfection d'un autre homme, en tant que personne, consiste en ce qu'il est capable de se proposer lui-même sa fin d'après son concept du devoir, et c'est donc une contradiction que d'exiger (que de me poser comme devoir) que je doive faire à l'égard d'autrui une chose que lui seul peut faire. «
Kant, Métaphysique des moeurs : Doctrine de la vertu, introduction, IV, trad. A. Philonenko, Vrin, Paris, 1968, p. 56.

«
Textes commentés
Dans son souci d'agir moralement, la raison pratique doit déterminer la
nature des fins qui, en tant que buts de ses actions, peuvent être considérées
comme des devoirs, universellement valables.
On peut ainsi être amené à
distinguer les fins
subjectives, qui reposent sur des mobiles, et sont
particulières, et les fins
objectives, qui tiennent à des motifî valables pour
tout être raisonnable.
Une fin objective nous est imposée par la simple
raison.
Kant distingue ici deux fins susceptibles de constituer des devoirs : ma
perfection propre et le bonheur d'autrui.
L'inversion de ces termes serait
contradictoire eu égard
au caractère désintéressé, mais aussi contraignant par
rapport à l'affectivité, de l'action morale.
Le bonheur personnel ne peut
s'offrir comme fin morale dans la mesure où la nature humaine
le recherche
spontanément:
il n'y a pas de sens à présenter comme un devoir, c'est-à-dire
un commandement de la raison pratique, une contrainte de la volonté
soumettant les penchants, la tendance irréductible de la nature humaine à
rechercher le bonheur.
Le bonheur personnel ne saurait donc être considéré
comme une fin qui soit en même temps un devoir.
Par contre, le bonheur
d'autrui est un devoir : comme le montre Kant dans la deuxième section
de la
Métaphysique des mœurs, le respect de l'humanité comme fin en soi, qui
s'impose à moi au titre d'impératif catégorique, me prescrit absolument de
m'efforcer à favoriser, autant qu'il m'est possible, les fins morales des autres
hommes.
De la même manière, autant le souci de mon propre perfectionnement, dans
l'ordre de la culture, c'est-à-dire le développement de mes facultés
(l'entendement et la volonté morale) constitue
un devoir, autant la perfection
d'autrui
ne relève que de sa propre volonté, et ne saurait, à ce titre, s'imposer
à moi en tant que devoir.
Le caractère d'obligation, propre au devoir, ne peut
valoir à propos d'une fin par nature inaccessible.
Prendre pour fin la
perfection d'autrui et s'en faire
un devoir constitue ainsi une contradiction.
37.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'amitié chez Kant: extrait de la Doctrine de la Vertu, Métaphysique des moeurs, partie II
- Texte de Kant sur la distinction entre affections et passions. Doctrine de la vertu, introduction XVII
- Emmanuel KANT, Métaphysique des moeurs, 1" partie : « Doctrine du droit... ».
- Emmanuel Kant, Métaphysique des moeurs, Première partie : Doctrine du droit.
- Kant "La nature, c'est l'existence des choses, en tant qu'elle est déterminée selon des lois universelles." Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future, § 14, trad. L. Guillermit, Vrin, 1986, p. 61. Commentez cette citation.