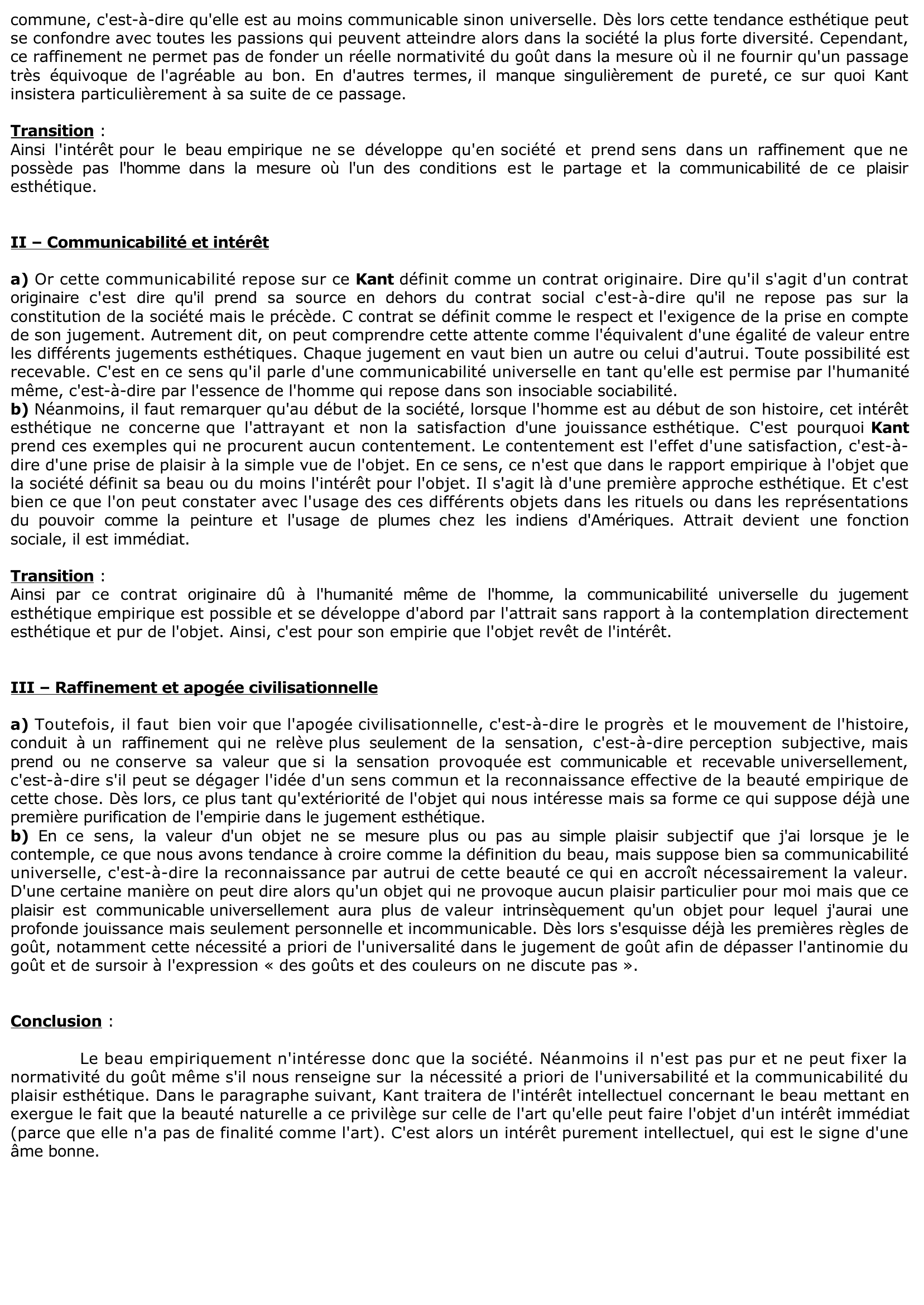Kant: Ile déserte
Publié le 16/04/2009
Extrait du document

• Différence(s) entre : — « être simplement homme «; — « être, à sa manière, un homme raffiné «; — « un homme raffiné «. • Examiner avec soin la problématique de la communication (du plaisir ?). — Différence(s) entre : « choses attrayantes «; « jolies formes «; « formes presque le but essentiel d'une inclinaison raffinée «; « idée de sa communicabilité universelle «. • Quel est l'enjeu de ce texte ? — Un essai sur les mœurs ? — Un essai sur le rôle des décorations ? — La mise à jour d'une spécificité de l'homme solidaire de « la civilisation « ? — La mise à jour d'une sociabilité essentielle de l'homme ? — Autre chose ?

«
commune, c'est-à-dire qu'elle est au moins communicable sinon universelle.
Dès lors cette tendance esthétique peutse confondre avec toutes les passions qui peuvent atteindre alors dans la société la plus forte diversité.
Cependant,ce raffinement ne permet pas de fonder un réelle normativité du goût dans la mesure où il ne fournir qu'un passagetrès équivoque de l'agréable au bon.
En d'autres termes, il manque singulièrement de pureté, ce sur quoi Kantinsistera particulièrement à sa suite de ce passage.
Transition : Ainsi l'intérêt pour le beau empirique ne se développe qu'en société et prend sens dans un raffinement que nepossède pas l'homme dans la mesure où l'un des conditions est le partage et la communicabilité de ce plaisiresthétique.
II – Communicabilité et intérêt a) Or cette communicabilité repose sur ce Kant définit comme un contrat originaire.
Dire qu'il s'agit d'un contrat originaire c'est dire qu'il prend sa source en dehors du contrat social c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur laconstitution de la société mais le précède.
C contrat se définit comme le respect et l'exigence de la prise en comptede son jugement.
Autrement dit, on peut comprendre cette attente comme l'équivalent d'une égalité de valeur entreles différents jugements esthétiques.
Chaque jugement en vaut bien un autre ou celui d'autrui.
Toute possibilité estrecevable.
C'est en ce sens qu'il parle d'une communicabilité universelle en tant qu'elle est permise par l'humanitémême, c'est-à-dire par l'essence de l'homme qui repose dans son insociable sociabilité.b) Néanmoins, il faut remarquer qu'au début de la société, lorsque l'homme est au début de son histoire, cet intérêtesthétique ne concerne que l'attrayant et non la satisfaction d'une jouissance esthétique.
C'est pourquoi Kant prend ces exemples qui ne procurent aucun contentement.
Le contentement est l'effet d'une satisfaction, c'est-à-dire d'une prise de plaisir à la simple vue de l'objet.
En ce sens, ce n'est que dans le rapport empirique à l'objet quela société définit sa beau ou du moins l'intérêt pour l'objet.
Il s'agit là d'une première approche esthétique.
Et c'estbien ce que l'on peut constater avec l'usage des ces différents objets dans les rituels ou dans les représentationsdu pouvoir comme la peinture et l'usage de plumes chez les indiens d'Amériques.
Attrait devient une fonctionsociale, il est immédiat.
Transition : Ainsi par ce contrat originaire dû à l'humanité même de l'homme, la communicabilité universelle du jugementesthétique empirique est possible et se développe d'abord par l'attrait sans rapport à la contemplation directementesthétique et pur de l'objet.
Ainsi, c'est pour son empirie que l'objet revêt de l'intérêt.
III – Raffinement et apogée civilisationnelle a) Toutefois, il faut bien voir que l'apogée civilisationnelle, c'est-à-dire le progrès et le mouvement de l'histoire,conduit à un raffinement qui ne relève plus seulement de la sensation, c'est-à-dire perception subjective, maisprend ou ne conserve sa valeur que si la sensation provoquée est communicable et recevable universellement,c'est-à-dire s'il peut se dégager l'idée d'un sens commun et la reconnaissance effective de la beauté empirique decette chose.
Dès lors, ce plus tant qu'extériorité de l'objet qui nous intéresse mais sa forme ce qui suppose déjà unepremière purification de l'empirie dans le jugement esthétique.b) En ce sens, la valeur d'un objet ne se mesure plus ou pas au simple plaisir subjectif que j'ai lorsque je lecontemple, ce que nous avons tendance à croire comme la définition du beau, mais suppose bien sa communicabilitéuniverselle, c'est-à-dire la reconnaissance par autrui de cette beauté ce qui en accroît nécessairement la valeur.D'une certaine manière on peut dire alors qu'un objet qui ne provoque aucun plaisir particulier pour moi mais que ceplaisir est communicable universellement aura plus de valeur intrinsèquement qu'un objet pour lequel j'aurai uneprofonde jouissance mais seulement personnelle et incommunicable.
Dès lors s'esquisse déjà les premières règles degoût, notamment cette nécessité a priori de l'universalité dans le jugement de goût afin de dépasser l'antinomie dugoût et de sursoir à l'expression « des goûts et des couleurs on ne discute pas ».
Conclusion : Le beau empiriquement n'intéresse donc que la société.
Néanmoins il n'est pas pur et ne peut fixer lanormativité du goût même s'il nous renseigne sur la nécessité a priori de l'universabilité et la communicabilité duplaisir esthétique.
Dans le paragraphe suivant, Kant traitera de l'intérêt intellectuel concernant le beau mettant enexergue le fait que la beauté naturelle a ce privilège sur celle de l'art qu'elle peut faire l'objet d'un intérêt immédiat(parce que elle n'a pas de finalité comme l'art).
C'est alors un intérêt purement intellectuel, qui est le signe d'uneâme bonne..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?
- Je dus abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance Emmanuel Kant (1724-1804)