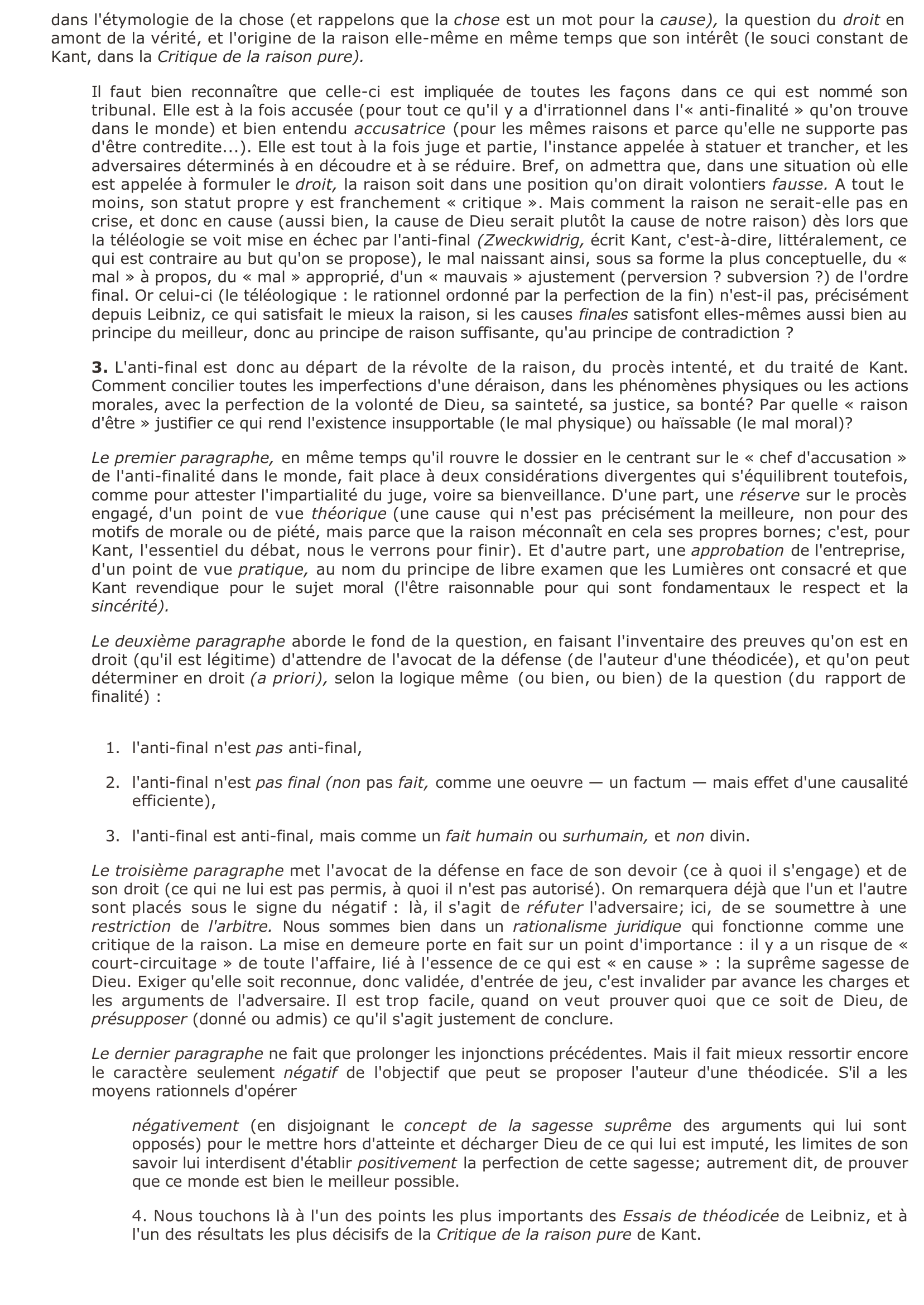KANT et Leibniz
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
dans l'étymologie de la chose (et rappelons que la chose est un mot pour la cause), la question du droit en amont de la vérité, et l'origine de la raison elle-même en même temps que son intérêt (le souci constant deKant, dans la Critique de la raison pure).
Il faut bien reconnaître que celle-ci est impliquée de toutes les façons dans ce qui est nommé sontribunal.
Elle est à la fois accusée (pour tout ce qu'il y a d'irrationnel dans l'« anti-finalité » qu'on trouvedans le monde) et bien entendu accusatrice (pour les mêmes raisons et parce qu'elle ne supporte pas d'être contredite...).
Elle est tout à la fois juge et partie, l'instance appelée à statuer et trancher, et lesadversaires déterminés à en découdre et à se réduire.
Bref, on admettra que, dans une situation où elleest appelée à formuler le droit, la raison soit dans une position qu'on dirait volontiers fausse.
A tout le moins, son statut propre y est franchement « critique ».
Mais comment la raison ne serait-elle pas encrise, et donc en cause (aussi bien, la cause de Dieu serait plutôt la cause de notre raison) dès lors quela téléologie se voit mise en échec par l'anti-final (Zweckwidrig, écrit Kant, c'est-à-dire, littéralement, ce qui est contraire au but qu'on se propose), le mal naissant ainsi, sous sa forme la plus conceptuelle, du «mal » à propos, du « mal » approprié, d'un « mauvais » ajustement (perversion ? subversion ?) de l'ordrefinal.
Or celui-ci (le téléologique : le rationnel ordonné par la perfection de la fin) n'est-il pas, précisémentdepuis Leibniz, ce qui satisfait le mieux la raison, si les causes finales satisfont elles-mêmes aussi bien au principe du meilleur, donc au principe de raison suffisante, qu'au principe de contradiction ?
3.
L'anti-final est donc au départ de la révolte de la raison, du procès intenté, et du traité de Kant.Comment concilier toutes les imperfections d'une déraison, dans les phénomènes physiques ou les actionsmorales, avec la per fection de la volonté de Dieu, sa sainteté, sa justice, sa bonté? Par quelle « raison d'être » justifier ce qui rend l'existence insupportable (le mal physique) ou haïssable (le mal moral)?
Le premier paragraphe, en même temps qu'il rouvre le dossier en le centrant sur le « chef d'accusation » de l'anti-finalité dans le monde, fait place à deux considérations divergentes qui s'équilibrent toutefois,comme pour attester l'impartialité du juge, voire sa bienveillance.
D'une part, une réserve sur le procès engagé, d'un point de vue théorique (une cause qui n'est pas précisément la meilleure, non pour des motifs de morale ou de piété, mais parce que la raison méconnaît en cela ses propres bornes; c'est, pourKant, l'essentiel du débat, nous le verrons pour finir).
Et d'autre part, une approbation de l'entreprise, d'un point de vue pratique, au nom du principe de libre examen que les Lumières ont consacré et que Kant revendique pour le sujet moral (l'être raisonnable pour qui sont fondamentaux le respect et lasincérité).
Le deuxième paragraphe aborde le fond de la question, en faisant l'inventaire des preuves qu'on est en droit (qu'il est légitime) d'attendre de l'avocat de la défense (de l'auteur d'une théodicée), et qu'on peutdéterminer en droit (a priori), selon la logique même (ou bien, ou bien) de la question (du rapport de finalité) :
l'anti-final n'est pas anti-final, 1.
l'anti-final n'est pas final (non pas fait, comme une oeuvre — un factum — mais effet d'une causalité efficiente), 2.
l'anti-final est anti-final, mais comme un fait humain ou surhumain, et non divin. 3.
Le troisième paragraphe met l'avocat de la défense en face de son devoir (ce à quoi il s'engage) et de son droit (ce qui ne lui est pas permis, à quoi il n'est pas autorisé).
On remarquera déjà que l'un et l'autresont placés sous le signe du négatif : là, il s'agit de réfuter l'adversaire; ici, de se soumettre à une restriction de l'arbitre.
Nous sommes bien dans un rationalisme juridique qui fonctionne comme une critique de la raison.
La mise en demeure porte en fait sur un point d'importance : il y a un risque de «court-circuitage » de toute l'affaire, lié à l'essence de ce qui est « en cause » : la suprême sagesse deDieu.
Exiger qu'elle soit reconnue, donc validée, d'entrée de jeu, c'est invalider par avance les charges etles arguments de l'adversaire.
Il est trop facile, quand on veut prouver quoi que ce soit de Dieu, deprésupposer (donné ou admis) ce qu'il s'agit justement de conclure.
Le dernier paragraphe ne fait que prolonger les injonctions précédentes.
Mais il fait mieux ressortir encore le caractère seulement négatif de l'objectif que peut se proposer l'auteur d'une théodicée.
S'il a les moyens rationnels d'opérer
négativement (en disjoignant le concept de la sagesse suprême des arguments qui lui sont opposés) pour le mettre hors d'atteinte et décharger Dieu de ce qui lui est imputé, les limites de sonsavoir lui interdisent d'établir positivement la perfection de cette sagesse; autrement dit, de prouver que ce monde est bien le meilleur possible.
4.
Nous touchons là à l'un des points les plus importants des Essais de théodicée de Leibniz, et à l'un des résultats les plus décisifs de la Critique de la raison pure de Kant.
a..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La philosophie de Kant par rapport à Leibniz
- MALEBRANCHE — LEIBNIZ - MONTESQUIEU - HUME - ROUSSEAU - KANT
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785