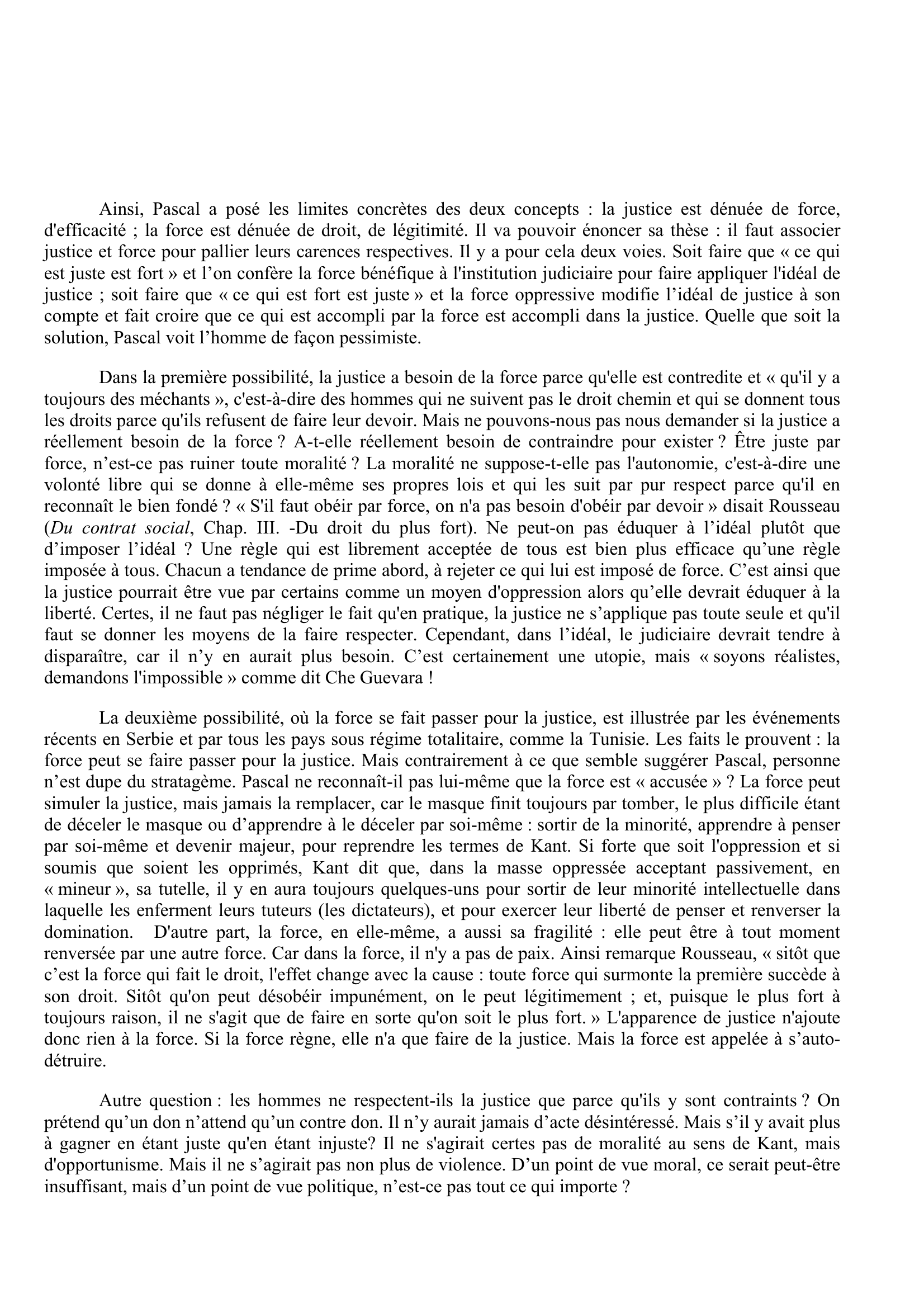Justice et droit chez Pascal
Publié le 05/12/2012
Extrait du document

Comment et pourquoi réconcilier la justice et la force ? Relevons d’abord que les concepts de justice et de force sont face à face, sans lien. Il est donc une contradiction ou du moins une dualité. La priorité lexicale laisse à penser que Pascal énonce une thèse préférant la force de la justice à la justification de la force. En effet, il y a deux manières de lier justice et force : négative, l’une faisant défaut à l’autre ; négative, l’urgence de la réconciliation se présente sous deux modes, la synthèse nécessaire marquée par le « il faut « s’établi soit sur fond de la justice, soit sur celui de la force. Le critère de décidabilité exhumé par le penseur est la dispute ou l’affrontement. Or du point de vue pratique, il faut choisir l’action et donc il faut accepter la force.

«
Ainsi, Pascal a posé les limites concrètes des deux concepts : l a justice est dénuée de force,
d'efficacité ; la forc e est dénuée de droit , de légitimité.
Il va pouvoir énoncer sa thèse : il faut associer
justice et force pour pallier leurs carences respectives.
Il y a pour cela deux voies.
Soit faire que « ce qui
est juste est fort » et l’on confère la force bénéfique à l'institution judiciaire pour faire appliquer l'idéal de
justice ; soit faire que « ce qui est fort est juste » et la force oppressive modifie l’idéal de justice à son
compte et fait croire que ce qui est accompli par la force est accompli dans la justice.
Quelle que soit la
solution, Pascal voit l’ homme de façon pessimiste.
Dans la première possibilité, la justice a besoin de la force parce qu'elle est contredite et « qu'il y a
toujours des méchants », c'est-à -dire des hommes qui ne suivent pas le droit chemin et qui se donnent tous
les droits parce qu'ils refusent de faire leur devoir.
Mais ne pouvons -nous pas nous demander si la justice a
réellement besoin de la force ? A-t- elle réellement besoin de contraindre pour exister ? Être juste par
force, n’ est-ce pas ruiner toute moralité ? La moralité ne suppose- t- elle pas l'autonomie, c'est -à -dire une
volonté libre qui se donne à elle -même ses propres lois et qui les suit par pur respect parce qu'il en
reconnaît le bien fondé ? « S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir » disait Rousseau
( Du contrat social , Chap.
III.
-Du droit du plus fort ).
Ne peut -on pas éduquer à l’idéal plutôt que
d’imposer l’idéal ? Une règle qui est librement acceptée de tous est bien plus efficace qu’une règle
imposée à tous.
Chacun a tendance de prime abord, à rejeter ce qui lui est imposé de force.
C’est ainsi que
la justice pourrait être vue par certains comme un moyen d'oppressio n alors qu’elle devrait éduquer à la
liberté.
Certes, il ne faut pas négliger le fait qu'en pratique, la justice ne s’ applique pas toute seule et qu'il
faut se donner les moyens de la fai re respecter.
Cependant, dans l’ idéal, le judiciaire devrait tendre à
disparaître, car il n’y en aurait plus besoin.
C ’est certainement une utopie, mais « soyons ré alistes,
demandons l'impossible » comme dit Che Guevara !
La deuxième possibilité, où la force se fait passer pour la justice, est illustrée par les événements
récents en Serbie et par tous les pays sous régime totalitaire, comme la Tunisie.
Les faits le prouvent : la
force peut se faire passer pour la justice.
Mais contrairement à ce que sem ble suggérer Pascal, personne
n’ est dupe du stratagème.
Pascal ne reconnaît -il pas lui -même que la force est « accusée » ? La force peut
simuler la justice, mais jamais la remplacer, car le masque finit toujours par tomber, le plus difficile étant
de déceler le masque ou d’ apprendre à le déceler par soi -même : sortir de la minorité, apprendre à penser
par soi -même et devenir majeur, pour reprendre les termes de Kant.
Si forte que soit l'oppression et si
soumis que soient les opprimés, Kant dit que, dans la masse oppre ssée acceptant passivement, en
« mineur », sa tutelle, il y en aura toujours quelques -uns pour sortir de leur minorité intellectuelle dans
laquelle les enferment leurs tuteurs (les dictateurs), et pour exercer leur liberté de penser et renverser la
domination.
D'autre part, la force, en elle -même, a aussi sa fragilité : elle peut être à tout moment
renversée par une autre force.
Car dans la force, il n'y a pas de paix.
Ainsi remarque Rousseau, « sitôt que
c’ est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause : toute force qui surmonte la première succède à
son droit.
Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement ; et, puisque le plus fort à
toujours raison, il ne s'agit que de faire e n sorte qu'on soit le plus fort.
» L'apparence de justice n'ajoute
donc rien à la force.
Si la force règne, elle n'a que faire de la justice.
Mais la force est appelée à s’auto -
détruire.
Autre question : les hommes ne respectent -ils la justice que parce q u'ils y sont contraints ? On
prétend qu’un don n’attend qu’un contre don.
Il n’y aurait jamais d’acte désintéressé.
Mais s’i l y avait plus
à gagner en étant juste qu'en étant injuste? Il ne s'agirait certes pas de moralité au sens de Kant , mais
d'opportunisme.
Mais il ne s’ agirait pas non plus de violence.
D’ un point de vue moral, ce serait peut-être
insuffisant, mais d’un point de vue politique, n’ est-ce pas tout ce qui importe ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- justice et droit (cours)
- cours philo justice et droit
- La Justice et le Droit
- Justice et droit
- la justice et le droit