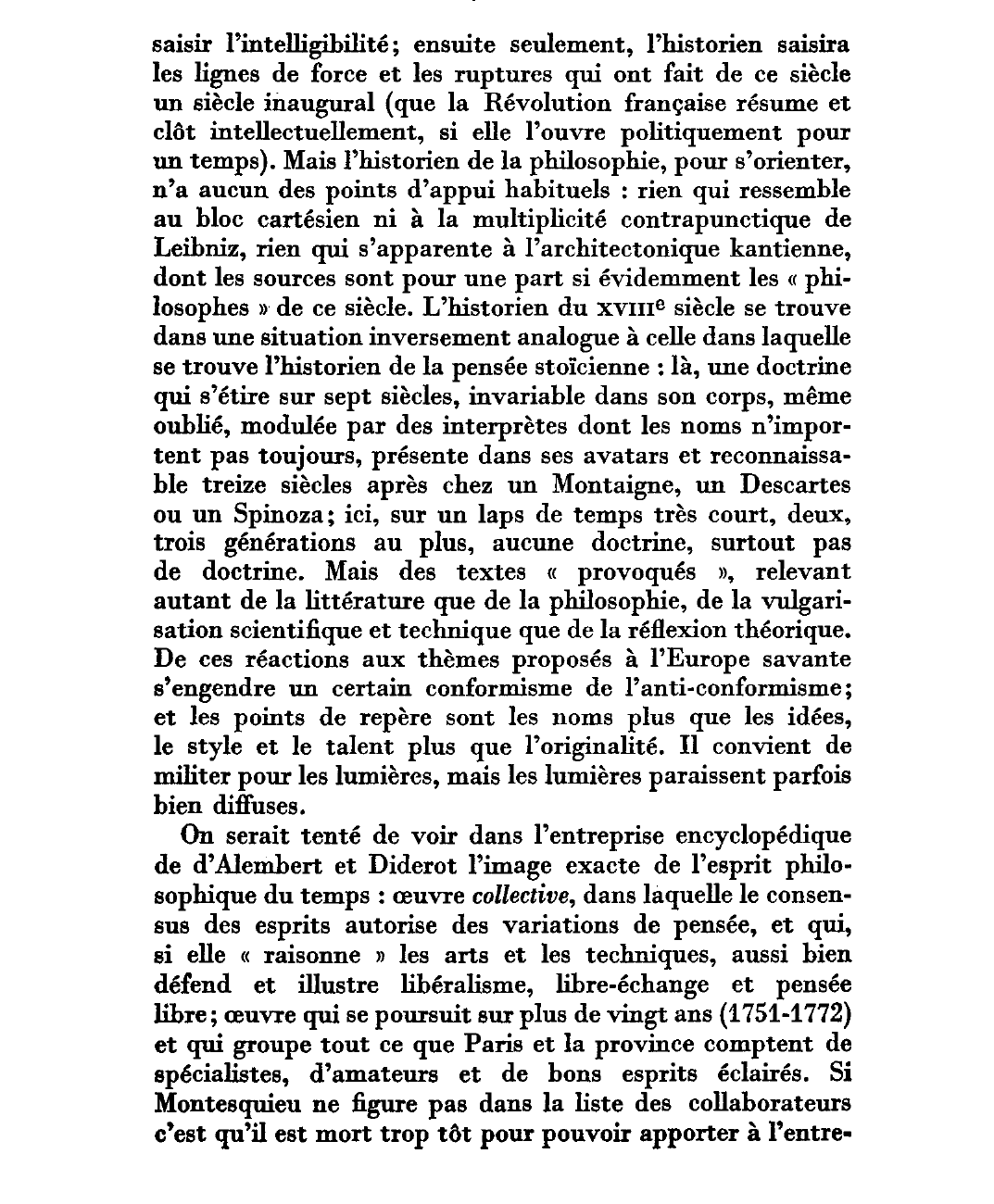JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Publié le 03/10/2013
Extrait du document

... l'historien saisira les lignes de force et les ruptures qui ont fait de ce siècle un siècle inaugural (que la Révolution française résume et clôt intellectuellement, si elle l'ouvre politiquement pour un temps). Mais l'historien de la philosophie, pour s'orienter, n'a aucun des points d'appui habituels : rien qui ressemble au bloc cartésien ni à la multiplicité contrapunctique de Leibniz, rien qui s'apparente à l'architectonique kantienne, dont les sources sont pour une part si évidemment les « philosophes « de ce siècle. L'historien du xviiie siècle se trouve dans une situation inversement analogue à celle dans laquelle se trouve l'historien de la pensée stoïcienne : là, une doctrine qui s'étire sur sept siècles, invariable dans son corps, même oublié, modulée par des interprètes dont les noms n'importent pas toujours, présente dans ses avatars et reconnaissable treize siècles après chez un Montaigne, un Descartes ou un Spinoza; ici, sur un laps de temps très court, deux, trois générations au plus, aucune doctrine, surtout pas de doctrine. Mais des textes « provoqués «, relevant autant de la littérature que de la philosophie, de la vulgarisation scientifique et technique que de la réflexion théorique. De ces réactions aux thèmes proposés à l'Europe savante s'engendre un certain conforlnÎsme de l'anti-conformisme; et les points de repère sont les noms plus que les idées, le style et le talent plus que l'originalité. Il convient de militer pour les lumières, mais les lumières paraissent parfois bien diffuses. On serait tenté de voir dans l'entreprise encyclopédique de d'Alembert et Diderot l'image exacte de l'esprit philosophique du temps : oeuvre collective, dans laquelle le consensus des esprits autorise des variations de pensée, et qui, si elle « raisonne « les arts et les techniques, aussi bien défend et illustre libéralisme, libre-échange et pensée libre; oeuvre qui se poursuit sur plus de vingt ans (1751-1772) et qui groupe tout ce que Paris et la province comptent de spécialistes, d'amateurs et de bons esprits éclairés. Si Montesquieu ne figure pas dans la liste des collaborateurs c'est qu'il est mort trop tôt pour pouvoir apporter à l'entre ...

«
saisir l'intelligibilité; ensuite seulement, l'historien sa1srra
les lignes de force et les ruptures qui ont fait de ce siècle
un siècle illaugural (que la Révolution française résume et
clôt intellectuellement, si elle l'ouvre politiquement pour
un temps).
Mais l'historien de la philosophie, pour s'orienter,
n'a aucun des points d'appui habituels : rien qui ressemble
au bloc cartésien ni à la multiplicité contrapunctique de
Leibniz, rien
qui s'apparente à l'architectonique kantienne,
dont les sources sont pour une part si évidemment les « phi
losophes » de ce siècle.
L'historien du xv111e siècle se trouve
dans une situation inversement analogue à celle dans laquelle
se
trouve l'historien de la pensée stoïcienne : là, une doctrine
qui s'étire sur sept siècles, invariable dans son corps, même
oublié, modulée par des interprètes dont les noms n'impor
tent pas toujours, présente dans ses avatars et reconnaissa
ble treize siècles après chez un Montaigne, un Descartes
ou un Spinoza; ici, sur un laps de temps très court, deux,
trois générations au plus, aucune doctrine, surtout pas
de doctrine.
Mais des textes « provoqués », relevant
autant de la littérature que de la philosophie, de la vulgari
sation scientifique et technique que de la réflexion théorique.
De ces réactions aux thèmes proposés à l'Europe savante
s'engendre un certain conforlnÎsme de l'anti-conforlnÎsme;
et les points de repère sont les noms plus que les idées,
le
style et le talent plus que l'originalité.
Il convient de
militer pour les lumières, mais les lumières paraissent parfois
bien diffuses.
On serait tenté de voir dans l'entreprise encyclopédique
de d'Alembert et Diderot l'image exacte de l'esprit philo
sophique du temps : œuvre collective, dans laquelle le consen
sus des esprits autorise des variations de pensée, et qui,
si elle
« raisonne » les arts et les techniques, aussi bien
défend et illustre libéralisme, libre-échange et pensée
libre; œuvre qui se poursuit sur plus de vingt ans ( 1751-1772)
et qui groupe tout ce que Paris et la province comptent de
spécialistes,
d'amateurs et de bons esprits éclairés.
Si
Montesquieu ne figure pas dans la liste des collaborateurs
c'est qu'il est mort trop tôt pour pouvoir apporter à l'entre•.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- Le due memorie di Jean-Jacques Rousseau
- Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau
- DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS, 1750. Jean-Jacques Rousseau - résumé de l'œuvre
- Confessions (les) de jean-Jacques Rousseau (résume et analyse complète)