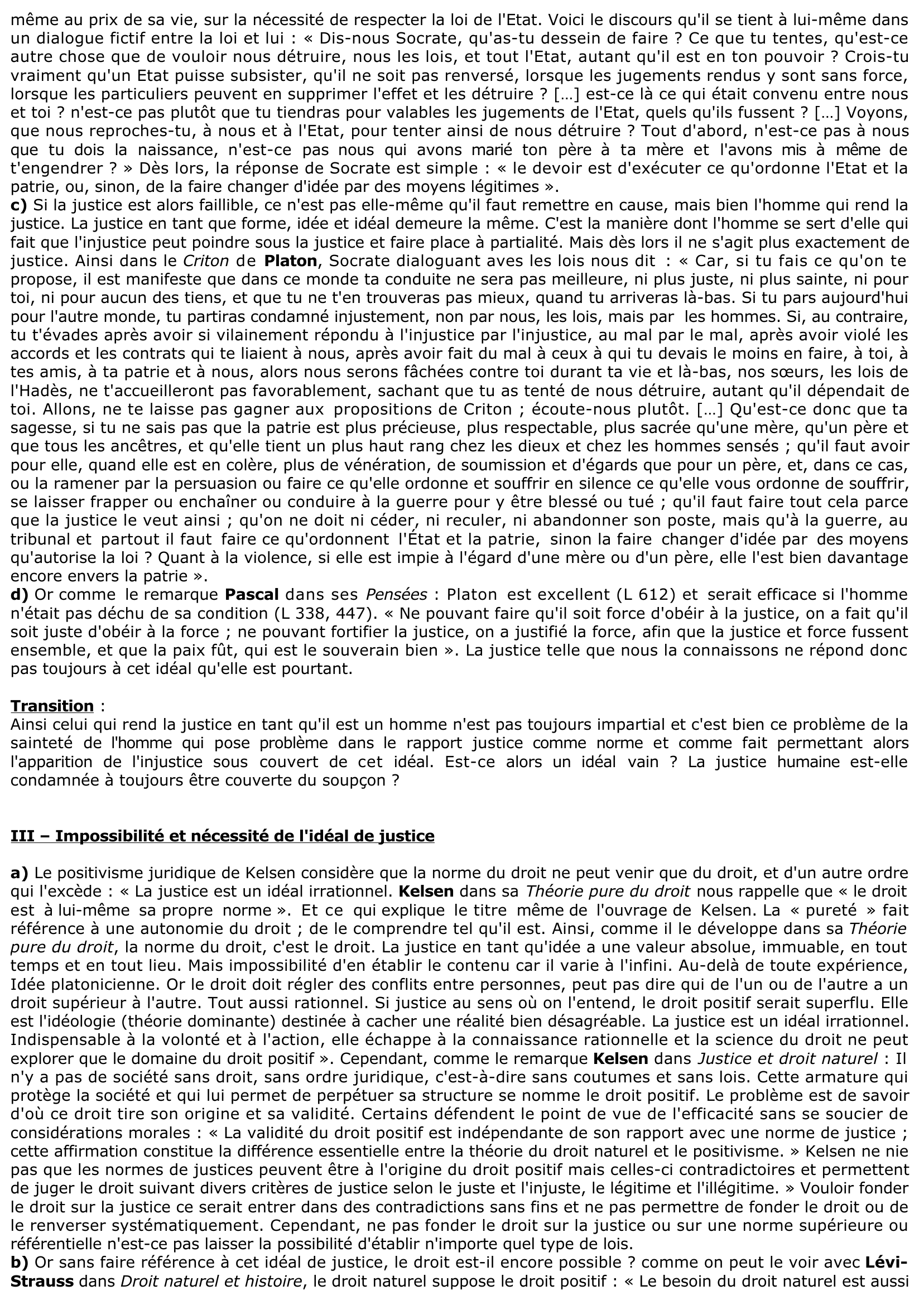« Je rends la justice, sans préjugé ni partialité » ?
Publié le 08/04/2009
Extrait du document

Cette phrase pourrait se comprendre comme celle du juge ou comme une prosopopée de la justice. La justice se « définirait ainsi comme impartiale. Dès lors elle devrait être universelle, c’être universelle, c’est-à-dire valable en tout temps et en tout lieu. La justice correspondrait bien alors à l’allégorie que l’on s’en forme d’une femme, symbole de pureté, yeux bandés, symbole d’impartialité, avec une épée, symbole de la sentence, et une balance, symbole de sa réflexion et du rapport harmonique qu’elle exprime dans la société. La justice, alors c’est la norme idéale qui peut définir le droit ou son principe même. Essentiellement elle exprime une certaine égalité. Mais cette définition de la justice en fait une idée, un idéal or l’expérience ne nous montre-t-elle pas que rendue par l’homme la justice ne saurait atteindre un tel idéal ?
S’il s’agit bien de la définition et de l’idéal de la justice (1ère partie), force est de constater que la justice ne peut s’y conformer (2nd partie), comment comprendre alors qu’elle le doive ? (3ème partie)
- I – L’idéal de justice
- II – L’homme et l’idéal
- III – Impossibilité et nécessité de l’idéal de justice

«
même au prix de sa vie, sur la nécessité de respecter la loi de l'Etat.
Voici le discours qu'il se tient à lui-même dansun dialogue fictif entre la loi et lui : « Dis-nous Socrate, qu'as-tu dessein de faire ? Ce que tu tentes, qu'est-ceautre chose que de vouloir nous détruire, nous les lois, et tout l'Etat, autant qu'il est en ton pouvoir ? Crois-tuvraiment qu'un Etat puisse subsister, qu'il ne soit pas renversé, lorsque les jugements rendus y sont sans force,lorsque les particuliers peuvent en supprimer l'effet et les détruire ? […] est-ce là ce qui était convenu entre nouset toi ? n'est-ce pas plutôt que tu tiendras pour valables les jugements de l'Etat, quels qu'ils fussent ? […] Voyons,que nous reproches-tu, à nous et à l'Etat, pour tenter ainsi de nous détruire ? Tout d'abord, n'est-ce pas à nousque tu dois la naissance, n'est-ce pas nous qui avons marié ton père à ta mère et l'avons mis à même det'engendrer ? » Dès lors, la réponse de Socrate est simple : « le devoir est d'exécuter ce qu'ordonne l'Etat et lapatrie, ou, sinon, de la faire changer d'idée par des moyens légitimes ».c) Si la justice est alors faillible, ce n'est pas elle-même qu'il faut remettre en cause, mais bien l'homme qui rend lajustice.
La justice en tant que forme, idée et idéal demeure la même.
C'est la manière dont l'homme se sert d'elle quifait que l'injustice peut poindre sous la justice et faire place à partialité.
Mais dès lors il ne s'agit plus exactement dejustice.
Ainsi dans le Criton de Platon , Socrate dialoguant aves les lois nous dit : « Car, si tu fais ce qu'on te propose, il est manifeste que dans ce monde ta conduite ne sera pas meilleure, ni plus juste, ni plus sainte, ni pourtoi, ni pour aucun des tiens, et que tu ne t'en trouveras pas mieux, quand tu arriveras là-bas.
Si tu pars aujourd'huipour l'autre monde, tu partiras condamné injustement, non par nous, les lois, mais par les hommes.
Si, au contraire,tu t'évades après avoir si vilainement répondu à l'injustice par l'injustice, au mal par le mal, après avoir violé lesaccords et les contrats qui te liaient à nous, après avoir fait du mal à ceux à qui tu devais le moins en faire, à toi, àtes amis, à ta patrie et à nous, alors nous serons fâchées contre toi durant ta vie et là-bas, nos sœurs, les lois del'Hadès, ne t'accueilleront pas favorablement, sachant que tu as tenté de nous détruire, autant qu'il dépendait detoi.
Allons, ne te laisse pas gagner aux propositions de Criton ; écoute-nous plutôt.
[…] Qu'est-ce donc que tasagesse, si tu ne sais pas que la patrie est plus précieuse, plus respectable, plus sacrée qu'une mère, qu'un père etque tous les ancêtres, et qu'elle tient un plus haut rang chez les dieux et chez les hommes sensés ; qu'il faut avoirpour elle, quand elle est en colère, plus de vénération, de soumission et d'égards que pour un père, et, dans ce cas,ou la ramener par la persuasion ou faire ce qu'elle ordonne et souffrir en silence ce qu'elle vous ordonne de souffrir,se laisser frapper ou enchaîner ou conduire à la guerre pour y être blessé ou tué ; qu'il faut faire tout cela parceque la justice le veut ainsi ; qu'on ne doit ni céder, ni reculer, ni abandonner son poste, mais qu'à la guerre, autribunal et partout il faut faire ce qu'ordonnent l'État et la patrie, sinon la faire changer d'idée par des moyensqu'autorise la loi ? Quant à la violence, si elle est impie à l'égard d'une mère ou d'un père, elle l'est bien davantageencore envers la patrie ».d) Or comme le remarque Pascal dans ses Pensées : Platon est excellent (L 612) et serait efficace si l'homme n'était pas déchu de sa condition (L 338, 447).
« Ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'ilsoit juste d'obéir à la force ; ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force, afin que la justice et force fussentensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien ».
La justice telle que nous la connaissons ne répond doncpas toujours à cet idéal qu'elle est pourtant.
Transition : Ainsi celui qui rend la justice en tant qu'il est un homme n'est pas toujours impartial et c'est bien ce problème de lasainteté de l'homme qui pose problème dans le rapport justice comme norme et comme fait permettant alorsl'apparition de l'injustice sous couvert de cet idéal.
Est-ce alors un idéal vain ? La justice humaine est-ellecondamnée à toujours être couverte du soupçon ? III – Impossibilité et nécessité de l'idéal de justice a) Le positivisme juridique de Kelsen considère que la norme du droit ne peut venir que du droit, et d'un autre ordrequi l'excède : « La justice est un idéal irrationnel.
Kelsen dans sa Théorie pure du droit nous rappelle que « le droit est à lui-même sa propre norme ».
Et ce qui explique le titre même de l'ouvrage de Kelsen.
La « pureté » faitréférence à une autonomie du droit ; de le comprendre tel qu'il est.
Ainsi, comme il le développe dans sa Théorie pure du droit , la norme du droit, c'est le droit.
La justice en tant qu'idée a une valeur absolue, immuable, en tout temps et en tout lieu.
Mais impossibilité d'en établir le contenu car il varie à l'infini.
Au-delà de toute expérience,Idée platonicienne.
Or le droit doit régler des conflits entre personnes, peut pas dire qui de l'un ou de l'autre a undroit supérieur à l'autre.
Tout aussi rationnel.
Si justice au sens où on l'entend, le droit positif serait superflu.
Elleest l'idéologie (théorie dominante) destinée à cacher une réalité bien désagréable.
La justice est un idéal irrationnel.Indispensable à la volonté et à l'action, elle échappe à la connaissance rationnelle et la science du droit ne peutexplorer que le domaine du droit positif ».
Cependant, comme le remarque Kelsen dans Justice et droit naturel : Il n'y a pas de société sans droit, sans ordre juridique, c'est-à-dire sans coutumes et sans lois.
Cette armature quiprotège la société et qui lui permet de perpétuer sa structure se nomme le droit positif.
Le problème est de savoird'où ce droit tire son origine et sa validité.
Certains défendent le point de vue de l'efficacité sans se soucier deconsidérations morales : « La validité du droit positif est indépendante de son rapport avec une norme de justice ;cette affirmation constitue la différence essentielle entre la théorie du droit naturel et le positivisme.
» Kelsen ne niepas que les normes de justices peuvent être à l'origine du droit positif mais celles-ci contradictoires et permettentde juger le droit suivant divers critères de justice selon le juste et l'injuste, le légitime et l'illégitime.
» Vouloir fonderle droit sur la justice ce serait entrer dans des contradictions sans fins et ne pas permettre de fonder le droit ou dele renverser systématiquement.
Cependant, ne pas fonder le droit sur la justice ou sur une norme supérieure ouréférentielle n'est-ce pas laisser la possibilité d'établir n'importe quel type de lois.b) Or sans faire référence à cet idéal de justice, le droit est-il encore possible ? comme on peut le voir avec Lévi- Strauss dans Droit naturel et histoire , le droit naturel suppose le droit positif : « Le besoin du droit naturel est aussi.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Entre la justice et ma mère, je préfère ma mère - Camus
- les inégalités sont elles compatibles avec la notion de justice sociale?
- La justice
- justice et droit (cours)
- La justice face aux crimes de masse depuis 1945