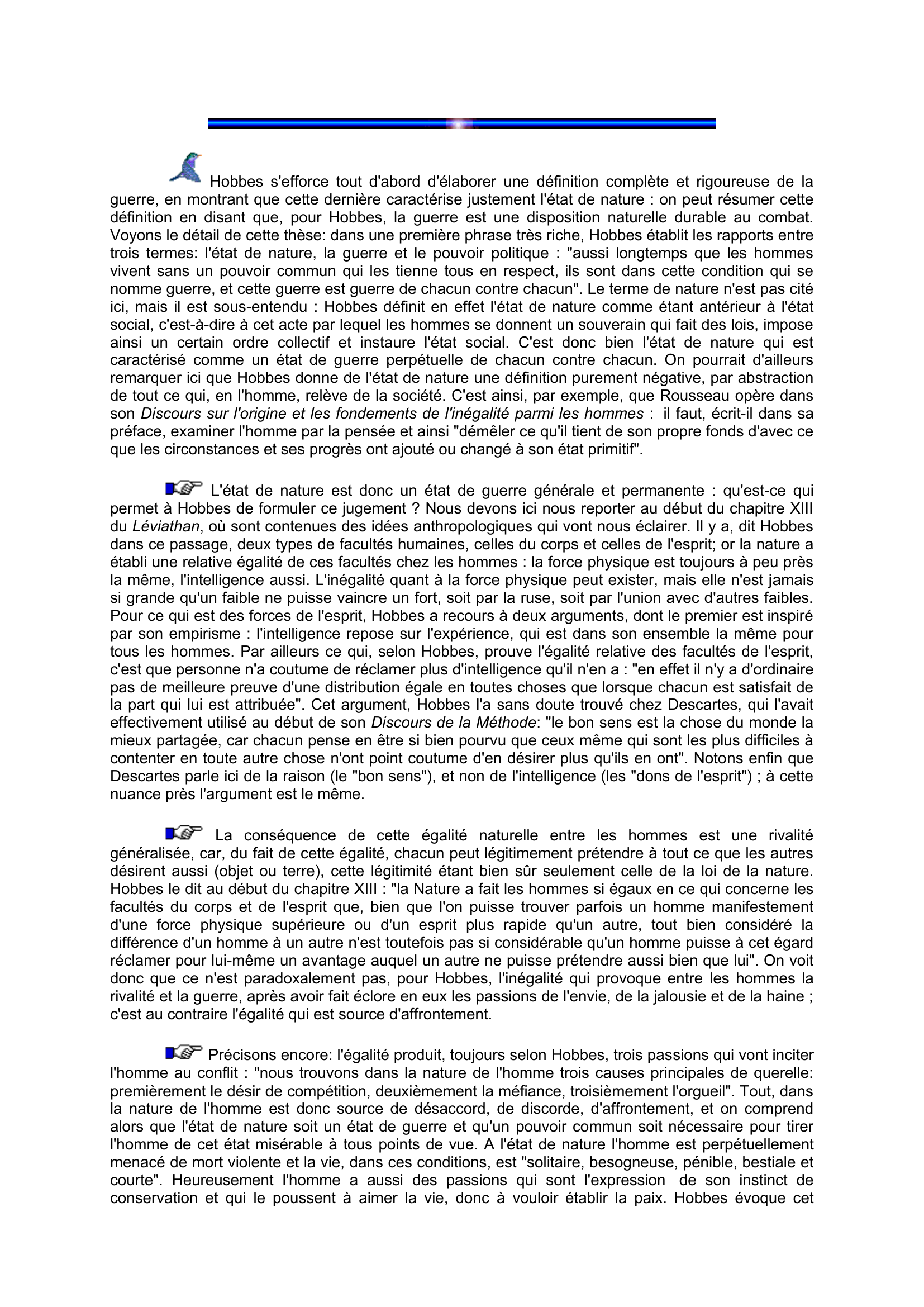Hobbes: Le Léviathan, chapitre 13.
Publié le 02/03/2020

Extrait du document
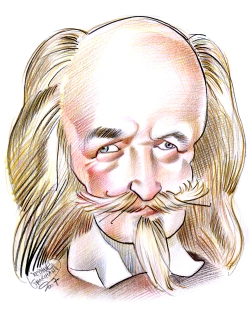
\"Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Car la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille et dans les combats effectifs, mais dans un espace de temps où la volonté de s'affronter en des batailles est suffisamment avérée: on doit par conséquent tenir compte, relativement à la nature de la guerre, de la notion de durée, comme on en tient compte relativement à la nature du temps qu'il fait. De même en effet que la nature du mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses, mais dans une tendance qui va dans ce sens, pendant un grand nombre de jours consécutifs, de même la nature de la guerre ne réside pas dans un combat effectif, mais dans une disposition avérée, allant dans ce sens, aussi longtemps qu'il n'y a pas assurance du contraire. Tout autre temps se nomme Paix.
(...) Il peut sembler étrange à celui qui n'a pas bien pesé ces choses que la nature puisse ainsi dissocier les hommes et les rendre enclins à s'attaquer et à se détruire les uns les autres: c'est pourquoi peut-être, incrédule à l'égard de cette inférence tirée des passions, cet homme désirera la voir confirmée par l'expérience. Aussi, faisant un retour sur lui-même, alors que partant en voyage il s'arme et cherche à être bien accompagné, qu'allant se coucher il verrouille ses portes, que dans sa maison même il ferme ses coffres à clef, et tout cela sachant qu'il existe des lois et des fonctionnaires publics armés pour venger tous les torts qui peuvent lui être faits: qu'il se demande quelle opinion il a de ses compatriotes quand il voyage armé, de ses concitoyens quand il verrouille ses portes, de ses enfants et de ses domestiques quand il ferme ses coffres à clef. N'incrimine-t-il pas l'humanité par ses actes autant que je le fais par mes paroles? Mais ni lui, ni moi n'incriminons la nature humaine en cela. Les désirs et les autres passions de l'homme ne sont pas en eux-mêmes des péchés. Pas davantage ne le sont les actions qui procèdent de ces passions tant que les hommes ne connaissent pas de loi qui les interdise; et il ne peuvent connaître de loi tant qu'il n'en a pas été fait; or aucune loi ne peut être faite tant que les hommes ne se sont pas entendus sur la personne qui doit la faire\".
Hobbes: Le Léviathan, chapitre 13.
L'aliénation du travail mécanisé, la société de consommation, la dégradation des milieux écologiques, l'égoïsme et la vanité liés aux valeurs de l'argent et du prestige social, l'exploitation de l'homme par l'homme : tous ces thèmes inspirent souvent une certaine nostalgie de la nature, c'est-à-dire le regret vague d'un état où l'homme vivait heureux, en harmonie tant avec la nature qu'avec ses semblables. Pourtant est-il bien sûr que l'état de nature soit aussi bénéfique pour l'homme ? Ne sommes-nous pas ici victimes, après tant d'autres, comme Bougainville, qui voyait dans la Polynésie la \"Nouvelle Cythère\", du mythe du bon sauvage ? Hobbes, quant à lui, affirme dans ce texte extrait du Léviathan (1651) que l'état de nature est un état de guerre perpétuelle, et que seule l'autorité politique établie à l'état social permet aux hommes de vivre ensemble, et même tout simplement de survivre. On voit que la réflexion politique, chez Hobbes, s'articule sur une certaine anthropologie : c'est la conception que l'on se fait de la nature humaine qui commande finalement le type de gouvernement que l'on veut promouvoir. A un homme naturellement pacifique on sera tenté d'attribuer un Etat libéral et respectueux des droits individuels, à un homme belliqueux on voudra imposer un Etat tout-puissant - un Léviathan - qui assure la paix et l'ordre par la force et la crainte. C'est dans le cadre de cette alternative que nous devons étudier le texte de Hobbes qui nous est proposé ici.
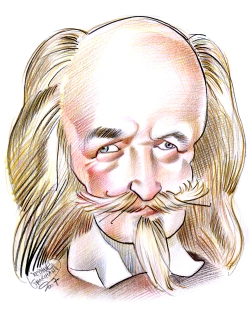
«
Hobbes s'efforce tout d'abord d'élaborer une définition complète et rigoureuse de la
guerre, en montrant que cette dernière carac térise justement l'état de nature : on peut résumer cette
définition en disant que, pour Hobbes, la guerre est une disposition naturelle durable au combat.
Voyons le détail de cette thèse: dans une première phrase très riche, Hobbes établit les rapports en tre
trois termes: l'état de nature, la guerre et le pouvoir politique : "aussi longtemps que les hommes
vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se
nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun co ntre chacun".
Le terme de nature n'est pas cité
ici, mais il est sous -entendu : Hobbes définit en effet l'état de nature comme étant antérieur à l'état
social, c'est -à-dire à cet acte par lequel les hommes se donnent un souverain qui fait des lois, impose
ainsi un certain ordre collectif et instaure l'état social.
C'est donc bien l'état de nature qui est
caractérisé comme un état de guerre perpétuelle de chacun contre chacun.
On pourrait d'ailleurs
remarquer ici que Hobbes donne de l'état de nature une défi nition purement négative, par abstraction
de tout ce qui, en l'homme, relève de la société.
C'est ainsi, par exemple, que Rousseau opère dans
son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes : il faut, écrit -il dans sa
préface, examiner l'homme par la pensée et ainsi "démêler ce qu'il tient de son propre fonds d'avec ce
que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif".
L'état de nature est donc un état de guerre générale et permanente : qu'est -ce qui
permet à Hobbes de formuler ce jugement ? Nous devons ici nous reporter au début du chapitre XIII
du Léviathan , où sont contenues des idées anthropologiques qui vont nous éclairer.
Il y a, dit Hobbes
dans ce passage, deux types de facultés humaines, ce lles du corps et celles de l'esprit; or la nature a
établi une relative égalité de ces facultés chez les hommes : la force physique est toujours à peu près
la même, l'intelligence aussi.
L'inégalité quant à la force physique peut exister, mais elle n'est j amais
si grande qu'un faible ne puisse vaincre un fort, soit par la ruse, soit par l'union avec d'autres faibles.
Pour ce qui est des forces de l'esprit, Hobbes a recours à deux arguments, dont le premier est inspiré
par son empirisme : l'intelligence repo se sur l'expérience, qui est dans son ensemble la même pour
tous les hommes.
Par ailleurs ce qui, selon Hobbes, prouve l'égalité relative des facultés de l'esprit,
c'est que personne n'a coutume de réclamer plus d'intelligence qu'il n'en a : "en effet il n 'y a d'ordinaire
pas de meilleure preuve d'une distribution égale en toutes choses que lorsque chacun est satisfait de
la part qui lui est attribuée".
Cet argument, Hobbes l'a sans doute trouvé chez Descartes, qui l'avait
effectivement utilisé au début de son Discours de la Méthode : "le bon sens est la chose du monde la
mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux même qui sont les plus difficiles à
contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont".
Noto ns enfin que
Descartes parle ici de la raison (le "bon sens"), et non de l'intelligence (les "dons de l'esprit") ; à cette
nuance près l'argument est le même.
La conséquence de cette égalité naturelle entre les hommes est une rivalité
généralisée, car, d u fait de cette égalité, chacun peut légitimement prétendre à tout ce que les autres
désirent aussi (objet ou terre), cette légitimité étant bien sûr seulement celle de la loi de la nature.
Hobbes le dit au début du chapitre XIII : "la Nature a fait les ho mmes si égaux en ce qui concerne les
facultés du corps et de l'esprit que, bien que l'on puisse trouver parfois un homme manifestement
d'une force physique supérieure ou d'un esprit plus rapide qu'un autre, tout bien considéré la
différence d'un homme à un autre n'est toutefois pas si considérable qu'un homme puisse à cet égard
réclamer pour lui -même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui".
On voit
donc que ce n'est paradoxalement pas, pour Hobbes, l'inégalité qui provoque entre les hommes la
rivalité et la guerre, après avoir fait éclore en eux les passions de l'envie, de la jalousie et de la haine ;
c'est au contraire l'égalité qui est source d'affrontement.
Précisons encore: l'égalité produit, toujours selon Hobbes, trois pas sions qui vont inciter
l'homme au conflit : "nous trouvons dans la nature de l'homme trois causes principales de querelle:
premièrement le désir de compétition, deuxièmement la méfiance, troisièmement l'orgueil".
Tout, dans
la nature de l'homme est donc so urce de désaccord, de discorde, d'affrontement, et on comprend
alors que l'état de nature soit un état de guerre et qu'un pouvoir commun soit nécessaire pour tirer
l'homme de cet état misérable à tous points de vue.
A l'état de nature l'homme est perpétuel lement
menacé de mort violente et la vie, dans ces conditions, est "solitaire, besogneuse, pénible, bestiale et
courte".
Heureusement l'homme a aussi des passions qui sont l'expression de son instinct de
conservation et qui le poussent à aimer la vie, don c à vouloir établir la paix.
Hobbes évoque cet.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Léviathan, Chapitre 13, Hobbes, 1651
- Hobbes, Léviathan (extrait du chapitre 17 : conventionnalisme politique) Léviathan constitue l’oeuvre majeure du philosophe anglais Thomas Hobbes.
- fiche de lecture sur Rousseau, du contrat social chapitre 1 et 4, Hobbes le léviathan chapitre 13 et 14
- Expliquez le texte suivant : Thomas HOBBES in « Léviathan », chapitre XIII.
- Hobbes - Léviathan - chapitre 13 (commentaire): C'est pourquoi tout ce qui est conséquence d'un temps de guerre, où chacun est ennemi de chacun, est aussi conséquence du temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur fournissent leur propre force et leur propre invention