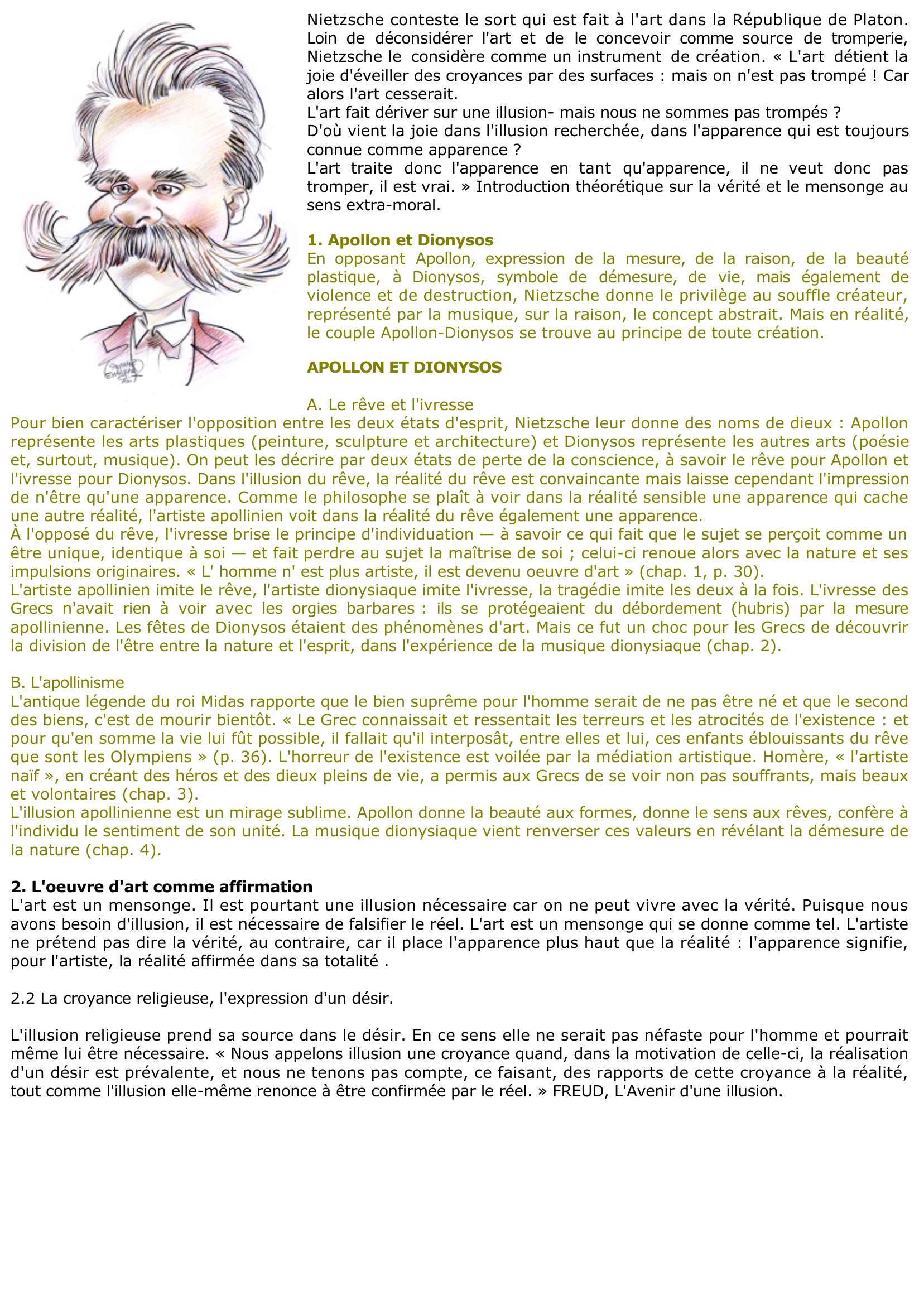Faut-il préférer la vérité à l'illusion ?
Publié le 16/09/2005
Extrait du document
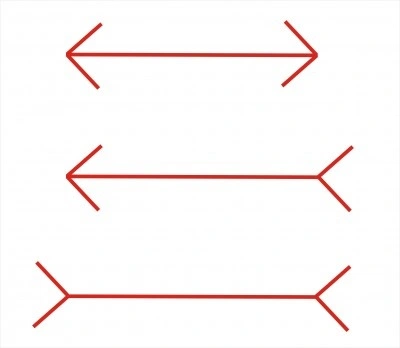
L’illusion est communément rapprochée de l’erreur. Un homme est abusé par une illusion quand par exemple il voit un bâton brisé dans l’eau et croit qu’il l’est effectivement. En ce sens l’illusion se rapproche de la tromperie et est synonyme d’obstacle à la vérité. Une des conséquences possibles de l’illusion est le scepticisme. En effet si l’illusion habite ce monde alors est-il encore possible d’avoir des certitudes ? Le doute est-il réellement exclu de ces certitudes ? La philosophie, comme recherche de la vérité, ne peut passer outre l’obstacle que constitue l’illusion. Un raccourci trompeur nous inciterait à identifier illusion et fausseté ou encore illusion et erreur. Or si l’illusion peut bien induire en erreur, elle n’est pas par elle-même une erreur. Le fait de voir le bâton brisé est réel, par contre juger qu’il l’est est une erreur. Une deuxième difficulté est à souligner elle concerne les domaines respectifs de la vérité et de l’illusion, ils ne s’entrecoupent pas nécessairement. L’illusion religieuse par exemple ne laisse pas de place à l’infirmation ou la confirmation, une croyance n’ayant pas par nature à être vraie ou fausse. Le domaine de l’illusion dépasse celui de la vérité. D’autre part la vérité est discursive dans la mesure où elle porte sur des jugements. L’illusion quant à elle porte soit sur des objets des sens, des croyances ou encore des idéologies. Les objets même de la vérité et de l’illusion sont de nature différente. Pour répondre à ces différents problèmes nous allons procéder en trois étapes. La première tend à examiner l’hypothèse suivant laquelle il faut préférer la vérité et se prémunir contre l’illusion dans la mesure où cette dernière est un obstacle à la recherche de la vérité. La deuxième partie limite la portée de la première hypothèse en soulignant le caractère non exclusif des choix de la vérité et de l’illusion. Enfin nous nous demanderons si l’illusion peut servir la cause de la vérité et si oui comment.
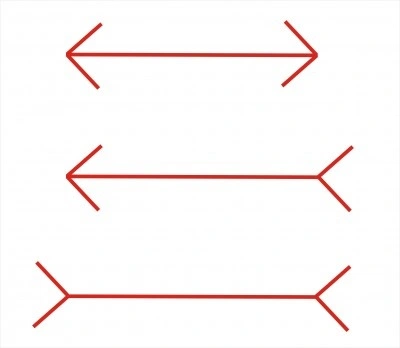
«
Nietzsche conteste le sort qui est fait à l'art dans la République de Platon.Loin de déconsidérer l'art et de le concevoir comme source de tromperie,Nietzsche le considère comme un instrument de création.
« L'art détient lajoie d'éveiller des croyances par des surfaces : mais on n'est pas trompé ! Caralors l'art cesserait.L'art fait dériver sur une illusion- mais nous ne sommes pas trompés ?D'où vient la joie dans l'illusion recherchée, dans l'apparence qui est toujoursconnue comme apparence ?L'art traite donc l'apparence en tant qu'apparence, il ne veut donc pastromper, il est vrai.
» Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge ausens extra-moral.
1.
Apollon et DionysosEn opposant Apollon, expression de la mesure, de la raison, de la beautéplastique, à Dionysos, symbole de démesure, de vie, mais également deviolence et de destruction, Nietzsche donne le privilège au souffle créateur,représenté par la musique, sur la raison, le concept abstrait.
Mais en réalité,le couple Apollon-Dionysos se trouve au principe de toute création.
APOLLON ET DIONYSOS
A.
Le rêve et l'ivresse Pour bien caractériser l'opposition entre les deux états d'esprit, Nietzsche leur donne des noms de dieux : Apollonreprésente les arts plastiques (peinture, sculpture et architecture) et Dionysos représente les autres arts (poésieet, surtout, musique).
On peut les décrire par deux états de perte de la conscience, à savoir le rêve pour Apollon etl'ivresse pour Dionysos.
Dans l'illusion du rêve, la réalité du rêve est convaincante mais laisse cependant l'impressionde n'être qu'une apparence.
Comme le philosophe se plaît à voir dans la réalité sensible une apparence qui cacheune autre réalité, l'artiste apollinien voit dans la réalité du rêve également une apparence.À l'opposé du rêve, l'ivresse brise le principe d'individuation — à savoir ce qui fait que le sujet se perçoit comme unêtre unique, identique à soi — et fait perdre au sujet la maîtrise de soi ; celui-ci renoue alors avec la nature et sesimpulsions originaires.
« L' homme n' est plus artiste, il est devenu oeuvre d'art » (chap.
1, p.
30).L'artiste apollinien imite le rêve, l'artiste dionysiaque imite l'ivresse, la tragédie imite les deux à la fois.
L'ivresse desGrecs n'avait rien à voir avec les orgies barbares : ils se protégeaient du débordement (hubris) par la mesureapollinienne.
Les fêtes de Dionysos étaient des phénomènes d'art.
Mais ce fut un choc pour les Grecs de découvrirla division de l'être entre la nature et l'esprit, dans l'expérience de la musique dionysiaque (chap.
2).
B.
L'apollinismeL'antique légende du roi Midas rapporte que le bien suprême pour l'homme serait de ne pas être né et que le seconddes biens, c'est de mourir bientôt.
« Le Grec connaissait et ressentait les terreurs et les atrocités de l'existence : etpour qu'en somme la vie lui fût possible, il fallait qu'il interposât, entre elles et lui, ces enfants éblouissants du rêveque sont les Olympiens » (p.
36).
L'horreur de l'existence est voilée par la médiation artistique.
Homère, « l'artistenaïf », en créant des héros et des dieux pleins de vie, a permis aux Grecs de se voir non pas souffrants, mais beauxet volontaires (chap.
3).L'illusion apollinienne est un mirage sublime.
Apollon donne la beauté aux formes, donne le sens aux rêves, confère àl'individu le sentiment de son unité.
La musique dionysiaque vient renverser ces valeurs en révélant la démesure dela nature (chap.
4).
2.
L'oeuvre d'art comme affirmationL'art est un mensonge.
Il est pourtant une illusion nécessaire car on ne peut vivre avec la vérité.
Puisque nousavons besoin d'illusion, il est nécessaire de falsifier le réel.
L'art est un mensonge qui se donne comme tel.
L'artistene prétend pas dire la vérité, au contraire, car il place l'apparence plus haut que la réalité : l'apparence signifie,pour l'artiste, la réalité affirmée dans sa totalité .
2.2 La croyance religieuse, l'expression d'un désir.
L'illusion religieuse prend sa source dans le désir.
En ce sens elle ne serait pas néfaste pour l'homme et pourraitmême lui être nécessaire.
« Nous appelons illusion une croyance quand, dans la motivation de celle-ci, la réalisationd'un désir est prévalente, et nous ne tenons pas compte, ce faisant, des rapports de cette croyance à la réalité,tout comme l'illusion elle-même renonce à être confirmée par le réel.
» FREUD, L'Avenir d'une illusion..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- A la vérité qui dérange faut-il préférer l’illusion qui réconforte ?
- Quand la vérité dérange, faut-il préférer l’illusion qui réconforte ?
- Lorsque la vérité dérange, faut-il lui préférer l'illusion qui réconforte?
- Faut-il préférer une vérité qui blesse à une illusion qui réconforte ?
- A la vérité qui dérange, faut-il préférer l’illusion qui réconforte ?