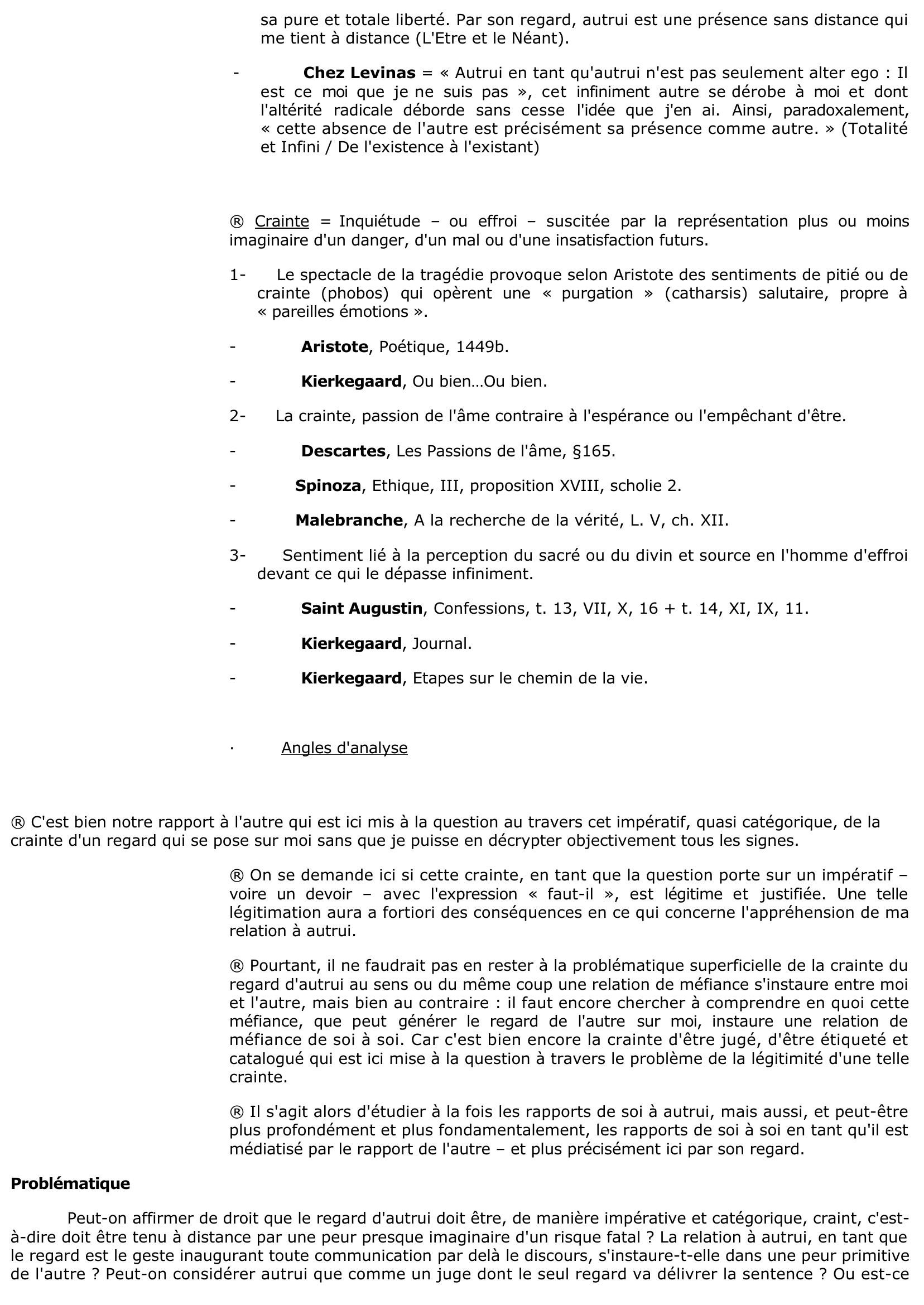Faut-il craindre le regard des autres ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Victor Hugo, dans "La légende des siècles", écrivait: "L'oeil était dans la tombe et regardait Caïn". Or, Caïn, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et, ce regard inquisiteur est au-delà du voir, bien plus il nous donne à voir notre honte, notre nullité; ou à l'inverse, notre magnanimité, notre excellence. Il est le lien de l'autre à moi. Par lui, j'ai affaire directement à l'altérité.
Alors, faut-il craindre le regard des autres? S'il y a largement de quoi donner un sens psychologique à ce sujet le nourrir de nos expériences quotidiennes, il prend un sens philosophique quand on s'avise que par le regard, c'est l'être même du sujet que je suis, c'est ma subjectivité qui perd quelque chose de sa certitude. Que suis-je pour l'autre? Un être doué des mêmes attributs? Un objet? Doit-on craindre de voir toutes les défenses que l'on se construit péniblement céder sous cette subite intrusion de l'autre au plus intime de soi-même?
Peut-on affirmer de droit que le regard d’autrui doit être, de manière impérative et catégorique, craint, c’est-à-dire doit être tenu à distance par une peur presque imaginaire d’un risque fatal ? La relation à autrui, en tant que le regard est le geste inaugurant toute communication par delà le discours, s’instaure-t-elle dans une peur primitive de l’autre ? Peut-on considérer autrui que comme un juge dont le seul regard va délivrer la sentence ? Ou est-ce encore trop réducteur pour définir essentiellement la relation qui lie l’autre à soi ?
C’est donc bien la relation, dans son geste inaugurale, aux autres qui est ici mise à la question.
Ce sujet concentre en lui toute la problématique du difficile rapport du "moi" aux autres. Que sont les autres pour moi? A quel titre existent-ils pour moi, et à quel titre existé-je pour eux?
«
sa pure et totale liberté.
Par son regard, autrui est une présence sans distance quime tient à distance (L'Etre et le Néant).
- Chez Levinas = « Autrui en tant qu'autrui n'est pas seulement alter ego : Il est ce moi que je ne suis pas », cet infiniment autre se dérobe à moi et dontl'altérité radicale déborde sans cesse l'idée que j'en ai.
Ainsi, paradoxalement,« cette absence de l'autre est précisément sa présence comme autre.
» (Totalitéet Infini / De l'existence à l'existant)
® Crainte = Inquiétude – ou effroi – suscitée par la représentation plus ou moins imaginaire d'un danger, d'un mal ou d'une insatisfaction futurs.
1- Le spectacle de la tragédie provoque selon Aristote des sentiments de pitié ou decrainte (phobos) qui opèrent une « purgation » (catharsis) salutaire, propre à« pareilles émotions ».
- Aristote , Poétique, 1449b.
- Kierkegaard , Ou bien…Ou bien.
2- La crainte, passion de l'âme contraire à l'espérance ou l'empêchant d'être.
- Descartes , Les Passions de l'âme, §165.
- Spinoza , Ethique, III, proposition XVIII, scholie 2.
- Malebranche , A la recherche de la vérité, L.
V, ch.
XII.
3- Sentiment lié à la perception du sacré ou du divin et source en l'homme d'effroi devant ce qui le dépasse infiniment.
- Saint Augustin , Confessions, t.
13, VII, X, 16 + t.
14, XI, IX, 11.
- Kierkegaard , Journal.
- Kierkegaard , Etapes sur le chemin de la vie.
· Angles d'analyse
® C'est bien notre rapport à l'autre qui est ici mis à la question au travers cet impératif, quasi catégorique, de lacrainte d'un regard qui se pose sur moi sans que je puisse en décrypter objectivement tous les signes.
® On se demande ici si cette crainte, en tant que la question porte sur un impératif –voire un devoir – avec l'expression « faut-il », est légitime et justifiée.
Une tellelégitimation aura a fortiori des conséquences en ce qui concerne l'appréhension de marelation à autrui.
® Pourtant, il ne faudrait pas en rester à la problématique superficielle de la crainte duregard d'autrui au sens ou du même coup une relation de méfiance s'instaure entre moiet l'autre, mais bien au contraire : il faut encore chercher à comprendre en quoi cetteméfiance, que peut générer le regard de l'autre sur moi, instaure une relation deméfiance de soi à soi.
Car c'est bien encore la crainte d'être jugé, d'être étiqueté etcatalogué qui est ici mise à la question à travers le problème de la légitimité d'une tellecrainte.
® Il s'agit alors d'étudier à la fois les rapports de soi à autrui, mais aussi, et peut-êtreplus profondément et plus fondamentalement, les rapports de soi à soi en tant qu'il estmédiatisé par le rapport de l'autre – et plus précisément ici par son regard.
Problématique
Peut-on affirmer de droit que le regard d'autrui doit être, de manière impérative et catégorique, craint, c'est- à-dire doit être tenu à distance par une peur presque imaginaire d'un risque fatal ? La relation à autrui, en tant quele regard est le geste inaugurant toute communication par delà le discours, s'instaure-t-elle dans une peur primitivede l'autre ? Peut-on considérer autrui que comme un juge dont le seul regard va délivrer la sentence ? Ou est-ce.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il craindre le regard d'autrui ?
- Faut-il craindre le regard d’autrui ?
- plan : faut-il craindre le regard d'autrui?
- Faut-il craindre le regard des autres ?
- Faut-il craindre le regard des autres ?