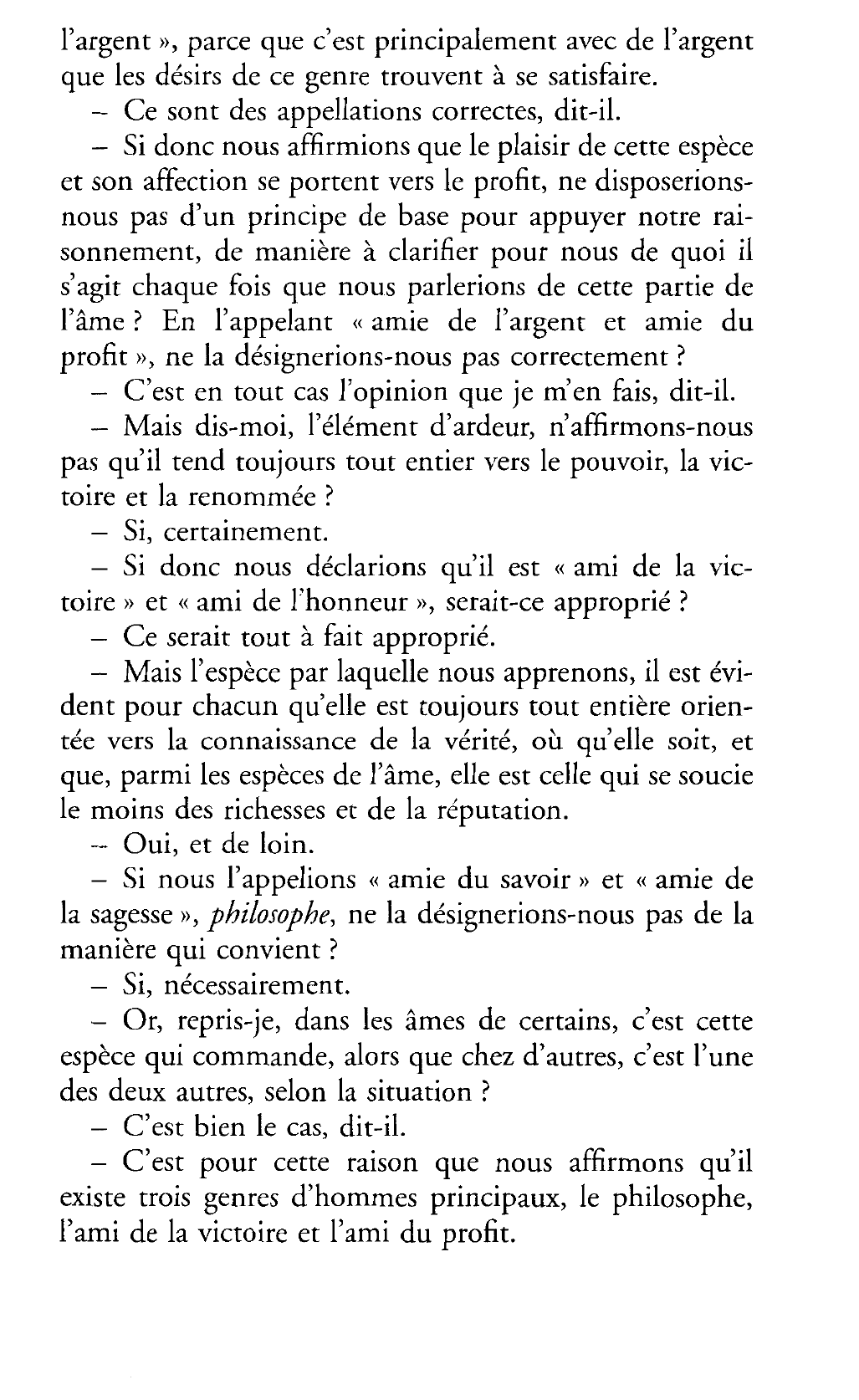EXTRAITS DE LA PENSÉE DE PLATON (Anthologie philosophique)
Publié le 25/03/2015

Extrait du document
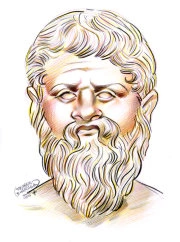
EXTRAITS
1. Tripartition de la société, tripartition
de l'âme
Platon, République, trad. Georges Leroux,
GF-Flammarion, 2004, p. 460-462.
— Si, de même que la cité est divisée en trois classes, l'âme de chaque individu est aussi divisée en trois, on en tirera à mon avis une démonstration supplémentaire.
— Laquelle ?
— Celle-ci. Puisqu'il existe trois espèces de l'âme, il me semble qu'il y aura aussi trois espèces de plaisirs, propres à chacune d'elles. Il en sera de même pour les désirs et pour les principes de commandement.
— Que veux-tu dire ? demanda-t-il.
— La première espèce, avons-nous affirmé, est celle par laquelle l'homme apprend, la deuxième, celle par laquelle il a de l'ardeur. Quant à la troisième, en raison de son caractère polymorphe, nous n'avons pas pu la désigner d'un nom unique, qui lui soit propre, mais nous lui avons donné le nom de ce qu'il y a en elle de plus impor¬tant et de plus fort : nous l'avons en effet appelée « espèce désirante «, à cause de la force des désirs relatifs à la nour¬riture, à la boisson, aux plaisirs d'Aphrodite et à tout ce qui leur est associé. Nous l'avons aussi appelée « amie de
l'argent «, parce que c'est principalement avec de l'argent que les désirs de ce genre trouvent à se satisfaire.
— Ce sont des appellations correctes, dit-il.
— Si donc nous affirmions que le plaisir de cette espèce et son affection se portent vers le profit, ne disposerions-nous pas d'un principe de base pour appuyer notre rai¬sonnement, de manière à clarifier pour nous de quoi il s'agit chaque fois que nous parlerions de cette partie de l'âme ? En l'appelant « amie de l'argent et amie du profit «, ne la désignerions-nous pas correctement ?
— C'est en tout cas l'opinion que je m'en fais, dit-il.
— Mais dis-moi, l'élément d'ardeur, n'affirmons-nous pas qu'il tend toujours tout entier vers le pouvoir, la vic¬toire et la renommée ?
— Si, certainement.
— Si donc nous déclarions qu'il est « ami de la vic¬toire « et « ami de l'honneur «, serait-ce approprié ?
— Ce serait tout à fait approprié.
— Mais l'espèce par laquelle nous apprenons, il est évi¬dent pour chacun qu'elle est toujours tout entière orien¬tée vers la connaissance de la vérité, où qu'elle soit, et que, parmi les espèces de l'âme, elle est celle qui se soucie le moins des richesses et de la réputation.
— Oui, et de loin.
— Si nous l'appelions « amie du savoir « et « amie de la sagesse «, philosophe, ne la désignerions-nous pas de la manière qui convient ?
— Si, nécessairement.
— Or, repris-je, dans les âmes de certains, c'est cette espèce qui commande, alors que chez d'autres, c'est l'une des deux autres, selon la situation ?
— C'est bien le cas, dit-il.
— C'est pour cette raison que nous affirmons qu'il existe trois genres d'hommes principaux, le philosophe, l'ami de la victoire et l'ami du profit.
2. La vertu est un « juste milieu «
Aristote, Éthique à Nicomaque,
trad. Richard Bodéüs, GF-Flammarion, 2004,
p. 112-117.
Si donc les vertus ne sont ni des affections, ni des capacités, il reste qu'elles sont des états.
Ainsi donc, on a dit ce qu'est génériquement la vertu. On doit cependant ne pas se borner à déclarer ainsi qu'elle est un état, mais encore indiquer quelle sorte d'état.
Il faut donc noter que toute vertu met finalement en bon état ce dont elle est vertu et en même temps, lui permet de bien remplir son office. Ainsi, la vertu de l'oeil fait que l'oeil est parfait et remplit bien son office, car la vertu de l'oeil fait que nous voyons bien. Pareillement, la vertu du cheval fait qu'il est un bon cheval et parfait pour courir, porter son cavalier et tenir devant les ennemis.
Dès lors, s'il en va de la sorte dans tous les cas, la vertu de l'homme doit aussi être l'état qui fait de lui un homme bon et qui lui permet de bien remplir son office propre.
Et comment est-ce possible ? Nous l'avons déjà dit, mais on le verra de nouveau par ce qui suit, en considé¬rant dans sa spécificité la nature de la vertu.
Ainsi, dans tout ce qui est continu et divisible, on peut trouver le plus, le moins et l'égal. Et cela se détermine, soit dans la chose même, soit relativement à nous. — Or l'égal est une sorte de milieu entre l'excès et le défaut.
D'autre part, j'appelle milieu de la chose, ce qui se trouve à égale distance de chacun des deux extrêmes, milieu qui est un et le même aux yeux de tous. En revanche, le milieu déterminé relativement à nous, c'est ce qui n'est, pour nous, ni trop ni trop peu ; or ce milieu n'est pas une chose unique, ni la même pour tous.
Par exemple, si dix est beaucoup et deux peu, on prend six comme le milieu dans la série, puisqu'il dépasse et est dépassé par une quantité égale. Et ce milieu est conforme au rapport arithmétique. En revanche, le milieu relatif à nous-mêmes ne doit pas être pris de cette façon. En effet, si pour un homme, dix mines à manger 1, c'est beaucoup et que deux, c'est peu, le diététicien ne va pas pour autant prescrire invariablement six mines, car c'est peut-être encore beaucoup pour celui qui doit les prendre, ou bien trop peu. Pour Milon 2, en effet, c'est peu, mais pour qui débute en gymnastique, c'est beaucoup. Il en va de même pour la course ou la lutte.
Ainsi, quiconque s'y connaît fuit alors l'excès et le défaut. Il cherche au contraire le milieu et c'est lui qu'il prend pour objectif. Et ce milieu n'est pas celui de la chose, mais celui qui se détermine relativement à nous. Dès lors, si c'est ainsi que toute connaissance réussit à remplir son office en gardant en vue le milieu et en oeuvrant dans sa direction — d'où l'habitude de déclarer, à propos des oeuvres réussies, qu'on n'y peut ni retran¬cher, ni ajouter quoi que ce soit, dans l'idée que l'excès et le défaut ruinent la perfection, tandis que la moyenne la préserve —, et si de leur côté, les bons artisans, comme nous le disons, l'ont en point de mire lorsqu'ils tra¬vaillent, mais que la vertu, comme la nature, surclasse toute forme d'art en rigueur et en valeur, alors la vertu est propre à faire viser le milieu.
Je parle de la vertu morale, car c'est elle qui concerne affections et actions. Or, dans ce domaine, il y a excès, défaut et milieu. Exemple : on peut s'effrayer, se montrer intrépide, nourrir des appétits, s'irriter, s'apitoyer et, en
1. Sans doute une ration journalière, évaluée en poids de nourri¬ture solide. La mine athénienne pouvait dépasser le kilo.
2. L'athlète Milon de Crotone, célèbre pour sa force, était aussi d'un appétit légendaire.
somme, éprouver du plaisir et du chagrin, tantôt plus, tantôt moins et, dans les deux cas, sans que ce soit à bon escient ; mais, le faire quand on doit, pour les motifs, envers les personnes, dans le but et de la façon qu'on doit, constitue un milieu et une perfection ; ce qui préci¬sément relève de la vertu. — Et pareillement, dans les actions, il y a aussi excès, défaut et milieu.
D'autre part, la vertu concerne des affections et des actions où l'excès et le défaut sont égarements et objets de blâme, alors que le milieu appelle des louanges et est une réussite. Or ces deux traits sont typiques de la vertu. Donc, la vertu est une sorte de moyenne, puisqu'elle fait à tout le moins viser le milieu.
De plus, la faute comporte de multiples travers. — Le mal, en effet, relève de l'infini, comme le conjecturaient les Pythagoriciens, alors que le bien relève du fini. — En revanche, ce qui réussit est simple. C'est aussi pourquoi le mal est facile et le bien difficile : facile de rater la cible, mais difficile de l'atteindre. Et pour ces raisons encore, c'est donc du vice que relèvent l'excès et le défaut, et de la vertu que relève la moyenne. « Car on est noble simplement, mais vilain si différemment 1 ! «
Par conséquent, la vertu est un état décisionnel qui consiste en une moyenne, fixée relativement à nous. C'est sa définition formelle et c'est ainsi que la définirait l'homme sagace. D'autre part, elle est une moyenne entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut ; et cela tient encore au fait que les vices, ou bien restent en deçà, ou bien vont au-delà de ce qui est demandé dans les affec¬tions et les actions, alors que la vertu découvre le milieu et le choisit.
1. Aphorisme tiré, croit-on, d'un poète gnomique inconnu.
3. La parabole des talents
Matthieu, )0CV, 14-30, trad. Louis Segond.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens.
Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents.
De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte.
Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apportant cinq autres talents, et il dit : Seigneur, tu m'as remis cinq talents ; voici, j'en ai gagné cinq autres.
Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m'as remis deux talents ; voici, j'en ai gagné deux autres.
Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé, et qui amasses où tu n'as pas vanné ;
j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi.
Son maître lui répondit : Serviteur méchant et pares-seux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j amasse ou je n ai pas vanne ;
il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abon-dance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
4. La marche de l'égalité
Tocqueville, De la démocratie en Amérique [1835],
GF-Flammarion, 1981, t. I, Introduction, p. 57-60.
Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société ; il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois ; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habi¬tudes particulières aux gouvernés.
Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des moeurs politiques et des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la société civile que sur le gouvernement : il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas.
Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société améri¬caine, je voyais de plus en plus, dans l'égalité des condi¬tions, le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir.
Alors je reportai ma pensée vers notre hémisphère, et il me sembla que j'y distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait le nouveau monde. Je vis l'éga¬lité des conditions qui, sans y avoir atteint comme aux États-Unis ses limites extrêmes, s'en rapprochait chaque jour davantage ; et cette même démocratie, qui régnait sur les sociétés américaines, me parut en Europe s'avancer rapidement vers le pouvoir.
De ce moment j'ai conçu l'idée du livre qu'on va lire. Une grande révolution démocratique s'opère parmi nous ; tous la voient, mais tous ne la jugent point de la
même manière. Les uns la considèrent comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils espèrent pouvoir encore l'arrêter ; tandis que d'autres la jugent irrésistible, parce qu'elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l'on connaisse dans l'histoire.
Je me reporte pour un moment à ce qu'était la France il y a sept cents ans : je la trouve partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants ; le droit de commander descend alors de générations en générations avec les héritages ; les hommes n'ont qu'un seul moyen d'agir les uns sur les autres, la force ; on ne découvre qu'une seule origine de la puis¬sance, la propriété foncière.
Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à s'étendre. Le clergé ouvre ses rangs à tous, au pauvre et au riche, au roturier et au seigneur ; l'égalité commence à pénétrer par l'Église au sein du gou¬vernement, et celui qui eût végété comme serf dans un éternel esclavage, se place comme prêtre au milieu des nobles, et va souvent s'asseoir au-dessus des rois.
La société devenant avec le temps plus civilisée et plus stable, les différents rapports entre les hommes deviennent plus compliqués et plus nombreux. Le besoin des lois civiles se fait vivement sentir. Alors naissent les légistes ; ils sortent de l'enceinte obscure des tribunaux et du réduit poudreux des greffes, et ils vont siéger dans la cour du prince, à côté des barons féodaux couverts d'her¬mine et de fer.
Les rois se ruinent dans les grandes entreprises ; les nobles s'épuisent dans les guerres privées ; les roturiers s'enrichissent dans le commerce. L'influence de l'argent commence à se faire sentir sur les affaires de l'État. Le négoce est une source nouvelle qui s'ouvre à la puissance, et les financiers deviennent un pouvoir politique qu'on méprise et qu'on flatte.
Peu à peu, les lumières se répandent ; on voit se réveiller le goût de la littérature et des arts ; l'esprit devient alors un élément de succès ; la science est un moyen de gouvernement, l'intelligence une force sociale ; les lettrés arrivent aux affaires.
À mesure cependant qu'il se découvre des routes nou¬velles pour parvenir au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la noblesse était d'un prix inestimable ; on l'achète au XIIIe ; le premier anoblisse¬ment a lieu en 1270, et l'égalité s'introduit enfin dans le gouvernement par l'aristocratie elle-même.
Durant les sept cents ans qui viennent de s'écouler, il est arrivé quelquefois que, pour lutter contre l'autorité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs rivaux, les nobles ont donné une puissance politique au peuple.
Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement les classes inférieures de l'État, afin d'abaisser l'aristocratie.
En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles ; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. [...I
Lorsqu'on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour ainsi dire pas de grands événements qui depuis sept cents ans n'aient tourné au profit de l'égalité.
Les croisades et les guerres des Anglais déciment les nobles et divisent leurs terres ; l'institution des com¬munes introduit la liberté démocratique au sein de la monarchie féodale ; la découverte des armes à feu égalise le vilain et le noble sur le champ de bataille ; l'imprimerie offre d'égales ressources à leur intelligence ; la poste vient
déposer la lumière sur le seuil de la cabane du pauvre comme à la porte des palais ; le protestantisme soutient que tous les hommes sont également en état de trouver le chemin du ciel. L'Amérique, qui se découvre, présente à la fortune mille routes nouvelles, et livre à l'obscur aventurier les richesses et le pouvoir.
Si, à partir du XIe siècle, vous examinez ce qui se passe en France de cinquante en cinquante années, au bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d'apercevoir qu'une double révolution s'est opérée dans l'état de la société. Le noble aura baissé dans l'échelle sociale, le roturier s'y sera élevé ; l'un descend, l'autre monte. Chaque demi-siècle les rapproche, et bientôt ils vont se toucher.
Et ceci n'est pas seulement particulier à la France. De quelque côté que nous jetions nos regards, nous aperce¬vons la même révolution qui se continue dans tout l'uni¬vers chrétien.
5. La « bonne volonté « kantienne
Kant, Métaphysique des moeurs [1785],
trad. Alain Renaut, GF-Flammarion, 1994, t. I,
« Fondation «, Première section, p. 59-60.
Il n'y a nulle part quoi que ce soit dans le monde, ni même en général hors de celui-ci, qu'il soit possible de penser et qui pourrait sans restriction être tenu pour bon, à l'exception d'une volonté bonne. L'intelligence, la viva¬cité, la faculté de juger, tout comme les autres talents de l'esprit, de quelque façon qu'on les désigne, ou bien le courage, la résolution, la constance dans les desseins, en tant que propriétés du tempérament, sont sans doute, sous bien des rapports, des qualités bonnes et souhaitables ; mais elles peuvent aussi devenir extrêmement mauvaises et dommageables si la volonté qui doit se servir de ces dons de la nature, et dont les dispositions spécifiques s'appellent pour cette raison caractère, n'est pas bonne. Il en va exactement de la même manière avec les dons de la fortune. Le pouvoir, la richesse, la considération, même la santé et le bien-être, le contentement complets de son état (ce qu'on entend par le terme de bonheur), donnent du coeur à celui qui les possède et ainsi, bien souvent, engendrent aussi de l'outrecuidance, quand il n'y a pas une volonté bonne qui redresse l'influence exercée sur l'âme par ces bienfaits, ainsi que, de ce fait, tout le prin¬cipe de l'action, pour orienter vers des fins universelles ; sans compter qu'un spectateur raisonnable en même temps qu'impartial ne peut même jamais éprouver du plaisir à voir la réussite ininterrompue d'un être que ne distingue aucun trait indicatif d'une volonté pure et bonne, et qu'ainsi la volonté bonne apparaît constituer la condition indispensable même de ce qui nous rend dignes d'être heureux.
Bien plus : il existe certaines qualités qui sont favo¬rables à cette volonté bonne elle-même et qui peuvent fortement faciliter son oeuvre, mais qui, néanmoins, ne possèdent intrinsèquement aucune valeur absolue et pré¬supposent au contraire toujours encore une volonté bonne, ce qui limite la haute estime qu'on leur porte par ailleurs à juste titre et ne permet pas de les tenir pour absolument bonnes. La modération dans les affects et les passions, la maîtrise de soi, la sobriété de réflexion ne sont pas seulement bonnes à bien des égards, mais elles semblent même constituer une dimension de la valeur intrinsèque de la personne ; reste qu'il s'en faut de beau¬coup qu'on puisse les déclarer bonnes sans restriction (quand bien même elles ont été valorisées de manière inconditionnée par les Anciens). Car, sans les principes d'une volonté bonne, elles peuvent devenir extrêmement mauvaises, et le sang-froid d'un vaurien le rend, non seu¬lement bien plus dangereux, mais aussi immédiatement, à nos yeux, plus abominable encore que nous ne l'eus¬sions estimé sans cela.
6. De la différence entre l'animal et l'homme
Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements
de l'inégalité parmi les hommes [1755],
GF-Flammarion, 2008, p. 78-80.
Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingé-nieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même, et pour se garantir, jusqu'à un certain point, de tout ce qui tend à la détruire, ou à la déranger. J'aper¬çois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes, en qualité d'agent libre. L'un choi¬sit ou rejette par instinct, et l'autre par un acte de liberté ; ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. C'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur des tas de fruits, ou de grain, quoique l'un et l'autre pût très bien se nourrir de l'aliment qu'il dédaigne, s'il s'était avisé d'en essayer. C'est ainsi que les hommes dissolus se livrent à des excès, qui leur causent la fièvre et la mort ; parce que l'esprit déprave les sens, et que la volonté parle encore, quand la nature se tait.
Tout animal a des idées puisqu'il a des sens, il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins. Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à telle bête ; ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre. La nature commande à tout animal, et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer, ou de
résister ; et c'est surtout dans ,la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme : car la physique explique en quelque manière le mécanisme des sens et la formation des idées ; mais dans la puissance de vouloir ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette puissance on ne trouve que des actes purement spirituels, dont on n'explique rien par les lois de la mécanique.
Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelque lieu de disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner ; faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu'elle était la première année de ces mille ans. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l'homme reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même ? Il serait triste pour nous d'être forcés de convenir, que cette faculté distinctive, et presque illimitée, est la source de tous les malheurs de l'homme ; que c'est elle qui le tire, à force de temps, de cette condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents ; que c'est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même, et de la nature.
7. « Quelle espèce de guerre on peut et on doit faire aux Arabes «
Tocqueville, « Travail sur l'Algérie « [1841],
in Sur l'Algérie, GF-Flammarion, 2003, p. 111-113.
Quant à la manière de faire cette guerre, j'ai vu émettre deux opinions très contraires et que je rejette également.
D'après la première, pour réduire les Arabes il convient de conduire contre eux la guerre avec la dernière violence et à la manière des Turcs, c'est-à-dire en tuant tout ce qui se rencontre. J'ai entendu soutenir cet avis par des officiers qui allaient jusqu'à regretter amèrement qu'on commençât de part et d'autre à faire des prisonniers et on m'a souvent affirmé que plusieurs encourageaient leurs soldats à n'épargner personne. Pour ma part, j'ai rapporté d'Afrique la notion affligeante qu'en ce moment nous faisons la guerre d'une manière beaucoup plus bar¬bare que les Arabes eux-mêmes. C'est, quant à présent, de leur côté que la civilisation se rencontre. Cette manière de mener la guerre me paraît aussi inintelligente qu'elle est cruelle. Elle ne peut entrer que dans l'esprit grossier et brutal d'un soldat. Ce n'était pas la peine en effet de nous mettre à la place des Turcs pour reproduire ce qui en eux méritait la détestation du monde. Cela, même au point de vue de l'intérêt, est beaucoup plus nuisible qu'utile ; car, ainsi que me le disait un autre officier, si nous ne visons qu'à égaler les Turcs nous serons par le fait dans une position bien inférieure à eux : barba¬res pour barbares, les Turcs auront toujours sur nous l'avantage d'être des barbares musulmans. C'est donc à un principe supérieur au leur qu'il faut en appeler.
D'une autre part, j'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte, mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûlât les moissons, qu'on vidât
les silos et enfin qu'on s'emparât des hommes sans armes, des femmes et des enfants.
Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. Et, s'il faut dire ma pensée, ces actes ne me révoltent pas plus ni même autant que plusieurs autres que le droit de la guerre autorise évidemment et qui ont lieu dans toutes les guerres d'Europe. En quoi est-il plus odieux de brûler les mois¬sons et de faire prisonnier les femmes et les enfants que de bombarder la population inoffensive d'une ville assié¬gée ou que de s'emparer en mer des vaisseaux marchands appartenant aux sujets d'une puissance ennemie ? L'un est, à mon avis, beaucoup plus dur et moins justifiable que l'autre.
Si en Europe on ne brûle pas les moissons, c'est qu'en général on fait la guerre à des gouvernements et non à des peuples ; si on ne fait prisonniers que les gens de guerre, c'est que les armées tiennent ferme et que les populations civiles ne se dérobent point à la conquête. C'est en un mot que partout on trouve le moyen de s'emparer du pouvoir politique sans s'attaquer aux gou¬vernés ou même en se fournissant chez eux des ressources nécessaires à la guerre.
On ne détruira la puissance d'Abd el-Kader qu'en ren¬dant la position des tribus qui adhèrent à lui tellement insupportable qu'elles l'abandonnent. Ceci est une vérité évidente. Il faut s'y conformer ou abandonner la partie. Pour moi, je pense que tous les moyens de désoler les tribus doivent être employés. Je n'excepte que ceux que l'humanité et le droit des nations réprouvent.
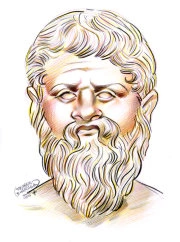
«
74 1 UNE BRÈVE HISTOIRE DE LÉTHIQUE
l'argent», parce que c'est principalement avec de l'argent
que
les désirs de ce genre trouvent à se satisfaire.
-
Ce sont des appellations correctes, dit-il.
-
Si donc nous affirmions que le plaisir de cette espèce
et son affection
se portent vers le profit, ne disposerions
nous pas
d'un principe de base pour appuyer notre rai
sonnement, de manière
à clarifier pour nous de quoi il
s'agit chaque fois que nous parlerions de cette partie de
l'âme
? En l'appelant « amie de l'argent et amie du
profit», ne la désignerions-nous pas correctement ?
-C'est en tout cas l'opinion que je m'en fais, dit-il.
- Mais dis-moi, l'élément d'ardeur, n'affirmons-nous
pas qu'il
tend toujours tout entier vers le pouvoir, la vic
toire et la renommée
?
- Si, certainement.
-
Si donc nous déclarions qu'il est «ami de la vic-
toire
» et « ami de l'honneur », serait-ce approprié ?
- Ce serait tout à fait approprié.
- Mais l'espèce par laquelle nous apprenons,
il est évi-
dent pour chacun qu'elle est toujours tout entière orien
tée vers la connaissance de la vérité,
où qu'elle soit, et
que, parmi
les espèces de l'âme, elle est celle qui se soucie
le moins des richesses et de la réputation.
-
Oui, et de loin.
-
Si nous l'appelions « amie du savoir » et « amie de
la
sagesse», philosophe, ne la désignerions-nous pas de la
manière qui convient
?
-Si, nécessairement.
-
Or, repris-je, dans les âmes de certains, c'est cette
espèce qui commande, alors que chez d'autres, c'est l'une
des deux autres, selon la situation
?
- C'est bien le cas, dit-il.
- C'est
pour cette raison que nous affirmons qu'il
existe trois genres d'hommes principaux,
le philosophe,
l'ami de la victoire et l'ami
du profit..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- EXTRAITS STOÏCISME ANTHOLOGIE PHILOSOPHIQUE
- Anthologie philosophique: Platon
- Vigny dit lui-même de ses poèmes qu'ils sont des compositions dans lesquelles une pensée philosophique est mise en scène sous une forme épique ou dramatique. Vous expliquerez cette définition en prenant comme exemple une pièce de Vigny d votre choix.
- Berkeley compare la spéculation philosophique a un voyage en pays étranger : « à la fin, je reviens d’où j’étais parti le cœur content et plus satisfait de moi-même ». Commenter cette pensée. PLAN.
- Freud Extraits - Anthologie