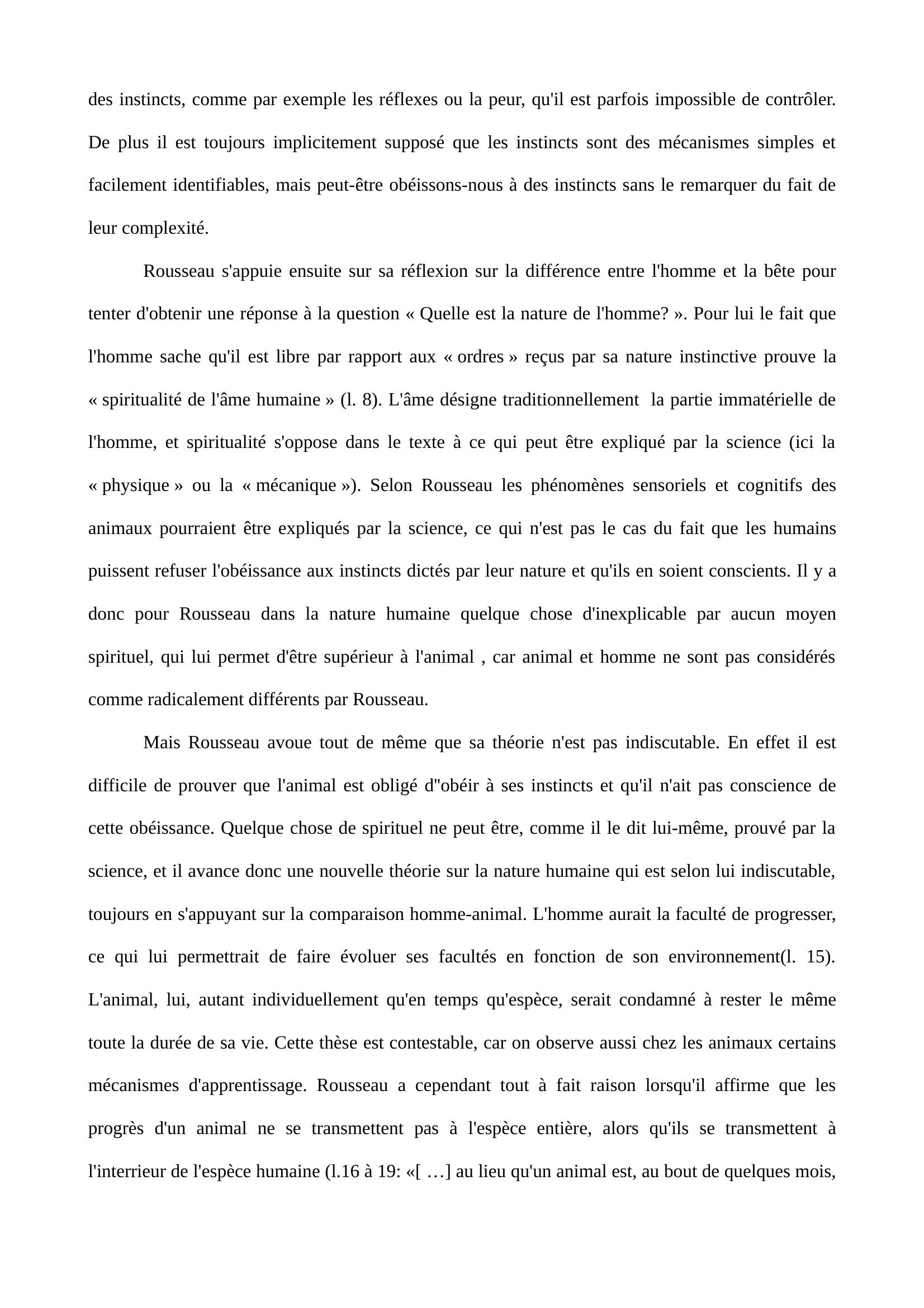Explication de texte de Rousseau
Publié le 23/09/2012
Extrait du document


«
des instincts, comme par exemple les réflexes ou la peur, qu'il est parfois impossible de contrôler.
De plus il est toujours implicitement supposé que les instincts sont des mécanismes simples et
facilement identifiables, mais peut-être obéissons-nous à des instincts sans le remarquer du fait de
leur complexité.
Rousseau s'appuie ensuite sur sa réflexion sur la différence entre l'homme et la bête pour
tenter d'obtenir une réponse à la question « Quelle est la nature de l'homme? ».
Pour lui le fait que
l'homme sache qu'il est libre par rapport aux « ordres » reçus par sa nature instinctive prouve la
« spiritualité de l'âme humaine » (l.
8).
L'âme désigne traditionnellement la partie immatérielle de
l'homme, et spiritualité s'oppose dans le texte à ce qui peut être expliqué par la science (ici la
« physique » ou la « mécanique »).
Selon Rousseau les phénomènes sensoriels et cognitifs des
animaux pourraient être expliqués par la science, ce qui n'est pas le cas du fait que les humains
puissent refuser l'obéissance aux instincts dictés par leur nature et qu'ils en soient conscients.
Il y a
donc pour Rousseau dans la nature humaine quelque chose d'inexplicable par aucun moyen
spirituel, qui lui permet d'être supérieur à l'animal , car animal et homme ne sont pas considérés
comme radicalement différents par Rousseau.
Mais Rousseau avoue tout de même que sa théorie n'est pas indiscutable.
En effet il est
difficile de prouver que l'animal est obligé d''obéir à ses instincts et qu'il n'ait pas conscience de
cette obéissance.
Quelque chose de spirituel ne peut être, comme il le dit lui-même, prouvé par la
science, et il avance donc une nouvelle théorie sur la nature humaine qui est selon lui indiscutable,
toujours en s'appuyant sur la comparaison homme-animal.
L'homme aurait la faculté de progresser,
ce qui lui permettrait de faire évoluer ses facultés en fonction de son environnement(l.
15).
L'animal, lui, autant individuellement qu'en temps qu'espèce, serait condamné à rester le même
toute la durée de sa vie.
Cette thèse est contestable, car on observe aussi chez les animaux certains
mécanismes d'apprentissage.
Rousseau a cependant tout à fait raison lorsqu'il affirme que les
progrès d'un animal ne se transmettent pas à l'espèce entière, alors qu'ils se transmettent à
l'interrieur de l'espèce humaine (l.16 à 19: «[ …] au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- explication de texte corrigé , Rousseau: Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes
- Explication de texte Rousseau
- EXPLICATION DE TEXTE ROUSSEAU
- explication de texte Jean-Jacques ROUSSEAU
- corrigés 2012 : explication texte de Rousseau